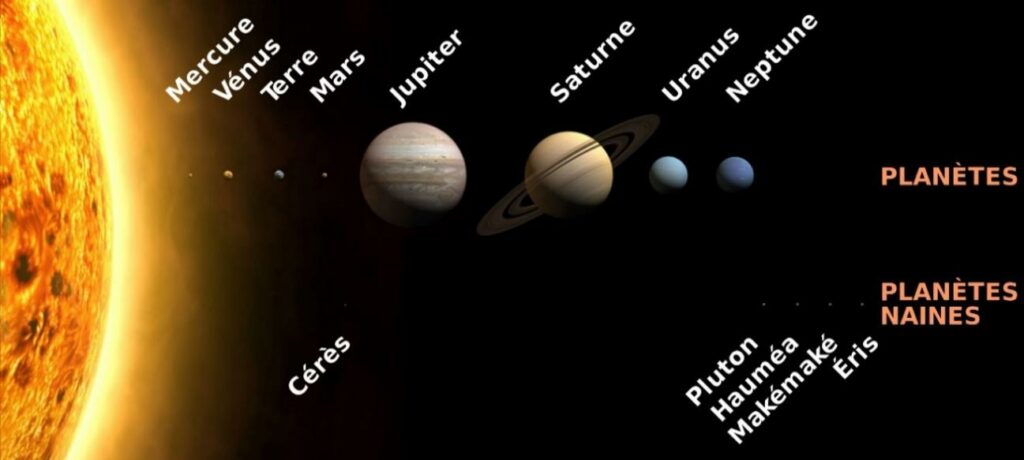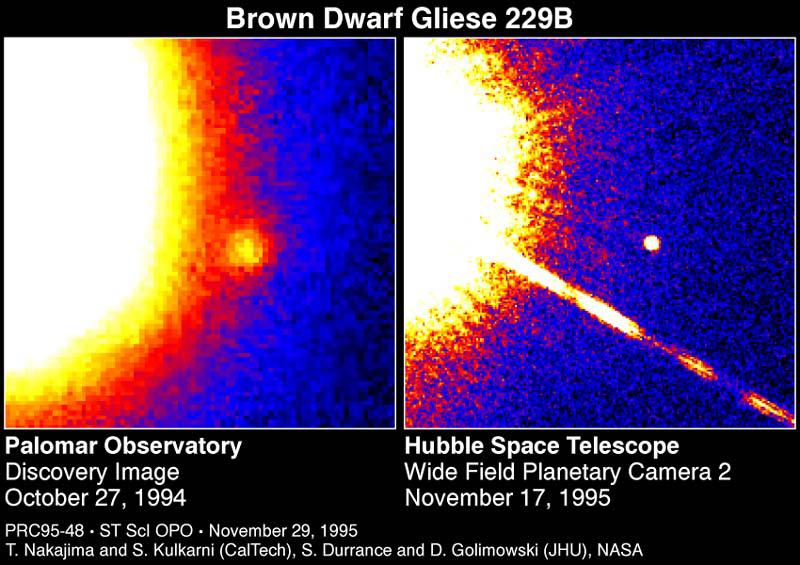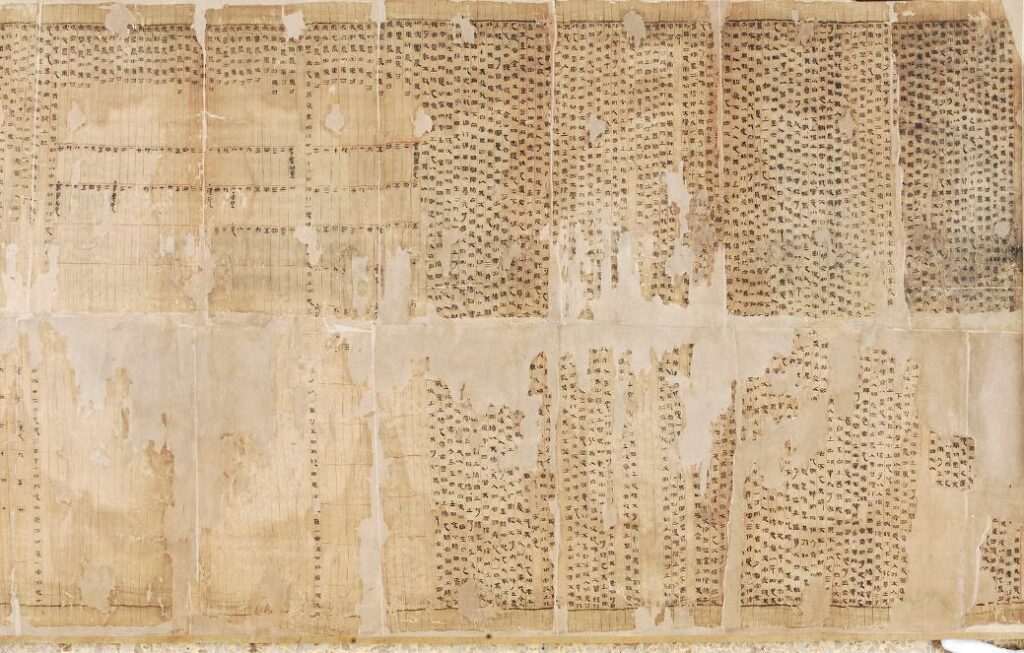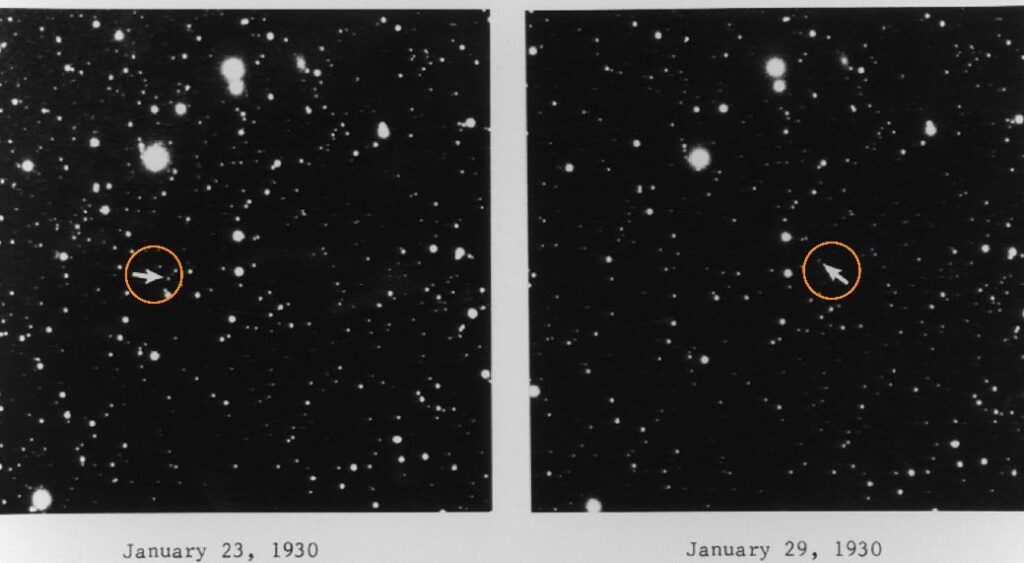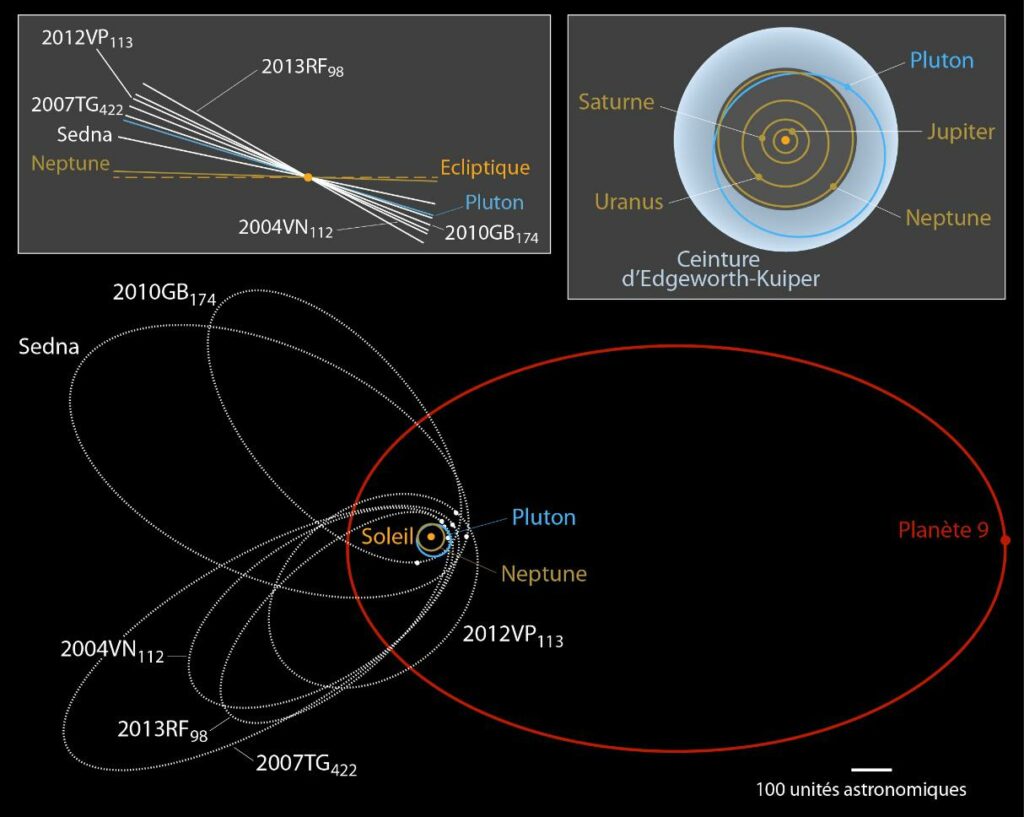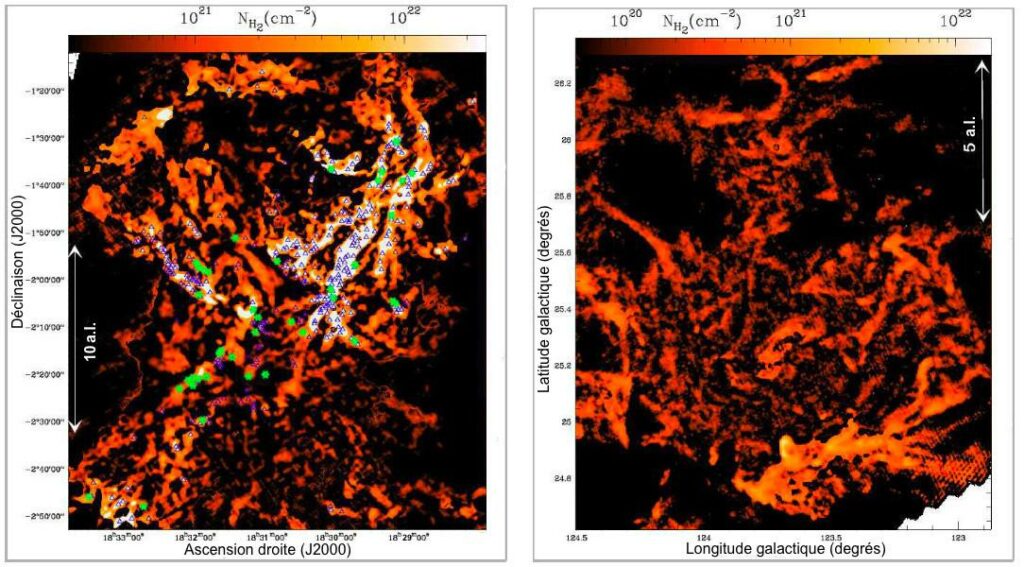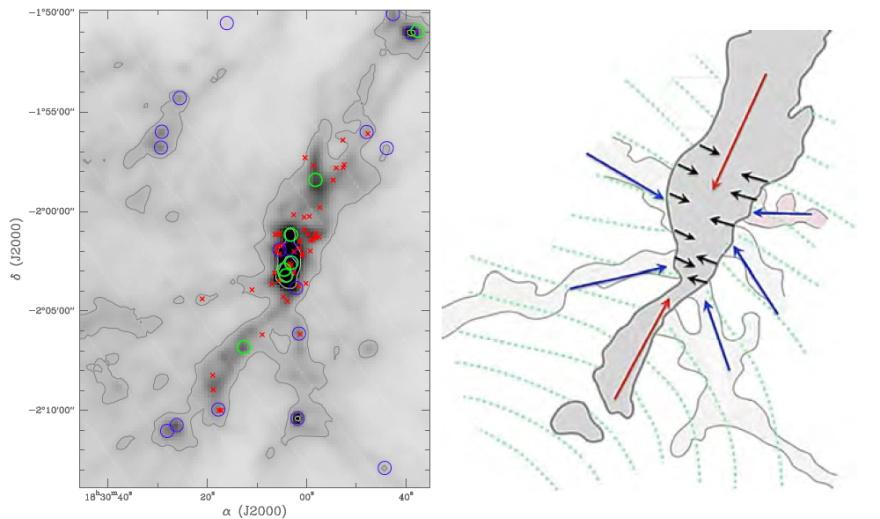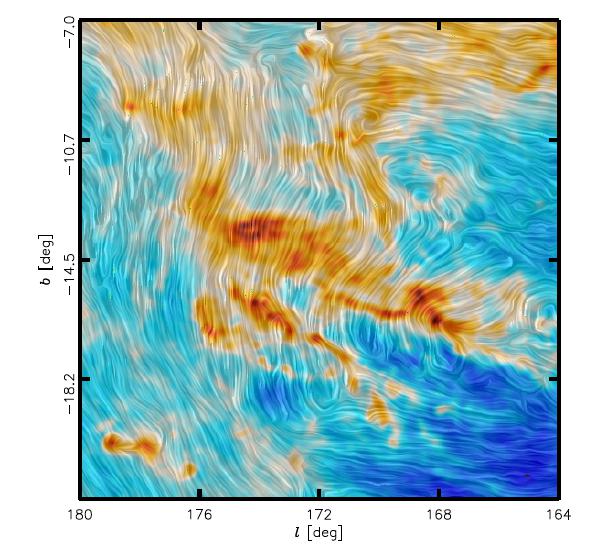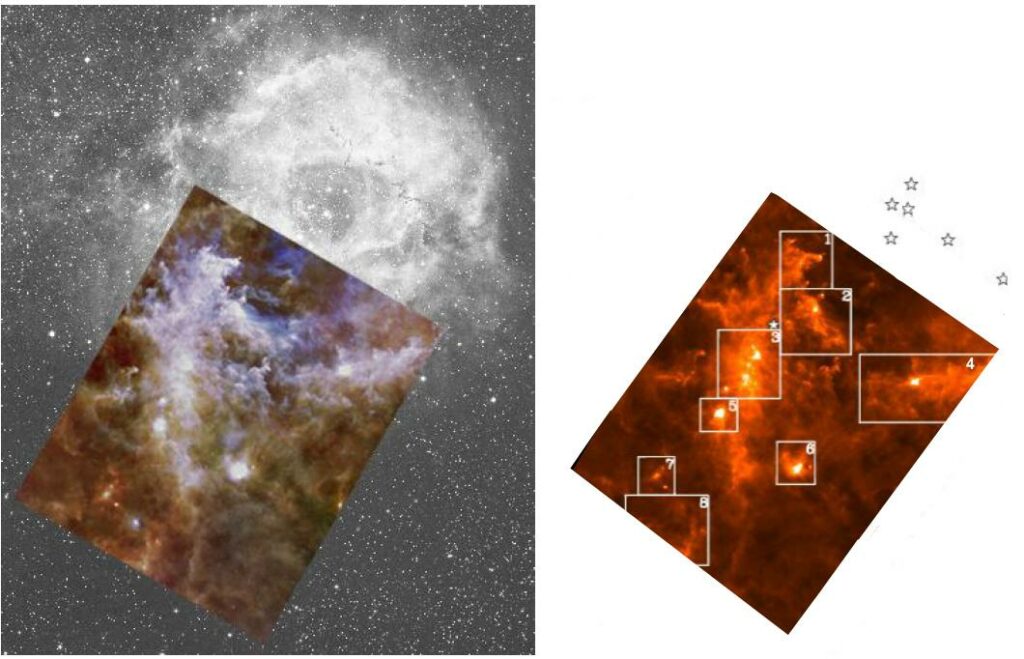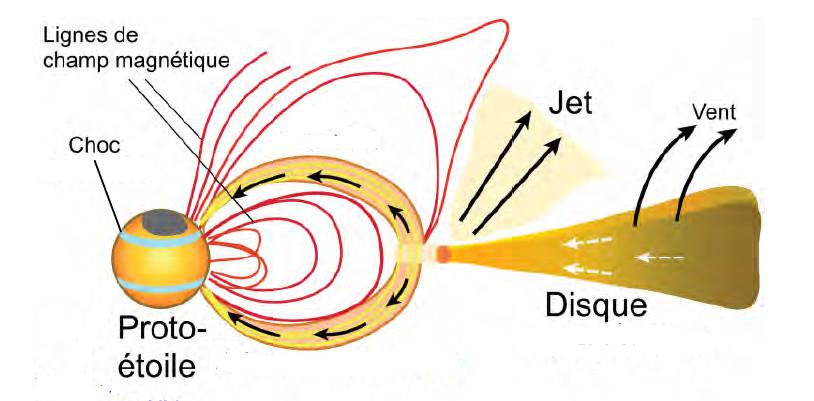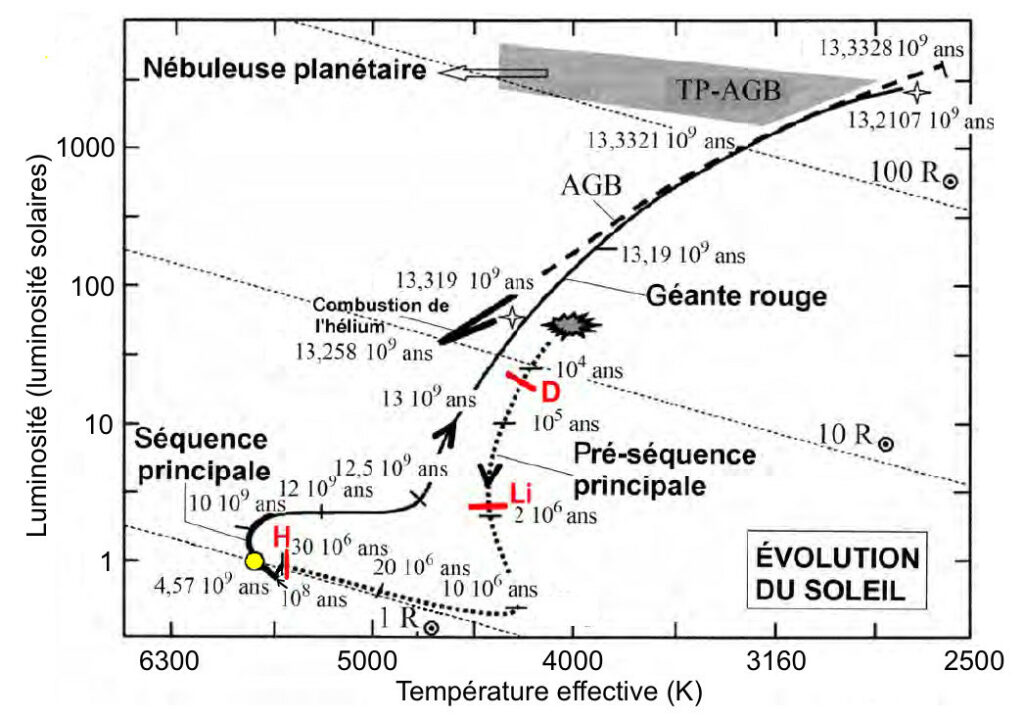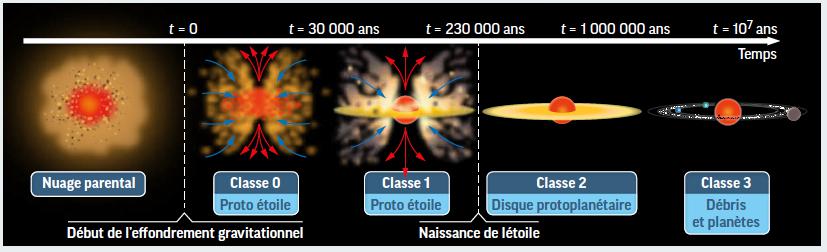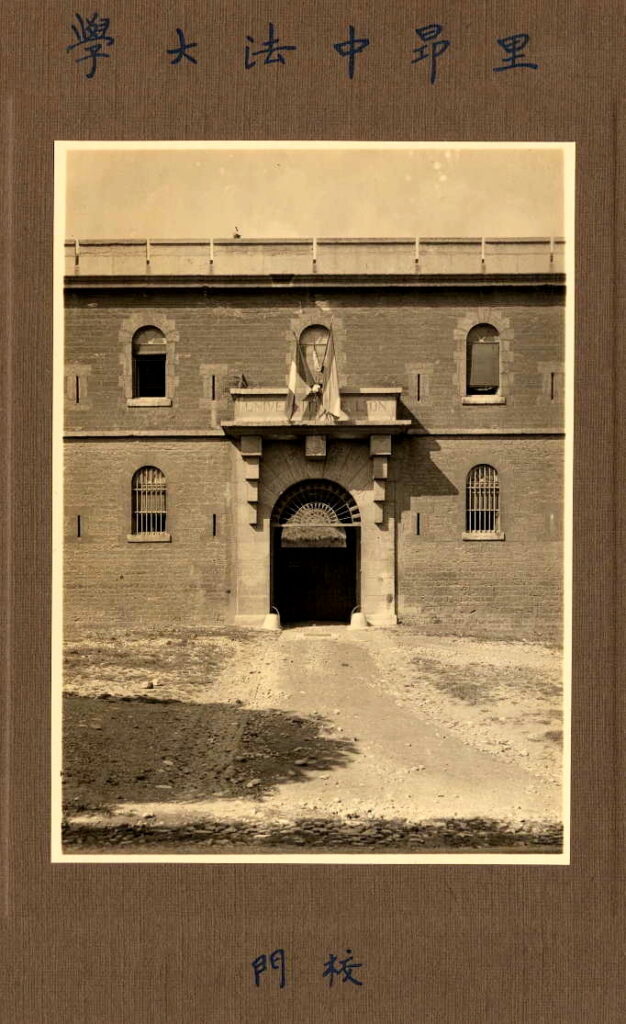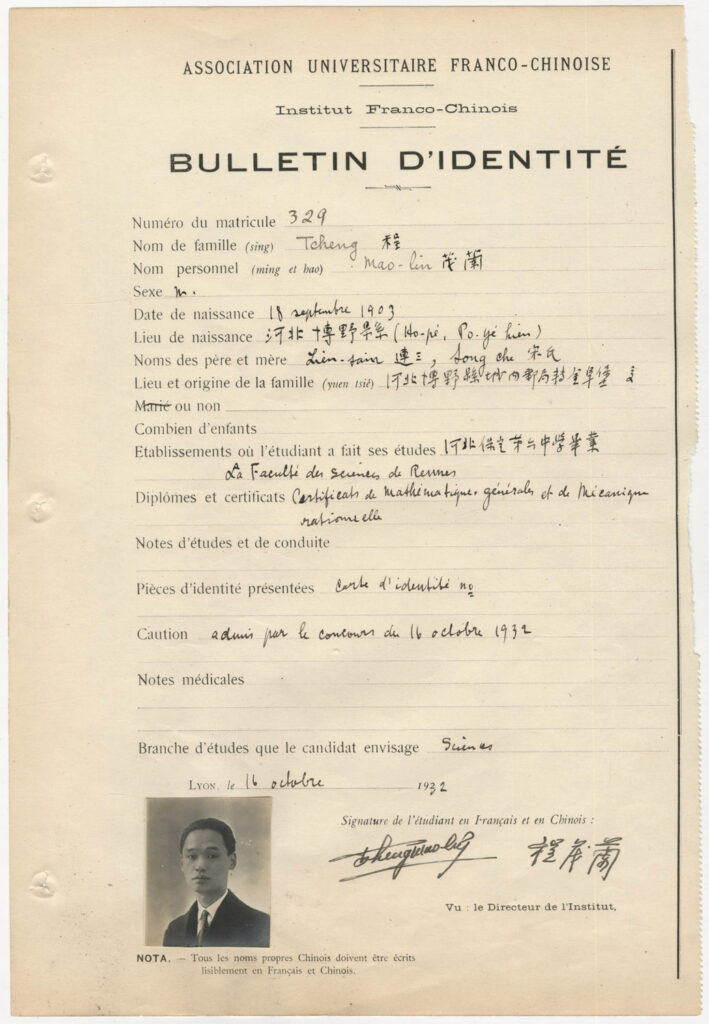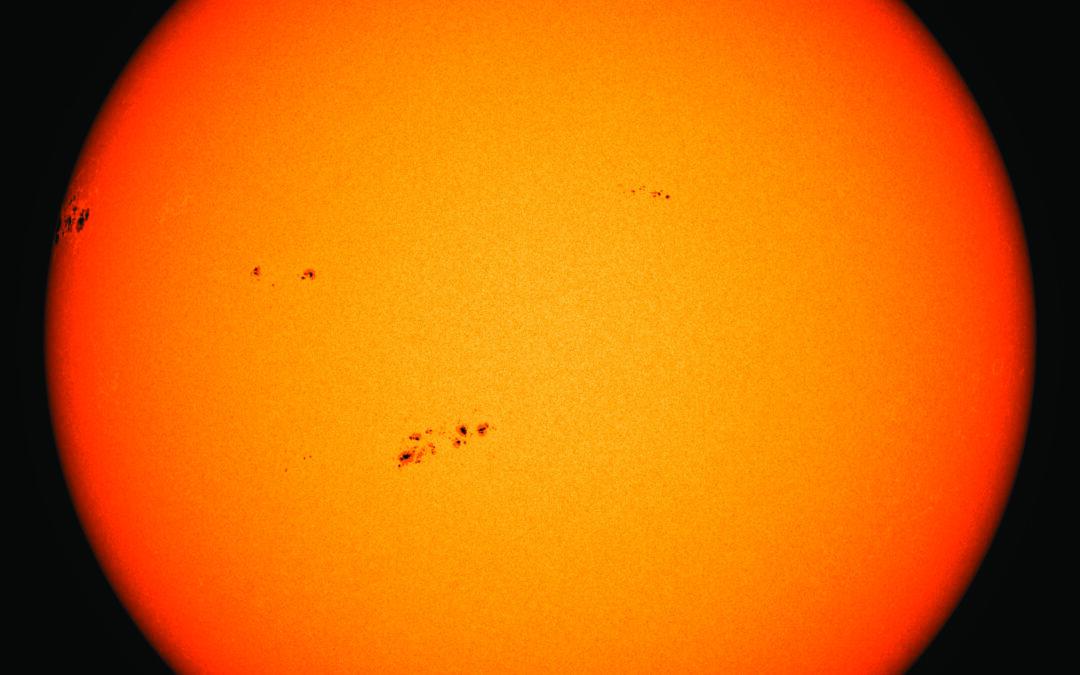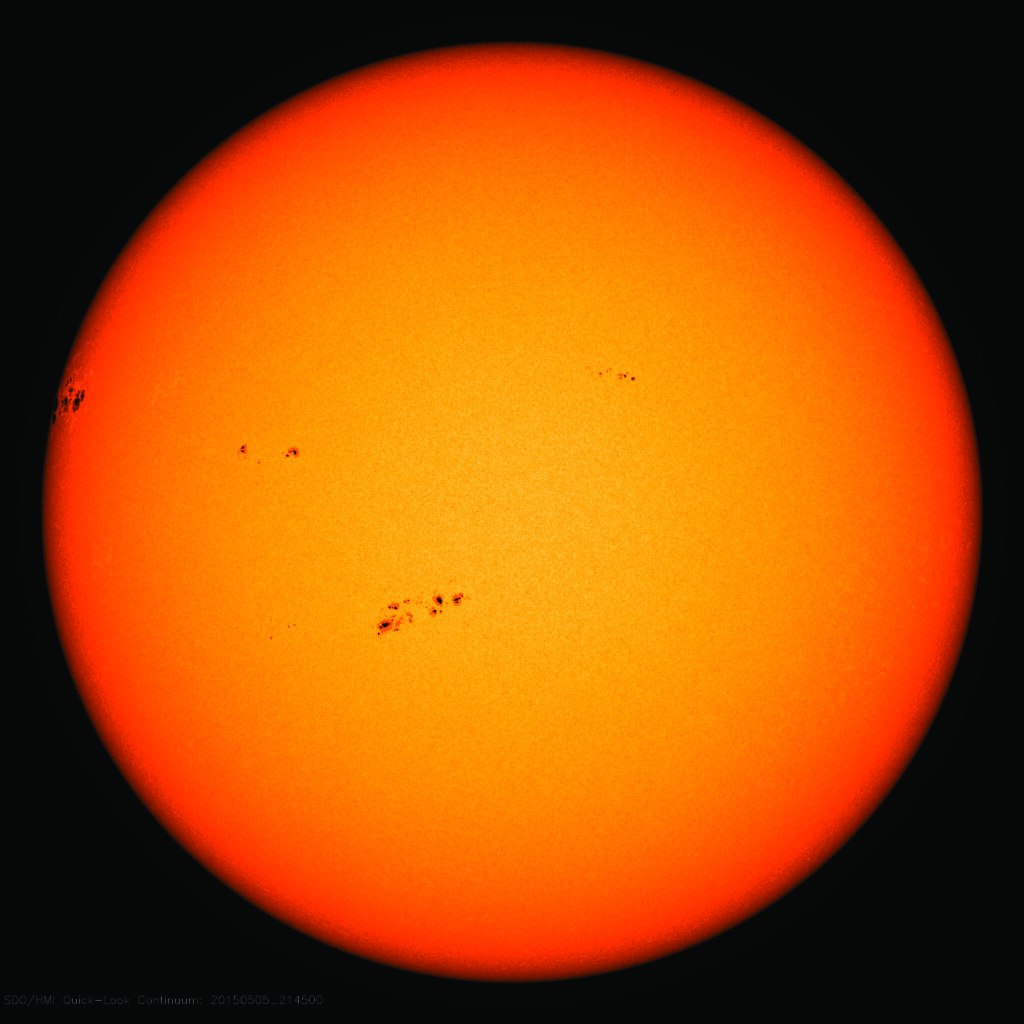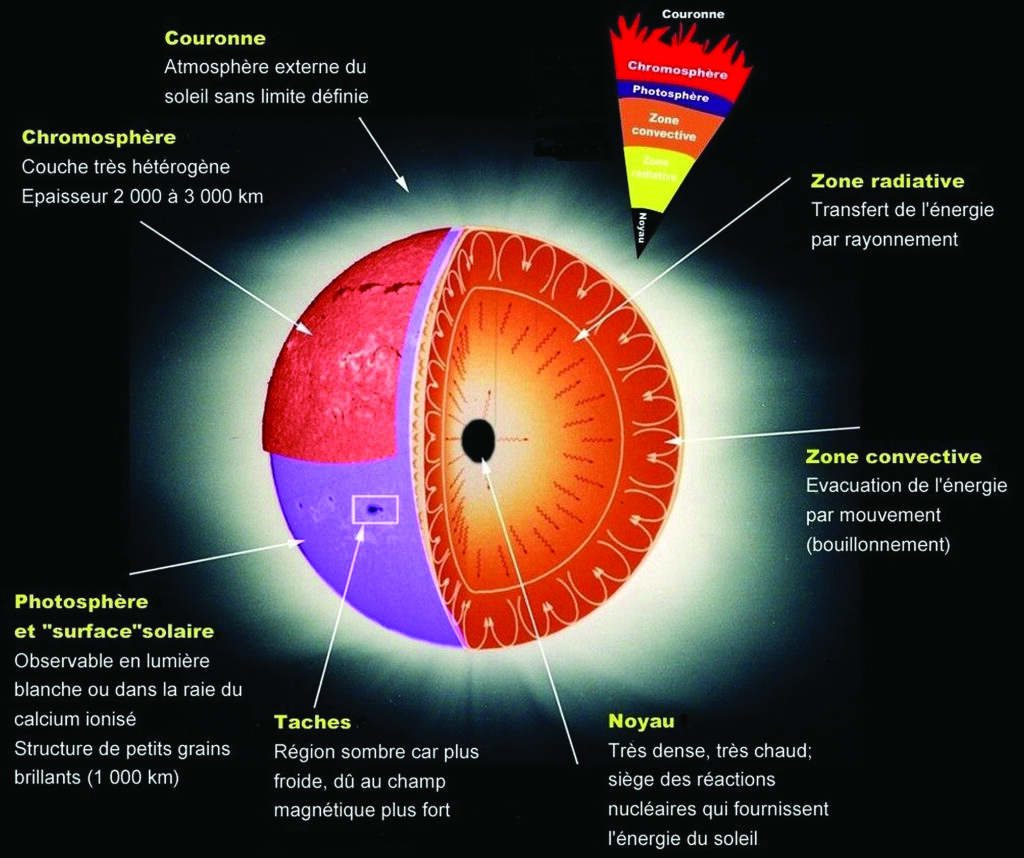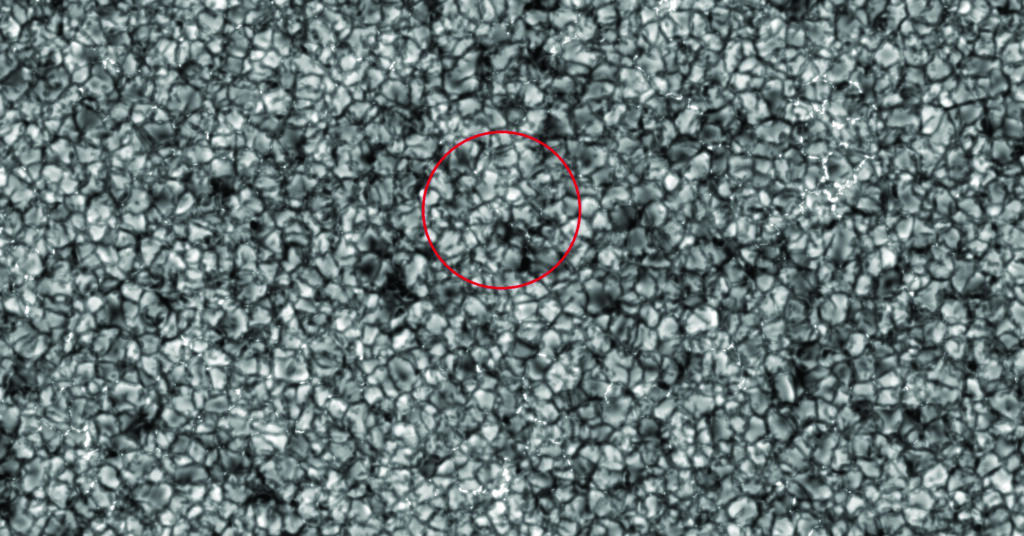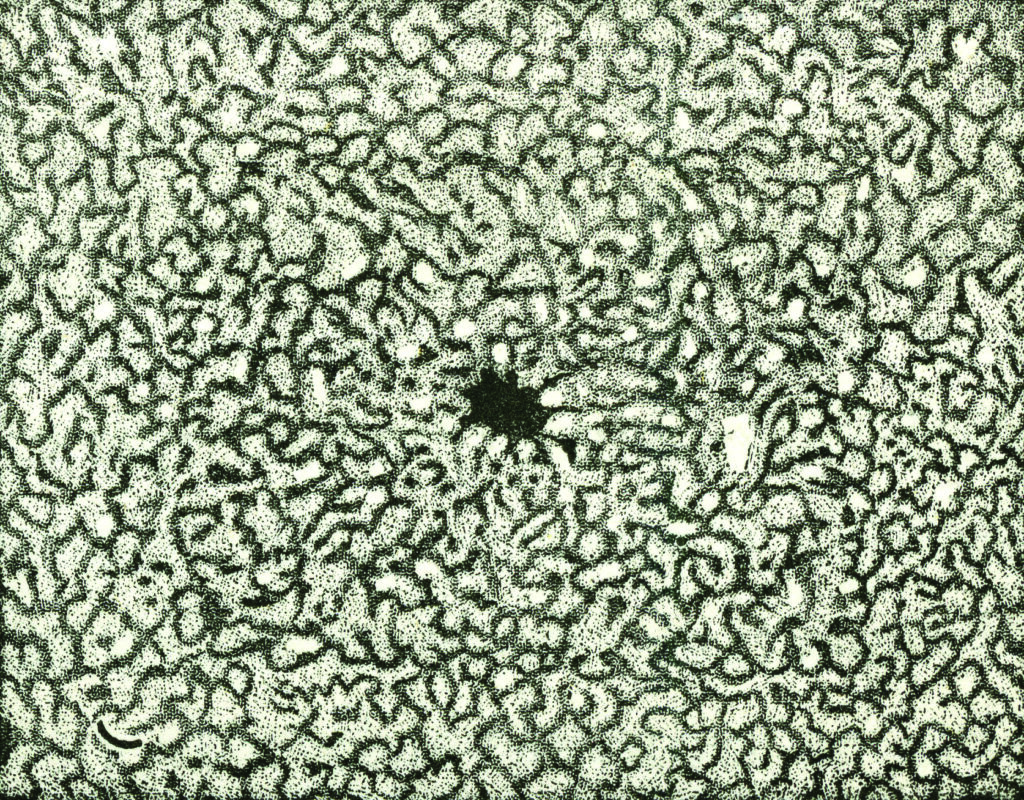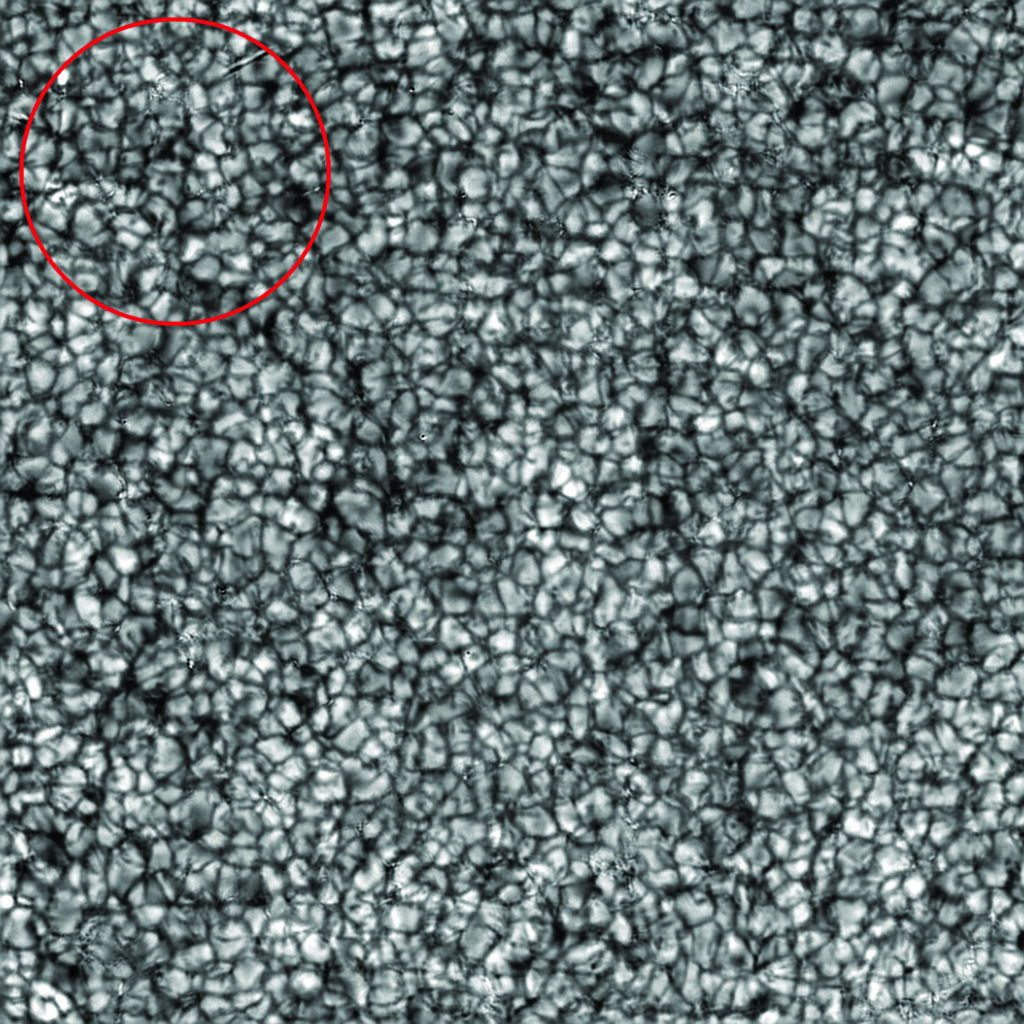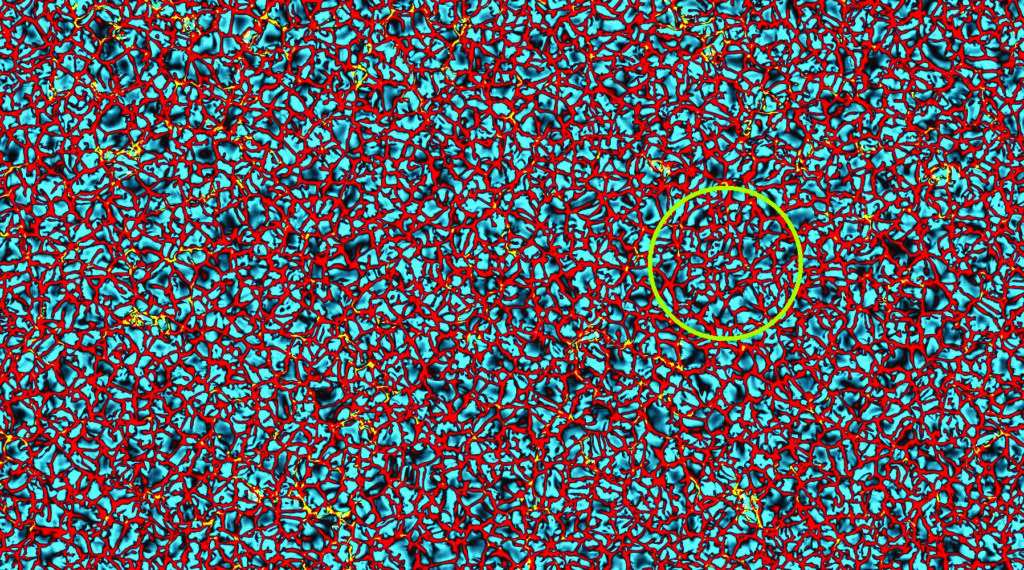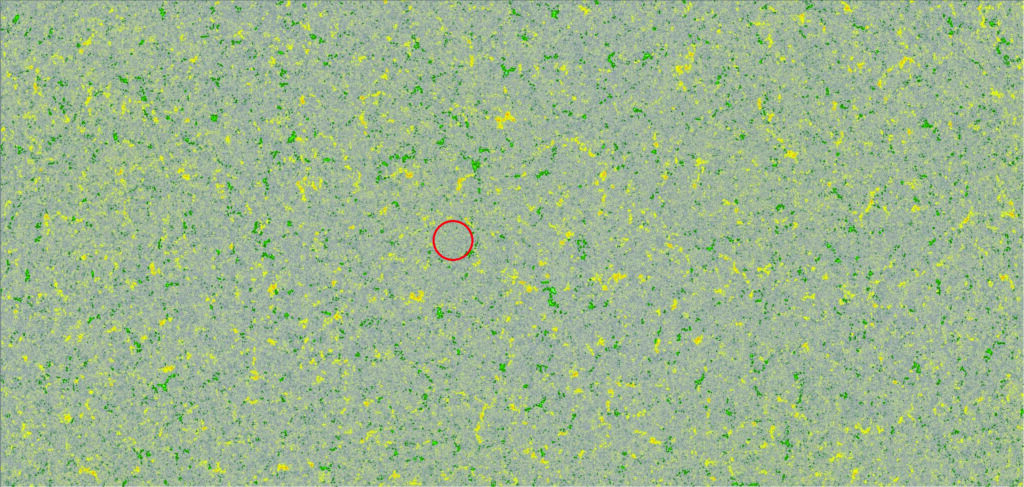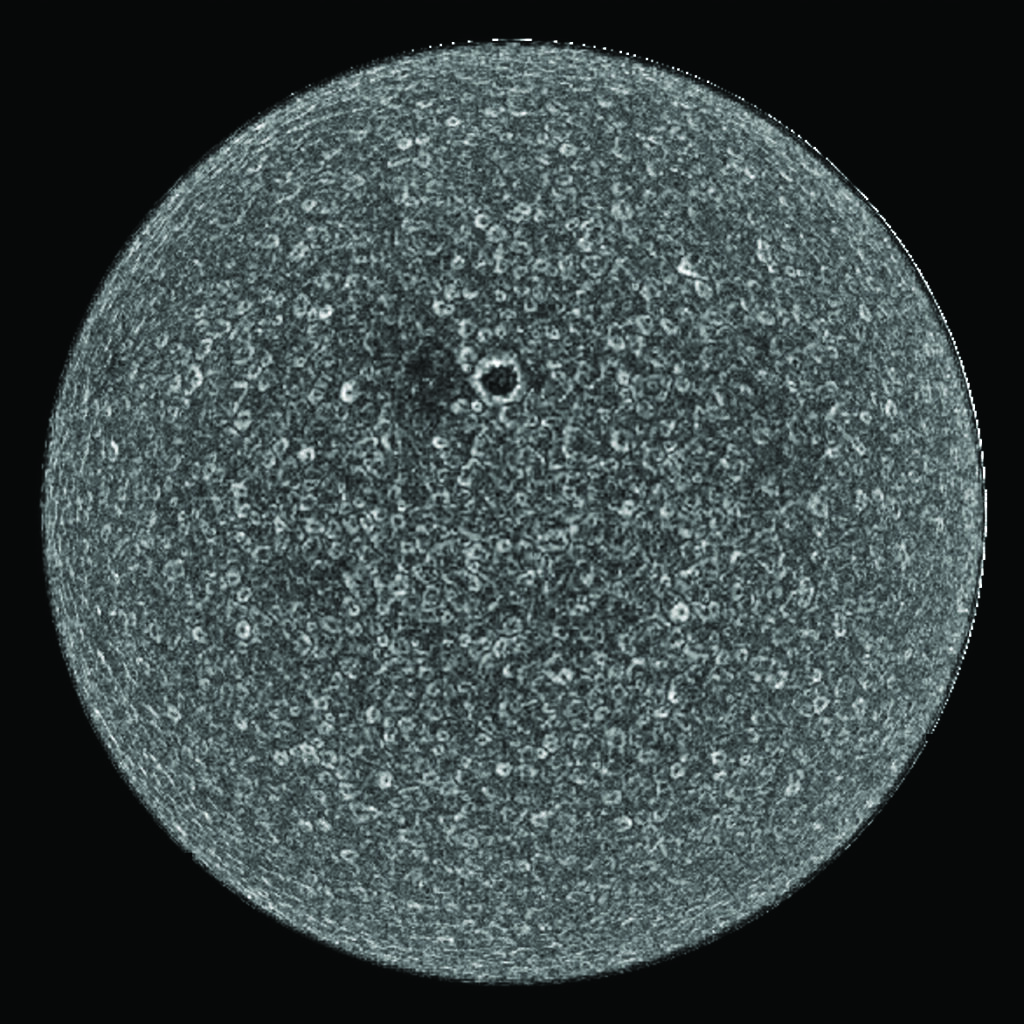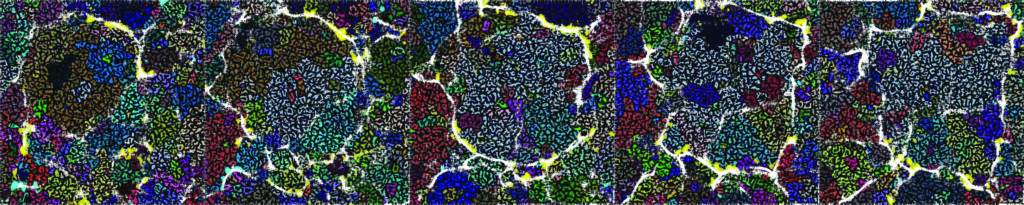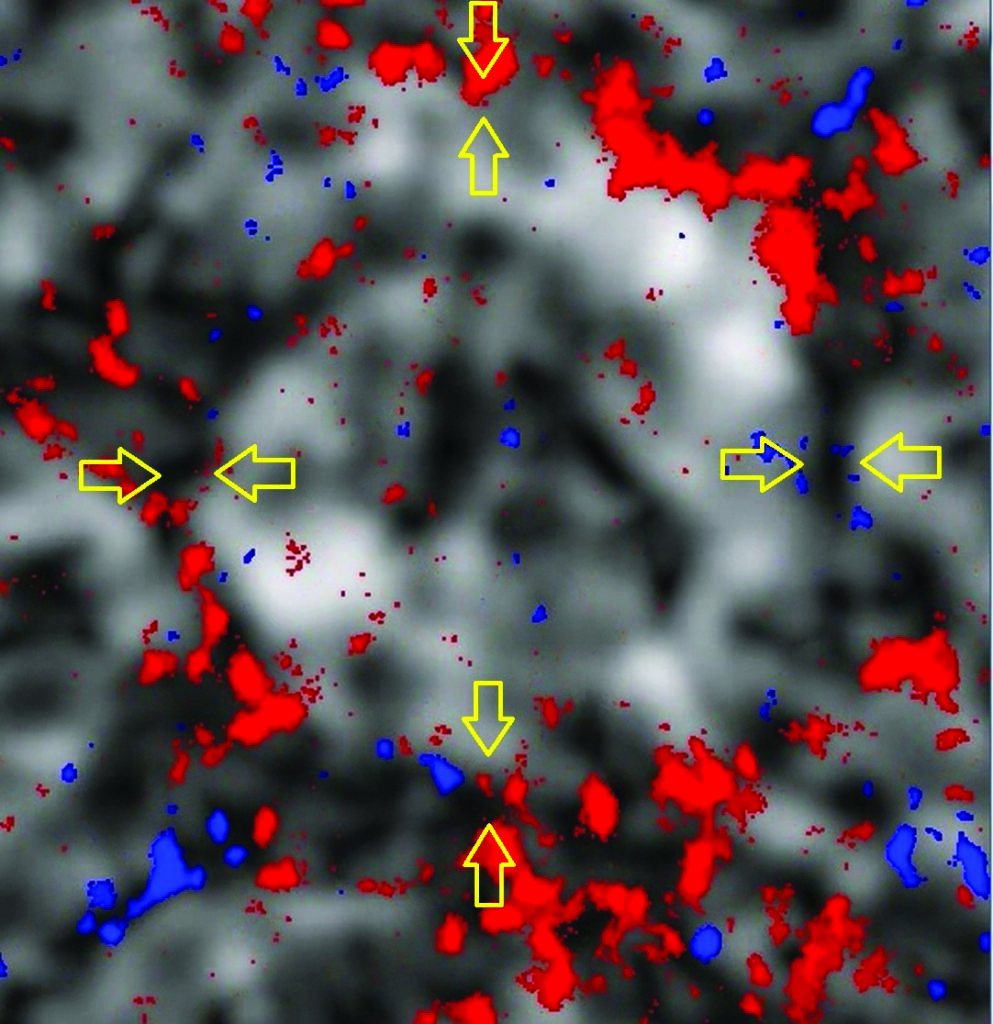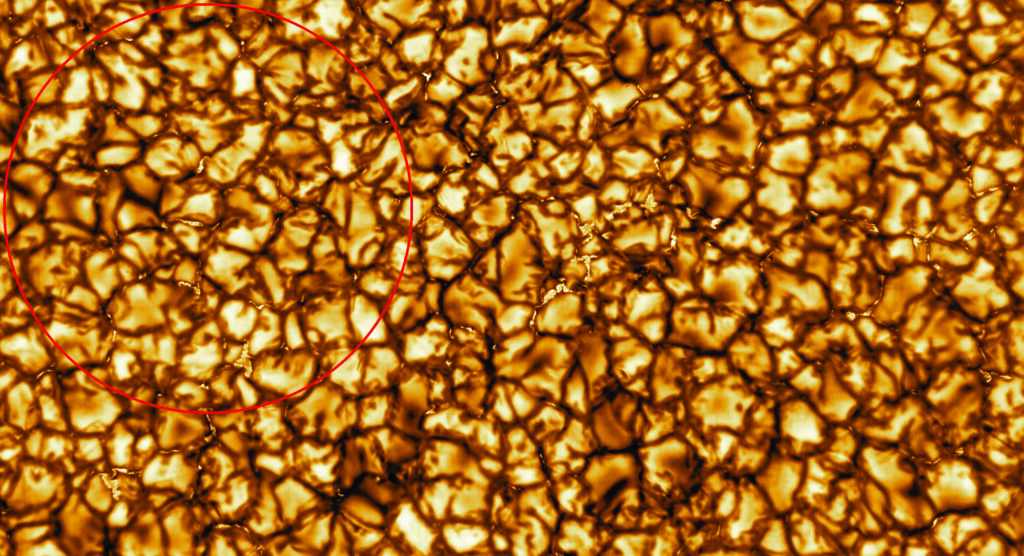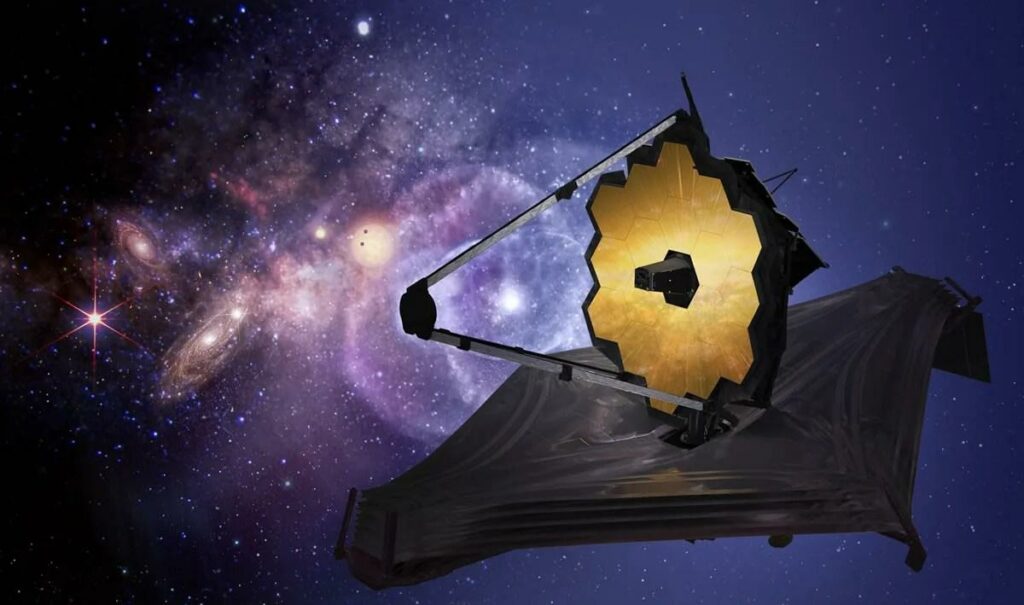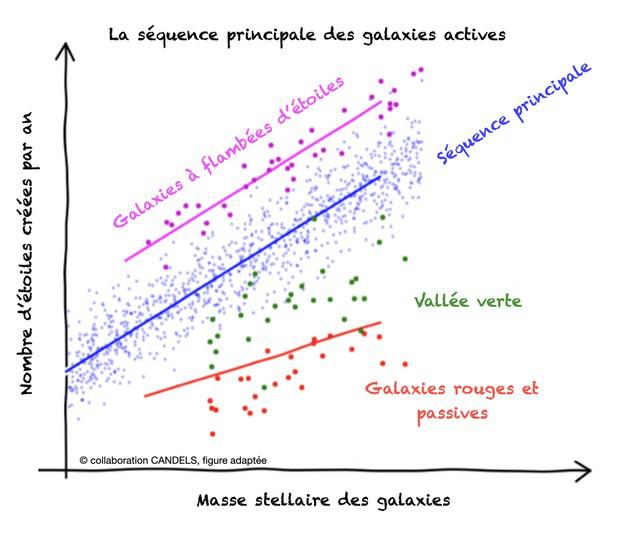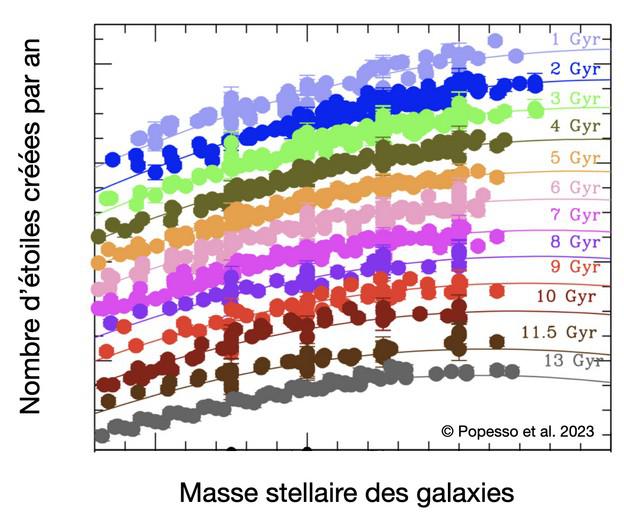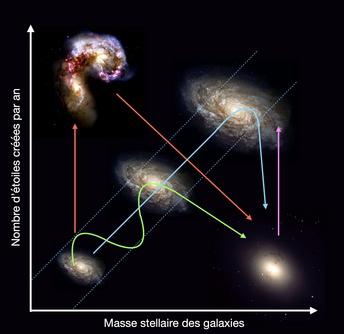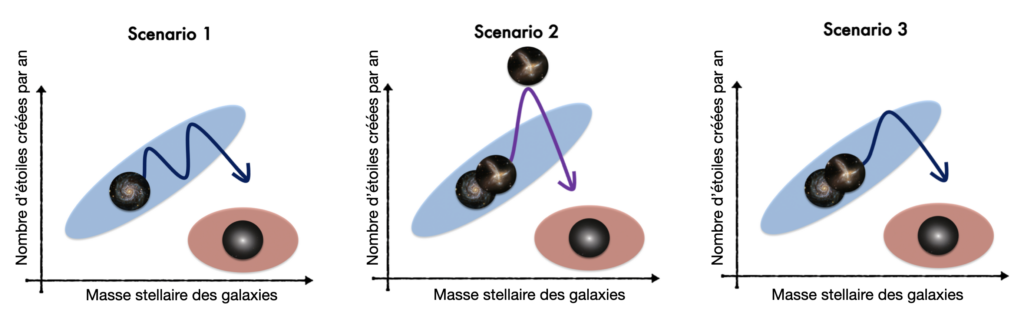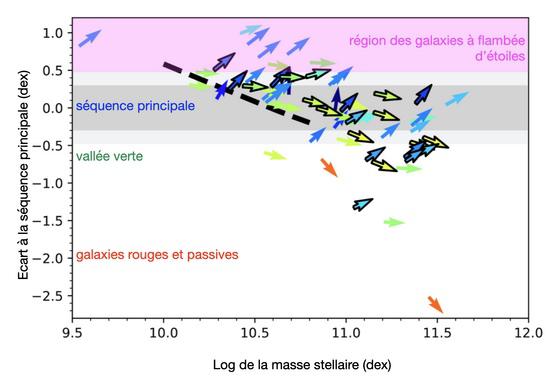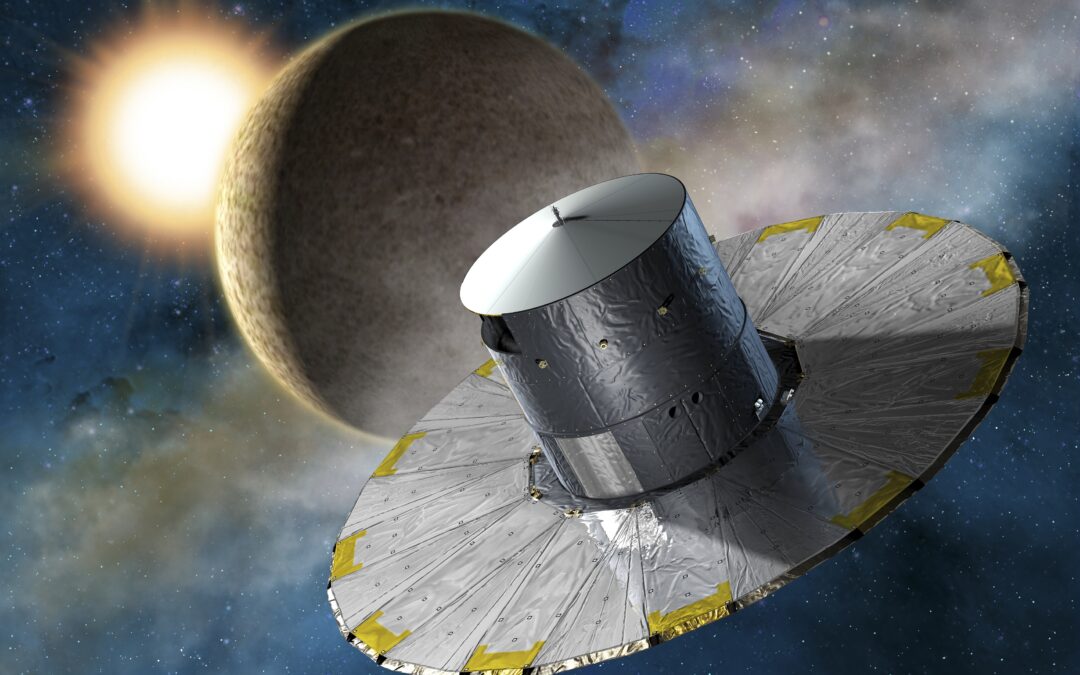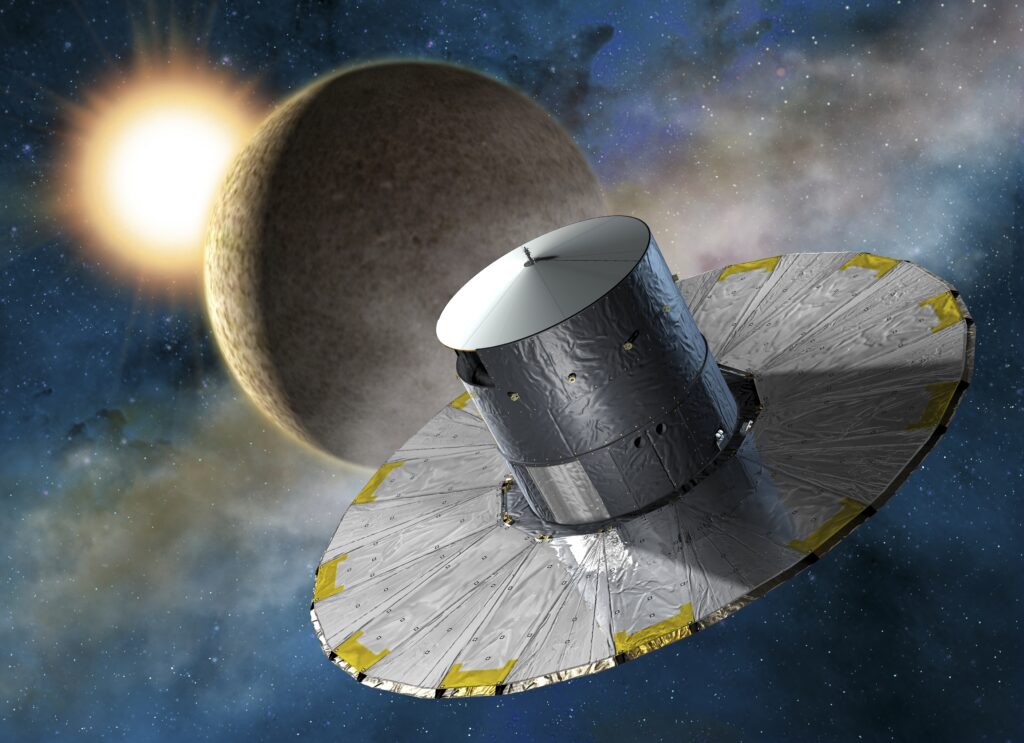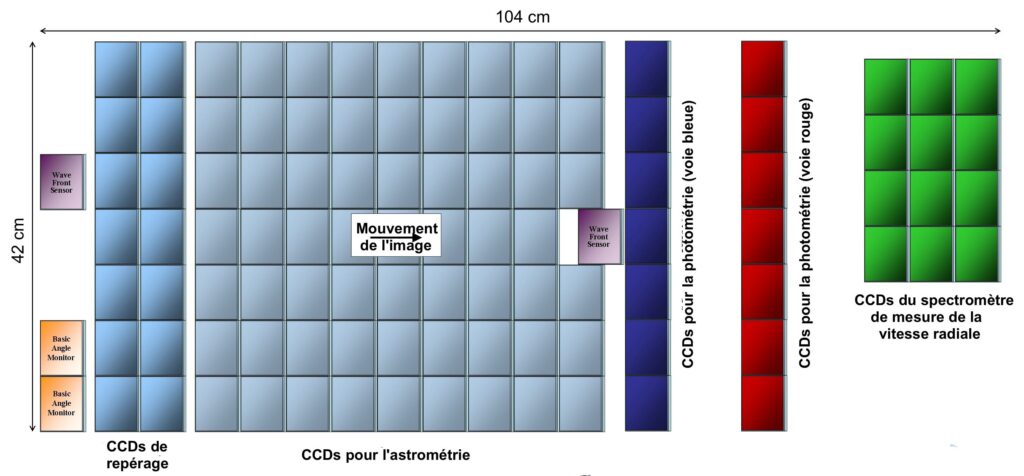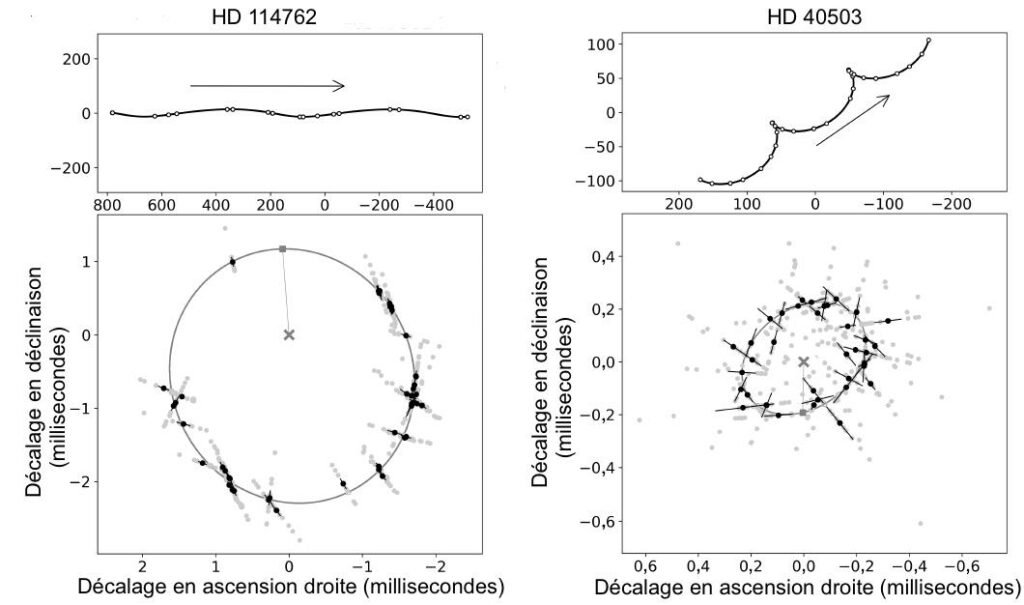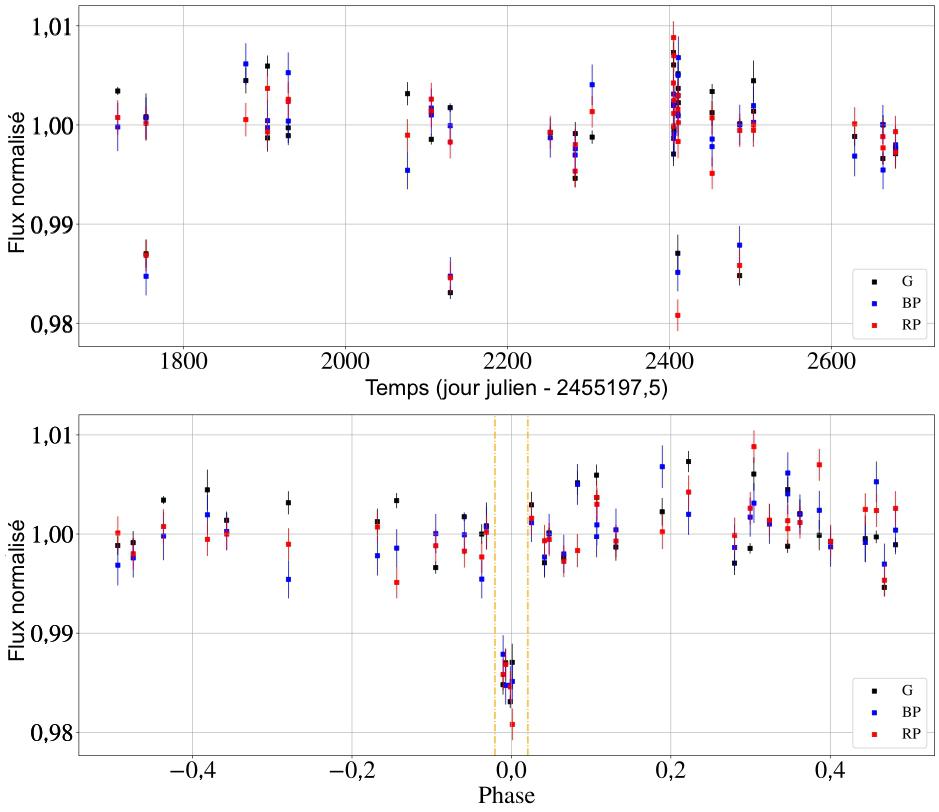par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur
Le nombre de planètes orbitant autour du Soleil est une question moins anodine qu’il y paraît. Elle nous pousse à définir ce qu’est une planète avant de nous entraîner dans les couloirs de l’histoire de l’astronomie. La découverte de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, il y a une trentaine d’années, et son étude ont rebattu les cartes et suggèrent la présence d’une neuvième planète loin, très loin, au-delà de cette ceinture.

Combien y a-t-il de planètes dans le Système solaire ? Un livre d’astronomie récent, un astronome, professionnel ou amateur, ou même toute personne qui s’intéresse de près ou de loin à l’astronomie répondra facilement à cette question : le Système solaire abrite 8 planètes. En partant du Soleil, on trouve Mercure, Vénus, notre planète la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Mais à la réflexion, cette question est moins simple qu’il y paraît. D’une part parce qu’elle appelle une autre question, plus difficile et quelque peu subjective : qu’est-ce qu’une planète ? Et d’autre part parce que la réponse donnée par les livres ou par les astronomes dépend de l’état actuel de nos connaissances. Elle n’est donc pas définitive. D’ailleurs, il y a seulement une vingtaine d’années, elle aurait été différente, tandis qu’au début du xxe siècle, Camille Flammarion aurait également répondu 8. Voyons cela plus en détail.
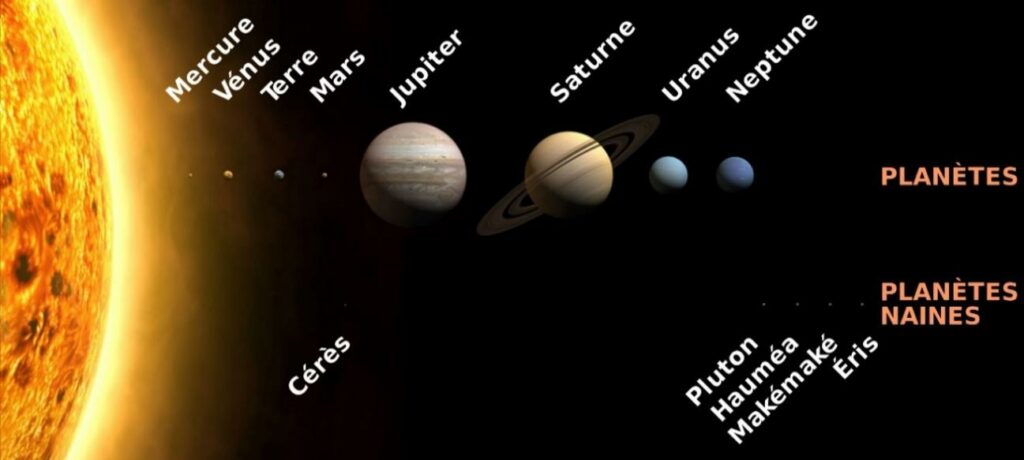
Le cortège planétaire du Soleil tel qu’on le représente depuis 2006. Aux planètes qui satisfont les critères de l’UAI, il faut ajouter des planètes naines, dont Cérès, Pluton et Éris (les distances ne sont pas à l’échelle). (Crédit NASA)
La définition de l’Union astronomique internationale
Comment définit-on une planète ? Et avant toute chose, est-il raisonnable de le faire ? Toute définition comporte en effet des zones d’ombre, une part de flou (volontaire ou non), ainsi qu’une pointe de subjectivité. Néanmoins, établir une définition permet de décrire un concept (ou de tenter de le faire) et, au-delà, d’entreprendre la classification d’objets ou d’observations, classification qui, à son tour, est très souvent un préalable à la compréhension d’un système, de sa formation et de son évolution. En l’occurrence, ici, le Système solaire. En 2006, motivée par la découverte de plusieurs objets transneptuniens, l’Union astronomique internationale (UAI) a ainsi apporté une définition au concept de planète. Cette définition a, comme nous venons de le souligner, une part de subjectivité, ce qui explique que son élaboration ait été assez mouvementée, et qu’elle est susceptible d’être révisée. Par ailleurs, elle se restreint volontairement au cas du Système solaire. Quoi qu’il en soit, la définition de l’UAI comporte trois critères qu’il est important de détailler :
- Une planète est en orbite autour du Soleil. Les satellites naturels des planètes, comme la Lune, Ganymède ou Titan, ne sont donc pas des planètes.
- Une planète a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique, ce qui lui confère une forme presque sphérique. Ce critère un peu technique signifie qu’à une profondeur donnée, le poids d’une colonne de roche est compensé (équilibré) par la pression exercée par les roches. Concrètement, cela se produit pour des corps suffisamment massifs, qu’ils soient rocheux ou gazeux. Cela élimine de nombreux petits corps de forme irrégulière ou pas assez sphériques, comme la plupart des astéroïdes et des objets de la ceinture de Kuiper.
- Une planète a nettoyé le voisinage de son orbite. Autrement dit, une planète est suffisamment grosse pour éjecter ou absorber les objets se déplaçant sur des trajectoires proches de son orbite. Cette précision est importante car, comme nous allons le voir, elle est à l’origine du déclassement de Pluton de la catégorie des planètes vers celle des planètes naines, créée pour cette occasion. C’est aussi ce qu’avaient pressenti, sans vraiment le formaliser, les astronomes du xixe siècle lorsqu’ils décidèrent de ne pas ranger Cérès parmi les planètes. Nous y reviendrons également.

Selon la définition de l’UAI formulée en 2006, une planète doit avoir « fait le ménage » aux alentours de son orbite. C’est essentiellement le cas pour les planètes terrestres ainsi que les planètes géantes (dénotées J, S, U et N), mais pas pour Pluton, qui orbite dans la ceinture d’Edgeworth-Kuiper (représentée ici par les points bleus et orange). (© WilyD)
Plus de 5 000 exoplanètes ont été détectées à ce jour. Au regard de cette moisson, le fait que la définition de l’UAI ne concerne que le Système solaire peut sembler un peu trop restrictif. De fait, il est plus que tentant d’étendre cette définition aux exoplanètes. Cela demanderait de remplacer « Soleil » par « étoile parente » dans le 1er critère, modification mineure en apparence. En revanche, la définition de l’UAI est mise en défaut dans (au moins) deux cas de figure : les naines brunes et les planètes vagabondes. Rappelons brièvement que les naines brunes, souvent qualifiées « d’étoiles ratées », sont des objets qui ne sont pas suffisamment massifs pour amorcer la fusion d’hydrogène en hélium, mais qui le sont pour abriter la fusion du deutérium (ou hydrogène lourd, dont le noyau comporte un proton et un neutron) en hélium, qui se produit à des pressions et températures plus faibles. À part cela, les naines brunes remplissent parfaitement les critères de l’UAI, si ce n’est que le Système solaire n’en comporte a priori pas. Ce n’est pas le cas d’autres systèmes stellaires, puisque environ 3 000 naines brunes ont été répertoriées jusqu’à présent. Un amendement possible de la définition de 2006 pourrait préciser qu’une planète ne peut pas être le siège de réactions de fusion thermonucléaire. Reste que, d’un point de vue observationnel, la distinction entre les naines brunes et les planètes géantes gazeuses n’est pas si aisée. Les observations ne font pas apparaître, comme on pourrait s’y attendre, de lacunes (c’est-à-dire l’absence ou un nombre très réduit d’objets) de masse autour de la limite théorique entre naines brunes et géantes gazeuses. Cette limite est généralement fixée à 13 fois la masse de Jupiter, mais elle est sans doute beaucoup plus floue, et, comme le suggèrent certains astronomes, il est peut-être plus sage de ne pas la fixer trop précisément [1].
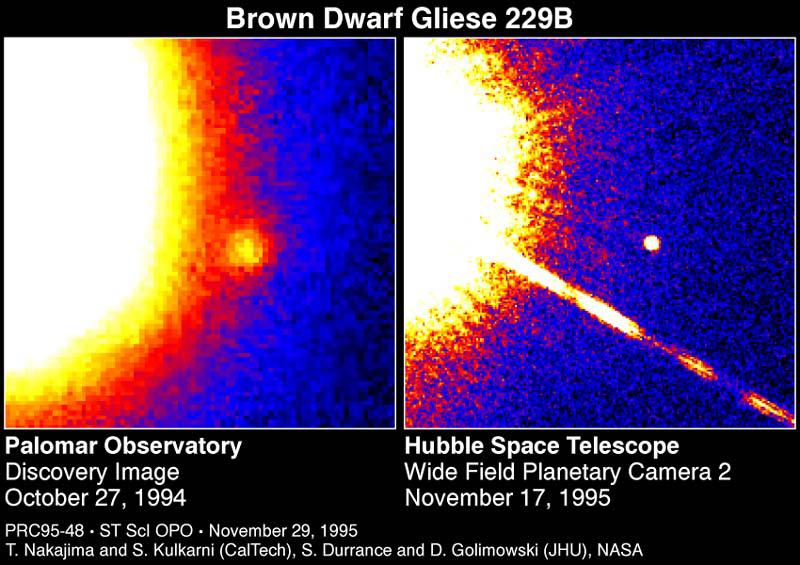
La naine brune Gliese 229b vue par le télescope du Mont Palomar (à gauche), et par le télescope spatial Hubble (à droite). Les naines brunes satisfont globalement aux critères de l’UAI transposés à d’autres étoiles que le Soleil. Pour autant, et contrairement à l’idée que l’on se fait d’une planète, elles abritent des réactions thermonucléaires en leur cœur. (T. Nakajima and S. Kulkarni [CalTech], S. Durrance and D. Golimowski [JHU], NASA)
Détectées dès les années 2000 par imagerie directe ou grâce à la technique des microlentilles gravitationnelles, les planètes vagabondes, comme leur nom l’indique, ne sont pas liées à une étoile hôte [2]. Deux scénarios principaux (et non exclusifs) permettent d’expliquer leur origine. D’une part, les planètes vagabondes pourraient s’être formées dans des systèmes stellaires, tout comme les planètes ordinaires, puis avoir été éjectées de ceux-ci par le jeu de perturbations gravitationnelles. D’autre part, elles pourraient se former directement par effondrement de petits nuages de gaz, c’est-à-dire selon un processus analogue à la formation des étoiles. Quoi qu‘il en soit, un autre amendement à la définition de l’UAI pourrait préciser qu’une planète, même abandonnée par son étoile parente ou orpheline, reste une planète.
Naines brunes et planètes vagabondes montrent, comme on l’a souligné, que définir ce qu’est une planète n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Cela étant, prenons pour acquise la définition de l’UAI, tout en gardant à l’esprit ses limites, et revenons à la question du nombre de planètes dans le Système solaire.
De l’Antiquité au XVIIe siècle : 5 planètes et la Terre
La définition d’une planète étant posée, combien d’objets satisfaisant à cette définition existe-t-il dans le Système solaire ? Comme on s’en doute, la réponse à cette question a évolué au cours du temps. Sans connaître les subtilités de la définition moderne d’une planète, les civilisations anciennes, depuis Babylone jusqu’aux Grecs et aux Romains, avaient identifié 5 objets visibles à l’œil nu et se déplaçant sur un fond d’étoiles fixes. Les Grecs qualifiaient ces objets « d’astres errants » (πλανήτηζ ou planêtês), dénomination qui constitue l’étymologie du mot « planète » dans de nombreuses langues dont, bien évidemment, le français. À ces astres errants il faut ajouter le Soleil et la Lune qui, eux aussi, se déplacent par rapport aux étoiles. Sept objets au total, que les philosophes grecs, dont Platon et Aristote, situaient sur des sphères concentriques, une pour chaque astre (dans l’ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne), centrées sur la Terre et tournant autour de celle-ci. Au iie siècle après J.-C., Claude Ptolémée perfectionna ce système géocentrique en introduisant les épicycles, qui lui permettaient de mieux expliquer les mouvements observés. Par ailleurs, les Romains associaient chacun de ces sept objets à une divinité de leur panthéon, et à un jour de la semaine : le lundi pour la Lune (associée à la déesse Luna, elle-même identifiée à Diane), du mardi au samedi pour les 5 planètes (Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne), et le dimanche pour le Soleil (associé au dieu Sol). Il en reste bien sûr une trace dans le nom des jours de la semaine que nous utilisons, mis à part le samedi et le dimanche qui, en français, ont une origine hébraïque. Dans le monde anglo-saxon, par contre, les deux derniers jours de la semaine restent bien associés à Saturne (Saturday) et au Soleil (Sunday). La Lune est, comme en français, liée au premier jour de la semaine (Monday), mais les 4 jours restants sont associés à des dieux nordiques ou germaniques correspondant plus ou moins aux dieux romains [3].
L’astronomie chinoise répertorie elle aussi 5 astres errants, ou planètes, auxquels elle associe, d’une part, une signification astrologique particulière et, d’autre part, une couleur et un élément de base de la philosophie chinoise [4]. Ainsi, Mercure la noire est associée à l’eau, Vénus la blanche au métal, Mars la rouge au feu, Jupiter la bleue au bois, et Saturne la jaune à la terre ; appellations que le monde chinois utilise aujourd’hui encore pour désigner ces cinq planètes : étoile d’eau (水星), de métal (金星), de feu (火星), de bois (木星) et de terre (土星). Mais surtout, les astronomes chinois ont mesuré avec précision les positions de ces planètes sur de longues périodes, ce qui leur a permis de déterminer qu’elles suivaient des mouvements cycliques et, par extension, de prédire leurs positions à venir. En se basant sur l’écart entre les positions prédites par les observations passées et les positions observées à un instant donné, les astronomes chinois ont progressivement affiné ces trajectoires. Le plus ancien texte connu décrivant les planètes et leurs mouvements est le Wuxingzhan (Divination par les 5 planètes).
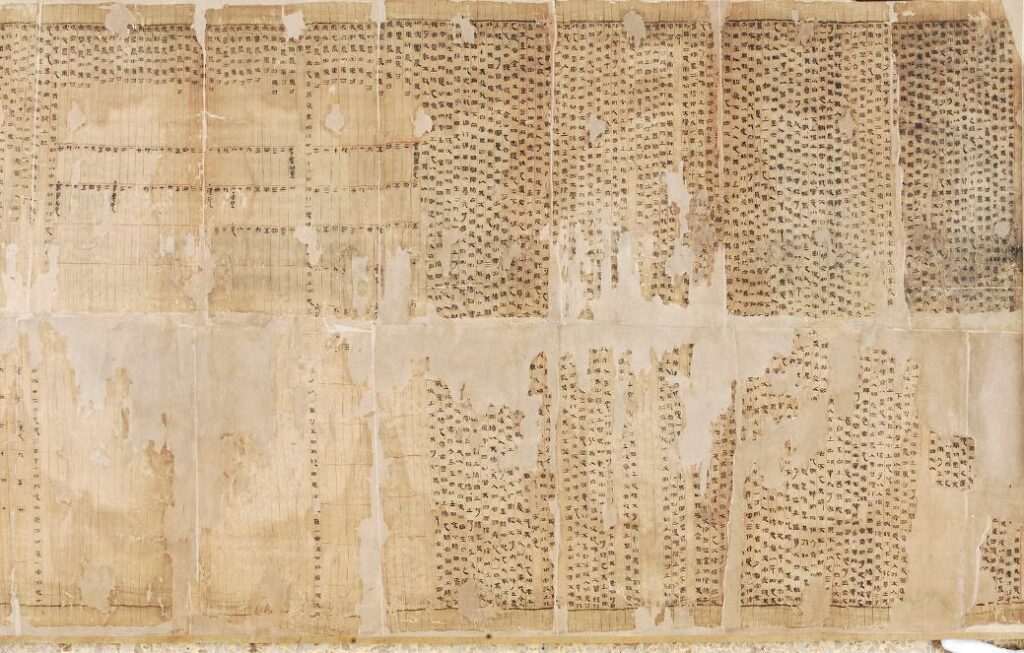
Le Wuxingzhan (« Divination par les 5 planètes »), retrouvé en 1972 dans la tombe de Mawangdui, datée autour de 170 avant J.-C. Ce manuscrit, écrit sur un rouleau de soie, décrit les mouvements de Vénus, Jupiter et Saturne sur une période de 70 ans, entre –245 et –176. (© Hunan Museum)
Il date du début du IIe siècle avant J.-C., et on y apprend, notamment, que les périodes des cycles de Jupiter et de Saturne, c’est-à-dire le temps mis par ces planètes pour revenir en un point précis du ciel, sont d’environ 12 et 30 ans. On retrouve une description détaillée des mouvements planétaires dans « Le livre des officiers célestes », chapitre d’une encyclopédie plus vaste composée par l’historien Sima Qian durant le ier siècle avant notre ère. Ce livre indique en particulier la durée (en jours) pendant laquelle le mouvement d’une planète donnée est prograde (d’ouest en est) ou rétrograde (d’est en ouest), ainsi que la durée pendant laquelle cette planète n’est pas visible.
Le système héliocentrique, selon lequel les planètes tournent autour du Soleil (et non de la Terre), n’ayant pas encore fait son chemin, le monde antique ainsi que la Chine ancienne et l’Occident médiéval sont peuplés de 5 planètes. Il fallut un peu de temps, mais aussi la détermination et les travaux de savants comme Nicolas Copernic, Johannes Kepler et Galilée pour comprendre et faire admettre que la Terre elle-même tourne autour du Soleil (et non l’inverse), et que par conséquent elle est une planète presque comme les autres [5]. Vers le milieu du xviie siècle, le système héliocentrique semblait toutefois admis, si bien qu’un astronome de cette époque pouvait compter 6 planètes (les 5 planètes visibles à l’œil nu plus la Terre) dans le Système solaire. À partir de là, les choses s’accélérèrent.

Le télescope de 7 pieds de William Herschel, c’est avec ce télescope, construit par ses propres soins, qu’il découvrit Uranus le 13 mars 1781. (Wikipedia)
Deux nouvelles planètes et des astéroïdes
Au xviiie siècle, l’idée que la formation de la Terre telle qu’elle est décrite dans la Bible n’est que symbolique se développa, ce qui permit à des savants comme Georges Buffon d’élaborer d’autres scénarios. Dans cette lignée, Emmanuel Kant proposa en 1755 une théorie de la formation du Système solaire à partir d’un disque de gaz et de matière en rotation, thèse qui préfigurait les théories modernes sur ce sujet. Les considérations qu’il développa pour démontrer cette théorie et expliquer comment les planètes et les comètes acquièrent leurs trajectoires l’amenèrent à conclure que d’autres planètes existent peut-être au-delà de Saturne. Intuition brillante, et surtout confirmée un demi-siècle plus tard (en mars 1781) par William Herschel, astronome britannique d’origine allemande, qui découvrit Uranus par hasard, alors qu’il effectuait des relevés pour établir son catalogue stellaire à l’aide de son télescope de sept pieds. Herschel pensa d’abord qu’il s’agissait d’une comète et, sans doute par excès de prudence, continua de le penser pendant encore quelques mois. Les observations réalisées par d’autres astronomes, suite au signalement effectué par Herschel, ne laissèrent toutefois pas de place au doute. Elles montraient en effet que l’objet détecté par Herschel se déplaçait sur une orbite de faible excentricité, ce qui n’est pas le cas des comètes. En 1783, Uranus fut ainsi définitivement admise parmi les planètes du Système solaire, même si le consensus sur son nom fut beaucoup plus lent à établir [6]. À noter que, selon certains travaux historiques, Uranus pourrait avoir été observée dès l’Antiquité, en 128 av. J.-C., par l’astronome grec Hipparque, qui l’aurait prise pour une étoile fixe.

Urbain Le Verrier et un extrait des calculs de perturbation gravitationnelle qui lui permirent de déterminer la position de Neptune.
(© Observatoire de Paris)
Les astronomes se sont toutefois vite aperçus qu’Uranus ne se comportait pas tout à fait comme prévu. Son orbite est irrégulière, c’est-à-dire qu’elle s’écarte de la trajectoire prédite par les calculs basés sur la théorie de la gravitation universelle et tenant compte des planètes connues. Pour expliquer ces anomalies, les astronomes firent alors l’hypothèse qu’une autre planète devait être présente au-delà d’Uranus, et que cette planète inconnue exercerait une très légère attraction sur Uranus. Plusieurs astronomes se lancèrent alors dans des calculs visant à prédire la position de cette éventuelle huitième planète, histoire riche en rebondissements que nous ne détaillerons pas ici. Rappelons simplement que cette recherche fit l’objet d’une âpre controverse entre les astronomes français et anglais. Ces efforts furent néanmoins couronnés de succès puisque, sur la base des calculs d’Urbain Le Verrier, plus tardifs mais aussi plus précis que ceux de John Adam Couch, Johann Galle découvrit Neptune en septembre 1846. Là encore, il semblerait que Neptune ait été observée bien plus tôt par plusieurs astronomes, notamment par Galilée, mais qu’elle ait été considérée comme une étoile fixe. Pour l’histoire des sciences, Neptune restera donc la première planète à avoir été découverte grâce à des calculs de perturbations gravitationnelles. Fort de son succès, Urbain Le Verrier chercha à expliquer les perturbations de l’orbite de Mercure par la présence d’une petite planète, un peu trop précocement nommée Vulcain, entre Mercure et le Soleil. Ces recherches n’aboutirent pas. Et pour cause : on sait aujourd’hui qu’une telle planète n’existe pas, et que les perturbations de l’orbite de Mercure sont une conséquence de la relativité générale, qui ne sera formulée qu’en 1915 par Albert Einstein.
Entre les découvertes d’Uranus et de Neptune, un autre corps a bien failli rejoindre le cortège planétaire du Soleil. Découvert en 1801, Cérès a, dans un premier temps, comblé les supporters de la loi de Titius-Bode, relation mathématique empirique qui permet de déterminer approximativement les distances des planètes au Soleil, mais qui n’a pas de fondement physique. Selon cette loi, une planète devait s’intercaler entre Mars et Jupiter, et c’est précisément dans cet intervalle que Cérès se situe. L’espoir que l’existence de Cérès validerait la loi de Titius-Bode fut vite déçu avec la découverte d’autres petits corps à des distances similaires, notamment Pallas (1802), Junon (1804) et Vesta (1807), découvertes qui poussèrent les astronomes à s’interroger sur le statut de ces petits objets. Dans un premier temps, ils furent considérés comme des planètes à part entière, si bien qu’un manuel d’astronomie des années 1830 pouvait compter jusqu’à 11 planètes dans le Système solaire. Mais vers le milieu du xixe siècle, les discussions aboutirent à la conclusion que ces objets, parfois appelés planètes télescopiques, étaient trop nombreux (plus d’une douzaine en 1850) pour que l’on puisse raisonnablement les faire entrer dans la catégorie des planètes. En revanche, cela a conduit les astronomes à définir une nouvelle catégorie d’objets, les astéroïdes, dont Cérès est le représentant le plus gros. Notons au passage qu’étymologiquement, ce terme, forgé par William Herschel, signifie « qui a l’aspect d’une étoile ». Il reflète ainsi la volonté de distinguer clairement ces nouveaux objets des planètes. Aujourd’hui, on estime le nombre d’astéroïdes de plus d’un kilomètre entre 700 000 et 1 700 000, l’immense majorité d’entre eux orbitant à des distances comprises entre 2,1 et 3,3 unités astronomiques (ua).
Le cas de Pluton et de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper
La présence de Neptune n’a pas permis d’expliquer complètement les perturbations de l’orbite d’Uranus (des calculs plus récents semblent toutefois indiquer que si). Pire, on s’est aperçu que l’orbite de Neptune est elle-même perturbée. Comme dans le cas d’Uranus, la conclusion qui s’est imposée aux astronomes était qu’il devait exister une (ou plusieurs) planète(s) au-delà de Neptune. Camille Flammarion, par exemple, postula l’existence de deux planètes transneptuniennes, qu’il situait à des distances de 100 et 300 ua. Mais c’est surtout l’astronome et mathématicien américain Percival Lowell qui s’illustra dans cette nouvelle quête. En utilisant la méthode développée par Le Verrier, Lowell prédit la présence d’une 9e planète à une distance de 47,5 ua du Soleil. À partir de 1905, l’observatoire de Flagstaff (Arizona), qu’il fit construire en 1894 pour étudier la surface de Mars, fut en partie employé à la recherche d’une 9e planète. Les efforts de Percival Lowell ne furent pas récompensés. Après sa mort, en 1916, il fallut même quelques années avant que les recherches reprennent. Celles-ci aboutirent cependant à la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh, en 1930. Pluton se situe à environ 40 ua du Soleil mais, par rapport aux autres planètes, son orbite est très excentrique (e = 0,250), si bien que son périhélie et son aphélie (ses distances d’approche minimale et maximale au Soleil) sont de 29,6 et 49,3 ua. En fait, sa trajectoire croise celle de Neptune, planète avec laquelle elle est en résonance 3:2, c’est-à-dire que Neptune accomplit trois orbites pendant que Pluton en parcourt deux. Autre particularité, l’orbite de Pluton est très inclinée par rapport au plan de l’écliptique (i = 17,1°). Enfin, si les premières estimations de la taille de Pluton laissaient entrevoir une planète un peu plus petite que la Terre, les mesures d’occultations stellaires réalisées vers la fin des années 1970 ont drastiquement revu cette estimation à la baisse, avec un rayon de seulement 1 200 km (très proche de la valeur mesurée avec la sonde spatiale New Horizons, 1 188 km). À la même époque, les astronomes découvrent que Pluton possède un satellite, Charon [7], ce qui permit de déterminer sa masse, tout juste 2 millièmes de celle de la Terre. Au fil des années, Pluton est donc apparu comme un objet peu massif, petit et se déplaçant sur une trajectoire inhabituelle pour une planète. De quoi se poser des questions.
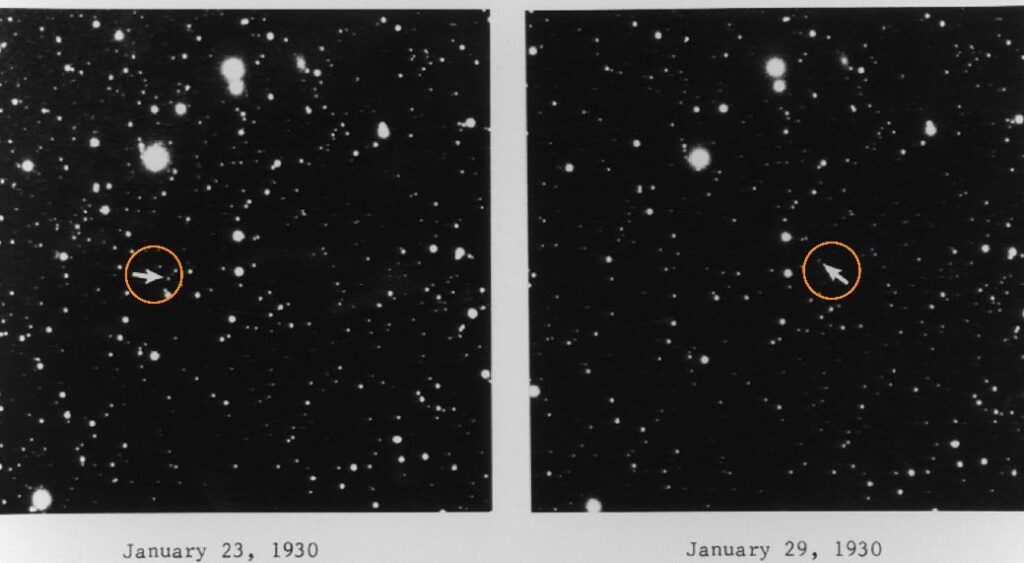
Les plaques photographiques prises par Clyde Tombaugh ayant permis la découverte de Pluton (à la pointe de la flèche) en 1930.
(© Lowell Observatory Archives)
Mais c’est au début des années 1990 que, suite à un bis repetita dont l’histoire des sciences a le secret, les affaires se gâtèrent vraiment pour Pluton. En 1992, deux astronomes américains, David Jewitt et Janet Luu, détectèrent un petit objet, 1992QB1 (renommé par la suite Albion), autour de 45 ua, donc proche de l’orbite de Pluton. Dans les mois et les années qui suivirent, plusieurs autres objets furent observés à des distances comparables. Certains de ses objets, avec des rayons de plusieurs centaines de kilomètres, sont même assez imposants. Mieux, en 2005, Mike Brown découvrit Éris, dont la taille (1 160 km de rayon) est quasiment égale à celle de Pluton, et que certains considérèrent brièvement comme la dixième planète du Système solaire [8]. Voilà qui rappelle les circonstances dans lesquelles Cérès puis la ceinture d’astéroïdes furent découverts, avec, certes, un temps de latence beaucoup plus long. À la vérité, les astronomes soupçonnaient déjà depuis quelques décennies la présence de nombreux petits corps dans cette partie du Système solaire, aujourd’hui connue sous le nom de ceinture d’Edgeworth-Kuiper, qui s’étend entre 30 et 50 ua [9]. Dès les années 1940, Kenneth Edgeworth avait en effet émis l’hypothèse que le matériau formé au-delà de Neptune, trop espacé et en trop petite quantité, n’avait pas pu se rassembler pour former une planète, et qu’il devait donc subsister à ces distances un disque de petits corps très primitifs. Un peu plus tard, Gerard Kuiper suggéra que la plupart des objets de ce disque primitif avaient été dispersés et éjectés plus loin dans le Système solaire sous l’effet de perturbations gravitationnelles exercées par Pluton, que l’on pensait beaucoup plus massif à l’époque. La détection de petits objets dans l’environnement de Pluton est venue confirmer l’hypothèse de Kenneth Edgeworth et invalider celle de Gerard Kuiper.
Assez logiquement, la présence de ces petits objets amena aussi l’UAI à se réunir pour élaborer une définition aussi précise que possible de ce qu’est une planète. Le troisième critère de cette définition, que l’on a rappelé au début de cet article, exclut de facto Pluton de la catégorie des planètes. Depuis 2006, on ne compte ainsi plus que 8 planètes dans le Système solaire. En guise de lot de consolation, l’UAI a créé la catégorie des planètes naines dans laquelle Cérès et trois objets de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper (Éris, Hauméa et Makémaké) sont venus rejoindre Pluton. Pluton a par ailleurs fait l’objet d’une mission spatiale dédiée, New Horizons, mission conçue alors que Pluton était encore rangé parmi les planètes et lancée l’année même de son déclassement. Et comme pour faire un pied de nez aux scientifiques qui l’ont rétrogradé, Pluton s’est révélé être un monde incroyablement riche d’un point de vue géologique.
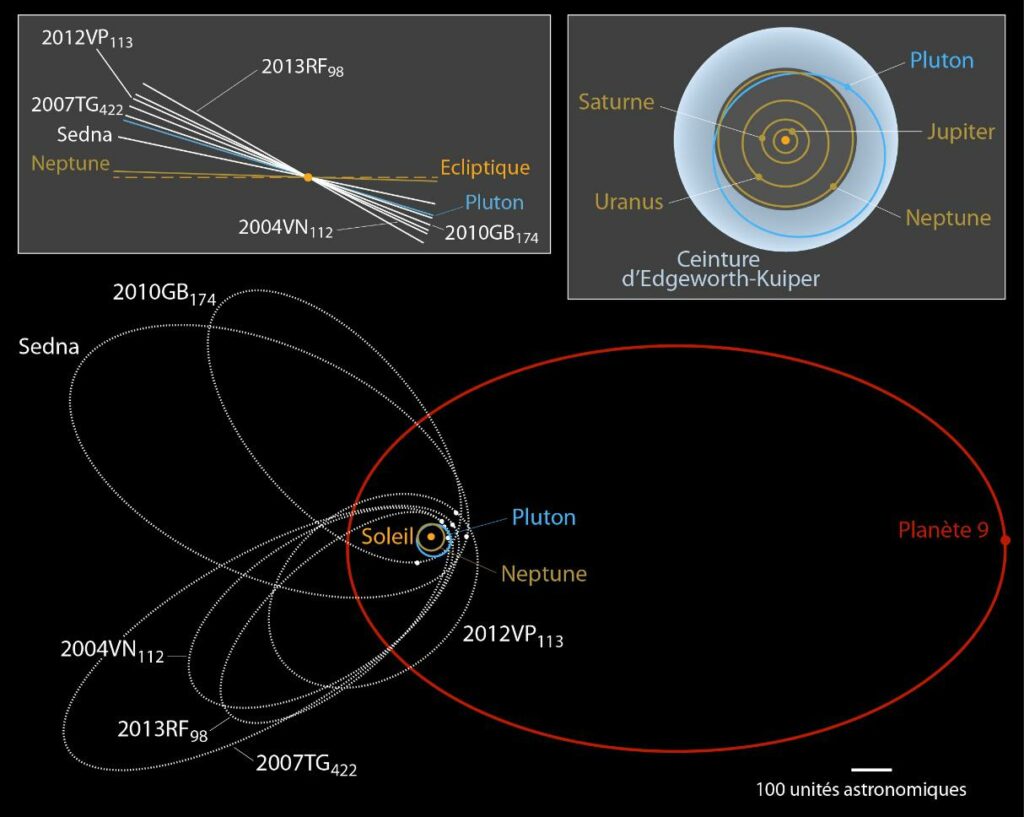
Orbites de 6 objets détachés de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Les fortes inclinaisons de ces orbites (cartouche en haut à gauche) et la concentration des périhélies dans un secteur restreint du Système solaire pourraient être le résultat de perturbations gravitationnelles exercées par une neuvième planète située au-delà de la ceinture de Kuiper. L’orbite possible d’une hypothétique neuvième planète est indiquée en rouge. Le cartouche en haut à droite fait un zoom sur le Système solaire externe.(© F. Deschamps)
Une neuvième planète, en fin de compte ?
La mise en évidence de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper a eu une autre conséquence. Parmi les objets la peuplant se trouvent les objets détachés, ou épars, ainsi dénommés car ils circulent sur des orbites très excentriques dont les périhélies se situent à plus de 35 ua et les aphélies peuvent largement dépasser 100 ua. Cela les amène bien au-delà de la limite externe de la ceinture de Kuiper classique, fixée à 50 ua. Autre particularité, les orbites de ces objets sont, comme celle de Pluton, très inclinées par rapport au plan de l’écliptique. L’objet épars le plus connu est sans doute Sedna, dont le diamètre atteint quasiment 1 000 km, et dont le périhélie et l’aphélie se situent respectivement à 76 et 937 ua. Les astronomes se sont rendu compte que les orbites de certains objets épars, dont Sedna, étaient confinées dans un secteur du ciel relativement restreint. Plus précisément, c’est l’argument du périhélie (c’est-à-dire l’angle entre les directions du nœud ascendant et du périhélie) de ces orbites qui se concentre autour d’une valeur particulière, configuration qui a peu de chance d’être le simple fruit du hasard. En revanche, cette configuration pourrait résulter de perturbations gravitationnelles induites par un objet relativement massif orbitant au-delà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Autrement dit, une neuvième planète très lointaine. Selon certains calculs, cette neuvième planète, si elle existe, pourrait avoir une masse de 5 à 15 masses terrestres, et se déplacerait sur une orbite de demi-grand axe compris entre 400 et 800 ua.
La présence d’un objet de cette taille aussi loin du Soleil pose toutefois une autre question : à cette distance, la quantité de matériau disponible pour fabriquer une planète est limitée, et il est peu probable qu’une grosse planète puisse s’y former. Mais selon certains astronomes, il est possible qu’une telle planète se soit formée plus près du Soleil, en deçà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, avant d’être éjectée sur son orbite actuelle par des perturbations gravitationnelles induites par la migration de Neptune et d’Uranus vers l’extérieur du Système solaire. Quoi qu’il en soit, depuis quelques années, plusieurs équipes d’astronomes se sont lancées à la recherche d’une éventuelle neuvième planète. La tâche n’est pas simple, mais elle n’est pas hors de portée des instruments actuels, notamment du télescope Subaru installé sur l’île de Mauna Kea (Hawaï) et, dans le domaine infrarouge, du satellite WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer).
Le Système solaire et au-delà
Au fil du temps, l’image que l’on s’est faite du Système solaire, notre connaissance de sa formation, de sa structure, des objets qui le peuplent et de la nature de ces objets, ont beaucoup évolué. Par conséquent, le nombre de planètes connues a, lui aussi, changé. À ce jour, et selon les critères définis en 2006 par l’Union astronomique internationale, 8 planètes ont été détectées dans le Système solaire. Mais la possibilité qu’une neuvième planète soit présente bien au-delà de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper est bien réelle.
Pour conclure, comment ne pas évoquer une aventure scientifique qui a débuté il y a à peine un quart de siècle, et qui ne fait sans doute que commencer : la détection de systèmes planétaires autour d’autres étoiles. Comme nous l’avons dit, plus de 5 000 exoplanètes ont été détectées jusqu’à présent. Elles orbitent autour de près de 4 000 étoiles, et 800 d’entre elles possèdent deux planètes ou plus. Pour l’instant, le record est détenu par Kepler-90, une étoile un peu plus massive que le Soleil, avec… 8 planètes, dont 2 géantes gazeuses. Kepler-90 pourrait être détrônée par t Ceti, une proche voisine située à seulement 12 années-lumière de nous, légèrement moins massive que le Soleil, et qui, selon certaines études, abriterait 9 ou 10 planètes, ainsi qu’un disque de débris analogue à la ceinture d’Edgeworth-Kuiper. Toutefois, dans ces deux systèmes, et mis à part le disque de débris de t Ceti, les cortèges planétaires sont confinés dans des espaces relativement réduits, de l’ordre de 1 à 2 ua. Pour le moment, notre Système solaire, avec sa configuration de 8 planètes s’échelonnant entre 0,4 et 30 ua, semble unique. L’avenir nous dira sans doute s’il s’agit là d’un biais observationnel ou si le Système solaire est réellement un cas singulier, ou pour le moins très rare.
par Frédéric Deschamps, IESAS, Taipei, Taïwan

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°184
- Selon certaines études, une lacune pourrait exister autour de 25 masses de Jupiter. Toutefois, d’autres contraintes observationnelles demeurent, y compris l’incertitude sur les mesures, ce qui complique la définition d’une masse limite. Lire à ce sujet Schneider J. et al., « Defining and cataloging exoplanets: the exoplanets.eu database », Astronomy & Astrophysics, 532, A79, 2011, doi: 10.1051/0004-6361/201116713.
- Voir à ce sujet l’article de Núria Miret-Roig dans le numéro 167 (janvier 2023) de l’Astronomie.
- Par exemple, Thor, le dieu nordique du tonnerre équivalent de Zeus, a donné « Thursday », et Tiw, dieu germanique de la guerre, est à l’origine de « Tuesday ».
- On trouvera plus de détails sur l’observation des planètes par les astronomes chinois dans le livre de Jean-Marc Bonnet-Bidaud 4 000 ans d’astronomie chinoise paru aux éditions Belin.
- « Presque », car, comme le rappelle le Petit Prince, « la Terre n’est pas une planète ordinaire ». C’est notre planète.
- Il faudra en effet attendre plus de 60 ans… Précisons que dans la mythologie romaine (grecque), Uranus (Ouranos) est le père de Saturne (Cronos) et donc le grand-père de Jupiter (Zeus).
- Quatre autres satellites, Hydre, Nix, Kerbéros et Styx, beaucoup plus petits, seront découverts par la suite.
- À noter qu’Éris se déplace sur une orbite très excentrique (e = 0,436) dont le périhélie (38,3 ua) se situe dans la ceinture d’Edgeworth-Kuiper, mais dont l’aphélie se trouve bien au-delà (97,5 ua), ce qui en fait un objet épars.
- La découverte de la ceinture d’Edgeworth-Kuiper et le déclassement de Pluton sont racontés, de façon très personnelle, dans le livre de Mike Brown, How I killed Pluto, and why it had it coming (Comment j’ai tué Pluton et pourquoi il l’a mérité).

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur
De grands progrès ont été faits depuis une quinzaine d’années dans la compréhension de la formation des étoiles, surtout de celles de faible masse. Ils sont résumés dans cet article, qui décrit aussi l’évolution ultérieure de ces étoiles.

Les étoiles résultent de l’effondrement, sous l’effet de leur propre gravité, de nuages de gaz et de poussières interstellaires. Cela pose plusieurs questions : où cet effondrement se produit-il ? Est-il spontané ou déclenché par une cause extérieure, et laquelle ? Comment se passe-t-il ? Comment est-il affecté par des facteurs physiques comme les mouvements dans le nuage initial et le champ magnétique qu’il contient ? Quelles sont les étapes qui conduisent à l’étoile « adulte » ? C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre.
Où les étoiles se forment-elles ?
L’observation montre que les nuages interstellaires les plus froids sont le siège de la formation d’étoiles de faible masse (inférieure à quelques masses solaires), que l’on observe d’abord en infrarouge lorsqu’elles sont encore à l’intérieur du nuage, puis qui apparaissent en lumière visible lorsque celui-ci se dissipe. Les nuages géants, comme celui qui se trouve derrière la nébuleuse d’Orion, sont plus chauds et forment des étoiles de toutes masses. On peut y observer les étoiles en formation les plus massives, encore immergées dans leur nuage parent, comme des sources infrarouges très brillantes : un exemple est l’objet de Becklin-Neugebauer (du nom de ses découvreurs en 1967), qui est l’astre le plus lumineux du ciel après le Soleil dans l’infrarouge moyen ; c’est une étoile en formation, une protoétoile, d’environ 15 masses solaires. Ces proto-étoiles massives se manifestent également par des phénomènes secondaires, dont les plus remarquables sont les émissions radio très intenses des molécules OH à 18 cm de longueur d’onde et H2O à 1,35 cm.
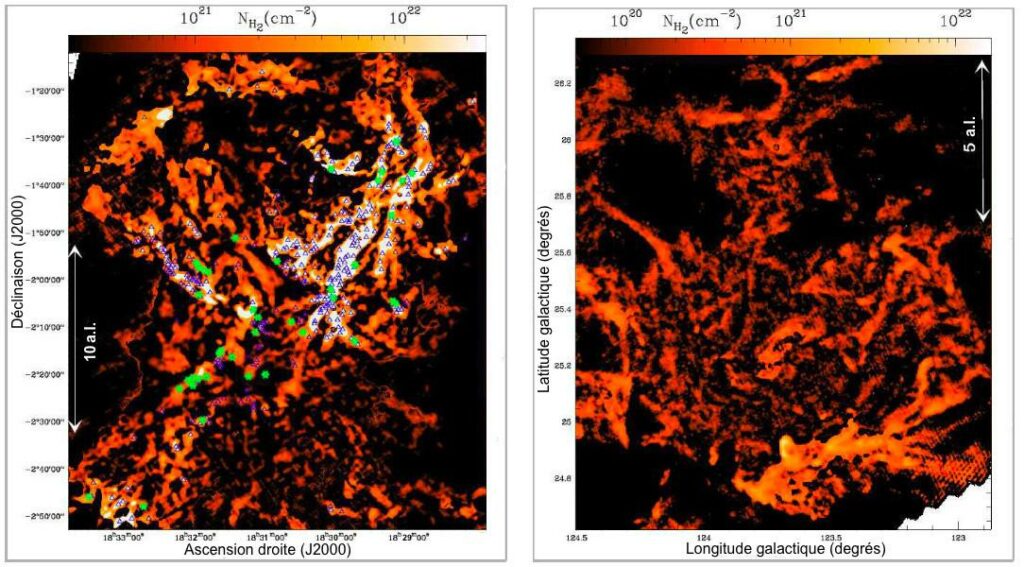
1. Matière interstellaire et formation d’étoiles dans deux champs (Aquila-Serpens à gauche et près de l’étoile Polaire à droite). La distribution de la matière interstellaire (ici surtout de l’hydrogène moléculaire H2) a été obtenue à partir d’observations dans l’infrarouge lointain de l’émission de la poussière qu’elle contient également, par le satellite Herschel. Le contraste a été artificiellement augmenté dans ces images pour bien faire apparaître les filaments. Les étoiles en formation sont indiquées par des cercles verts, et les condensations qui vont bientôt former des étoiles par des triangles bleus. L’échelle de couleur au-dessus des images donne le nombre de molécules d’hydrogène dans une colonne de 1 cm2 de section. Comme les filaments ont un diamètre assez constant, de l’ordre de 10 000 années-lumière, on peut estimer leur masse par unité de longueur, et on constate que la formation d’étoiles dans Aquila-Serpens est possible là où cette quantité est supérieure à une certaine valeur critique. Cette valeur n’est pas atteinte dans la région de la Polaire, où les étoiles ne peuvent donc pas se former. (D’après André P. et al., Astronomy & Astrophysics 518, 2010, L102)
Regardons de plus près ces nuages interstellaires. Ce ne sont pas en général des structures plus ou moins sphériques : ceux où ne se forment que des étoiles de petite masse sont plutôt des filaments irréguliers. La figure 1 en montre deux exemples et la figure 2 est une vue plus détaillée de la formation d’étoiles dans une partie du champ de la figure 1. La théorie, bien vérifiée par l’observation, montre que l’effondrement sur elles-mêmes de portions de ces filaments pour former des étoiles devient possible lorsque leur masse par unité de longueur du filament est supérieure à une valeur critique, telle que la gravité devient supérieure à la force de pression qui maintenait le filament à l’équilibre. Cette valeur critique est estimée à Mcrit = 2Gcs2, où G est la constante de la gravitation et cs la vitesse du son dans le gaz du filament, laquelle dépend de sa température. Celle-ci est de l’ordre de 10 K (degrés absolus), et on trouve que la masse critique par année-lumière de longueur est de l’ordre de 4 masses solaires.
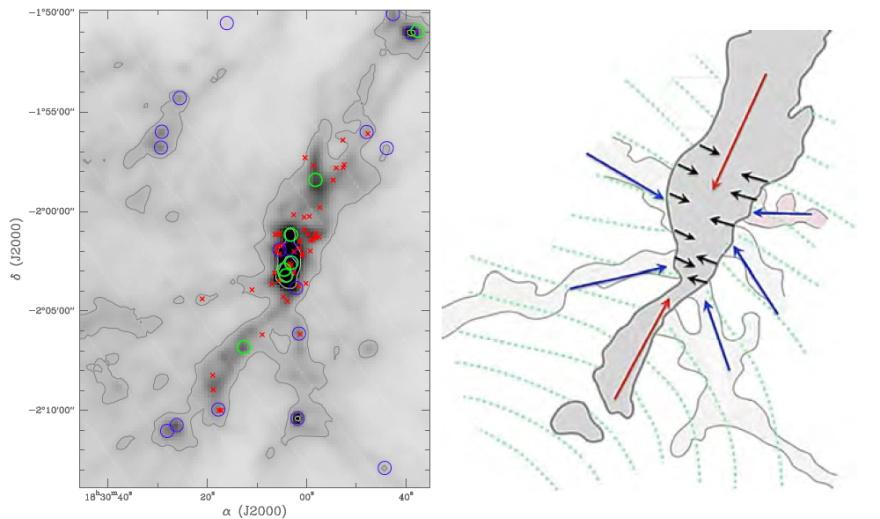
2. Formation d’étoiles dans le filament central de la figure 1 de gauche (voir p. 33). Ci-contre, à gauche, la distribution de la matière interstellaire est obtenue par la mesure avec le satellite Herschel de l’émission de la poussière dans l’infrarouge lointain, à 350 micromètres. Les cercles verts sont des protoétoiles certaines, les cercles bleus des protoétoiles candidates et les croix rouges des étoiles très jeunes. Tous ces objets ne sont visibles que dans l’infrarouge. À droite, les flèches indiquent les mouvements de matière observés par l’effet Doppler-Fizeau sur des raies moléculaires en ondes radio ; les lignes de force du champ magnétique sont marquées en traits pointillés. (D’après Bontemps S. et al., Astronomy & Astrophysics 518, 2010, L85 et Nakamura F. et al., Astrophysical Journal 737:56, 2011)
Le champ magnétique joue-t-il un rôle dans ce processus ? On peut aujourd’hui tracer le champ magnétique dans le milieu interstellaire, grâce à une propriété de très petits grains de poussière interstellaire magnétiques ou paramagnétiques : ils se comportent comme de minuscules aimants, qui tournent comme des toupies autour des lignes de force du champ magnétique et émettent dans l’infrarouge lointain un rayonnement thermique, partiellement polarisé perpendiculairement à la direction du champ magnétique. En observant cette polarisation (et les satellites Planck et Herschel étaient équipés pour cela), on obtient donc la direction du champ magnétique. La figure 3 en montre un exemple. On constate que le champ magnétique est plutôt perpendiculaire aux filaments lorsque ceux-ci sont assez denses, ce qui favorise l’écoulement de la matière interstellaire (laquelle est toujours partiellement ionisée et donc conductrice de l’électricité) le long des lignes de force du champ : cela alimente les filaments, comme on peut le voir figure 2 à droite. Cependant, le champ magnétique ne semble pas affecter beaucoup l’effondrement lui-même qui conduit à la formation des étoiles, car les observations sont en bon accord avec la théorie où on ne le fait pas intervenir.
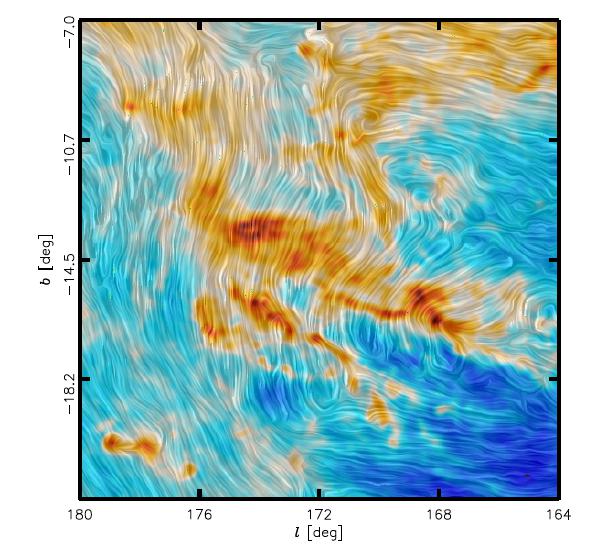
3. Le champ magnétique dans la région du Taureau, observé par le satellite Planck. Les coordonnées sont la longitude galactique l et la latitude galactique b. Les couleurs représentent la densité de colonne de la matière interstellaire, obtenue à partir de l’observation de l’émission de la poussière en ondes submillimétriques. La « draperie » superposée montre l’orientation du champ magnétique. On constate qu’aux faibles densités, le champ magnétique est plutôt aligné avec les structures, tandis que dans les filaments plus denses, il est plutôt perpendiculaire aux filaments, ce qui favorise la chute de matière sur ces filaments. (D’après Planck Collaboration, Astronomy & Astrophysics 586, A138, 2016)
Alors que la formation des étoiles de petite masse qui vient d’être décrite a surtout lieu dans les filaments interstellaires et est spontanée, celle des étoiles de grande masse, qui est toujours accompagnée de formation d’étoiles moins massives, se produit dans de grands nuages plus chauds et semble généralement nécessiter une action extérieure. On a cité plus haut le cas du nuage situé à l’arrière de la nébuleuse d’Orion, chauffé par le rayonnement des étoiles O, jeunes et massives, du Trapèze, et où se forment des étoiles de toutes masses. Un autre exemple est celui d’un nuage associé à la nébuleuse de la Rosette (fig. 4). L’augmentation de pression qui résulte de l’ionisation et des vents produits par les étoiles chaudes, ou de l’onde de choc qui borde le reste en expansion des supernovæ, ou même à plus grande échelle le passage d’un bras de spirale, pendant lequel le gaz est comprimé, sont les déclencheurs de l’effondrement des parties les plus denses du milieu interstellaire.
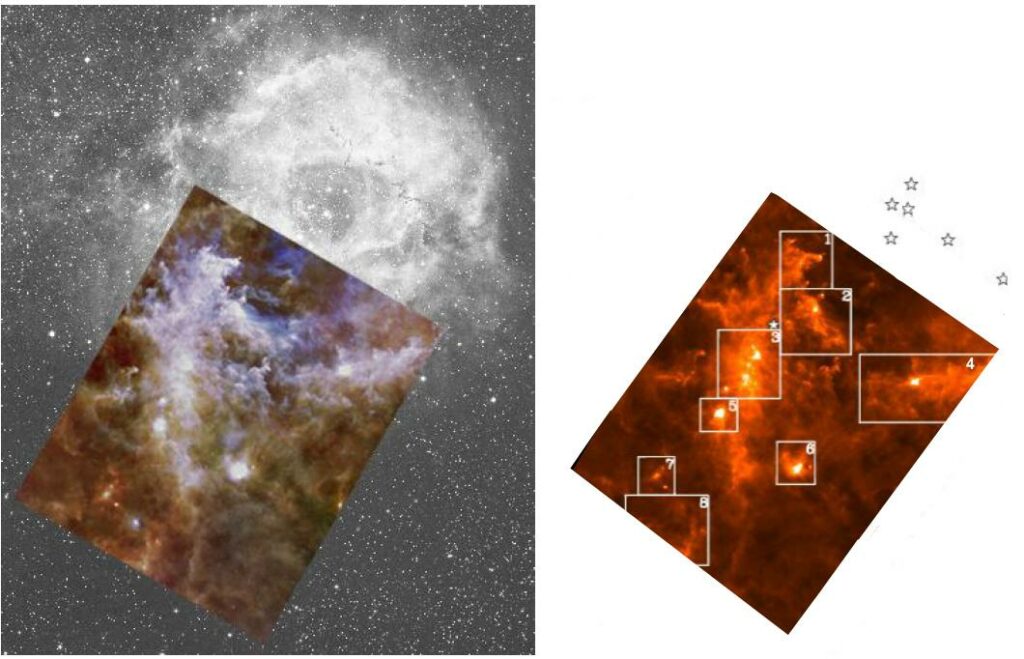
4. Formation contagieuse d’étoiles dans la nébuleuse de la Rosette (NGC 2244), observée avec le satellite Herschel.
À gauche, image en infrarouge lointain de l’émission des poussières interstellaires à 70 mm (bleu), 160 mm (vert) et 500 mm (rouge), superposée à une image visible en noir et blanc. À droite, image du même champ à 250 mm montrant les zones de formation stellaire, où des concentrations de matière de 20 à 160 masses solaires sont visibles comme des points brillants. C’est là que se formeront les étoiles. Les étoiles O qui ionisent la nébuleuse sont indiquées au- dessus. (D’après Schneider N. et al., Astronomy & Astrophysics 518, L83, 2010)
L’effondrement du nuage initial
Les condensations dans le gaz interstellaire peuvent s’effondrer spontanément sous l’effet de leur propre gravité lorsque leur masse est supérieure à une certaine quantité, nommée masse de Jeans, du nom de l’astronome anglais James Jeans (1877-1946), qui a le premier étudié ce problème : par exemple, dans un nuage moléculaire à la température de 10 K avec une densité de 5 000 molécules d’hydrogène par centimètre cube, la masse de Jeans est de l’ordre d’une dizaine de masses solaires. Mais, comme nous venons de le voir, une augmentation de la pression extérieure peut favoriser cet effondrement. Le nuage peut aussi se fragmenter, si bien que dans ce cas l’étoile finale n’a pas la masse de Jeans. Ces phénomènes ne sont pas très bien compris, car la présence de turbulence ou d’un champ magnétique vient compliquer la situation. Une fois l’instabilité déclenchée, tout se passe rapidement… à l’échelle astronomique : par exemple, le nuage que nous venons d’évoquer s’effondrerait complètement en 400 000 ans, si deux phénomènes ne venaient pas ralentir et même arrêter la chute.
Tout d’abord, la contraction produit une augmentation de pression qui chauffe le gaz dont est constitué le nuage. Au début, la chaleur peut être évacuée par rayonnement, mais cela ne dure guère, car ce rayonnement a de plus en plus de mal à sortir : le nuage devient vite complètement opaque dans le visible et même dans l’infrarouge proche et moyen. Ensuite, même l’émission des raies moléculaires radio, en particulier celles de la molécule CO, et dans l’infrarouge lointain l’émission de la poussière qui accompagne le gaz ne peuvent plus guère sortir du nuage. Celui-ci est donc de plus en plus chaud : la pression augmente et stoppe l’effondrement de la partie centrale du nuage, le cœur. Celui-ci continue cependant à croître grâce à la chute de la matière qui l’entoure. Si la masse du cœur ainsi alimenté est suffisante, plus de 0,08 fois celle du Soleil, les réactions nucléaires peuvent s’amorcer : une étoile est née. Si elle est plus petite, on a affaire à une étoile avortée, une naine brune. Il apparaît cependant que les fragments opaques ne peuvent aboutir à une étoile, qu’elle soit normale ou avortée, que si leur masse est supérieure à 0,007 masse solaire, soit 7 fois la masse de Jupiter : sinon, ils finissent par se disperser. Ainsi, les planètes ne peuvent généralement pas être formées par l’effondrement d’un nuage interstellaire, sauf peut-être les plus grosses d’entre elles (la distinction entre très grosses planètes et naines brunes n’est d’ailleurs pas claire).

5. Un disque protostellaire et un jet bipolaire observés dans la région d’Orion avec le télescope spatial Hubble. Du disque, on ne voit que les surfaces éclairées par les étoiles de la région, ses parties internes étant très opaques. Les dimensions de l’image correspondent à 900 × 900 années-lumière. (Nasa et dessin de l’auteur)
Un autre phénomène, que nous avons négligé jusqu’ici mais qui affecte profondément l’effondrement, est la rotation du nuage qui s’effondre : cette rotation, qui paraît être presque toujours présente en raison des mouvements dans le nuage initial et surtout de sa turbulence, produit une force centrifuge qui s’oppose à la contraction sauf le long de l’axe de rotation, et l’objet s’aplatit donc en s’effondrant. S’il tourne trop vite, il peut se scinder et former une étoile double, par un mécanisme dont les détails ne sont pas encore très bien compris. S’il ne tourne pas trop vite, un disque en rotation se forme autour du cœur. C’est sur ce disque que tombe la matière environnante, tandis que la chute de matière sur le cœur, qui fait grossir la proto-étoile, se fait principalement à partir de l’intérieur du disque. Cependant, cette chute est entravée par la force centrifuge dans le disque en rotation, qui s’oppose à la progression de la matière vers l’intérieur. Il faut donc évacuer de l’intérieur du disque, au moins en partie, le moment cinétique de rotation. C’est bien ce qui s’est passé lors de la formation du Système solaire, où l’essentiel du moment cinétique se trouve dans la révolution des planètes tandis que le Soleil ne tourne que lentement sur lui-même.
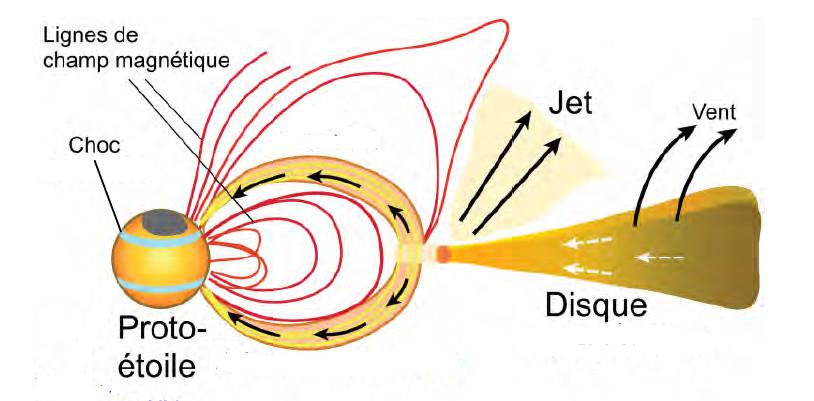
6. Capture de matière du disque par la protoétoile et formation du jet. Le champ magnétique de la protoétoile canalise la matière du disque capturée, qui forme un choc en tombant sur l’objet. Une partie de la matière est expulsée sous la forme d’un jet tournant, qui entraîne avec lui une partie du moment cinétique. Cela diminue donc la vitesse de rotation des parties internes du disque, ce qui permet à la matière de tomber sur la protoétoile, la force centrifuge étant fortement réduite. (Adapté de Hartmann et al., Annual Review of Astronomy & Astrophysics, 54, 135, 2016)
L’observation montre que ce moment cinétique est principalement emporté, avec une partie de la matière, par un jet émis de chaque côté du disque, jet qui est en rotation rapide sur lui-même. De tels jets bipolaires (fig. 5) sont si fréquemment observés qu’ils paraissent être la règle. La théorie montre qu’un champ magnétique est nécessaire pour engendrer le jet (fig. 6). Le jet bipolaire entraîne avec lui une partie du nuage moléculaire résiduel, ce qui ralentit sa propre rotation.
Les jets bipolaires sont quelquefois observables dans le visible, quand l’extinction par ce qui reste du nuage initial n’est pas trop forte. On les observe plus facilement dans l’infrarouge et en ondes radio, où l’extinction ne gêne pas, par l’émission de la poussière et des molécules qu’ils contiennent. À leur extrémité, on voit les régions où la matière avoisinante est comprimée par l’arrivée du jet, formant un choc qui excite le rayonnement de petits objets, les objets de Herbig-Haro, du nom de leurs découvreurs (fig. 7).

7. Un jet bipolaire observé par le télescope spatial Hubble, se terminant à ses extrémités par les objets de Herbig-Haro HH 46, à gauche, et HH 47, à droite. Le jet est déformé par son interaction avec le milieu interstellaire environnant. La longueur de la barre verticale correspond à 1 000 unités astronomiques. L’étoile centrale, à peine visible mais très brillante dans l’infrarouge, est la protoétoile qui a émis le jet, affectée par l’extinction. (Nasa)
L’évolution d’une étoile de 1 masse solaire
La figure ci-dessous (d’après A. Maeder, 2009) montre l’évolution d’une étoile de la masse du Soleil dans un diagramme température-luminosité (échelles logarithmiques). Les lignes d’égal rayon de l’étoile sont indiquées, en rayons solaires, et la position actuelle du Soleil est marquée par un cercle jaune. Le temps à partir de la naissance de l’étoile est indiqué le long de la trajectoire d’évolution, et les moments où commence la fusion du deutérium, du lithium et de l’hydrogène sont en rouge. Le temps initial n’est pas le même ici que dans la figure 8 : il est environ 200 000 ans après, vers la fin de la phase d’évolution correspondant à la classe 1, au moment où la protoétoile devient bien visible et ne capture plus guère la matière du disque. À ce moment, elle a un rayon d’environ 10 fois le rayon du Soleil, et elle se contracte à température de surface sensiblement constante, tandis que sa température centrale augmente, déclenchant la fusion du deutérium D puis du lithium Li (en rouge) : c’est la classe 2, et l’étoile est une T Tauri. Elle atteint pratiquement son rayon final après 10 millions d’années, puis sa température de surface augmente de même que sa température interne, jusqu’à ce que la fusion de l’hydrogène en hélium s’amorce (classe 3). Elle arrive alors, après une centaine de millions d’années, sur la séquence principale, où elle va lentement évoluer pendant 10 milliards d’années, toujours en tirant son énergie de la fusion de l’hydrogène. Lorsque celui-ci est épuisé au centre, sa combustion continue autour d’un noyau d’hélium où il n’y a plus de réactions nucléaires. La production d’énergie augmente progressivement, ce qui occasionne une expansion des couches externes de l’étoile ; l’accroissement rapide du rayon n’est pas suffisamment compensé par l’augmentation de la production d’énergie pour maintenir une température de surface élevée : l’étoile devient une géante rouge plus froide, qui évolue assez rapidement. À l’âge de 13,2 milliards d’années se produit le flash de l’hélium dans le cœur extrêmement dense, dont la matière est dégénérée : ce n’est plus qu’une purée de noyaux atomiques et d’électrons, où la température a atteint un milliard de degrés, et l’hélium s’y transforme en carbone de façon explosive. La structure de l’étoile se réajuste rapidement avec pour conséquence une décroissance de la production d’énergie par fusion de l’hydrogène : la luminosité et le rayon diminuent rapidement (entre les deux étoiles à 4 branches de la figure). L’étoile a alors une structure en couches : autour d’un cœur inerte composé essentiellement de carbone se trouve une épaisse couche d’hélium qui fusionne en éléments plus lourds près du cœur, couche au-dessus de laquelle l’hydrogène continue à se transformer en hélium. L’énergie produite par la fusion de l’hélium fait que l’étoile redevient une géante en suivant une trajectoire semblable à celle effectuée précédemment : on l’appelle branche asymptotique ou AGB (de l’anglais Asymptotic Giant Branch). La fusion de l’hélium devient instable si bien qu’il se produit des impulsions thermiques (phase TP-AGB, TP pour Thermal Pulses), lesquelles occasionnent d’importantes pertes de masse. L’étoile se retrouve finalement sous la forme de son cœur très chaud, dont le rayonnement ultraviolet ionise la matière expulsée : c’est une nébuleuse planétaire. L’étoile centrale termine sa vie comme naine blanche.
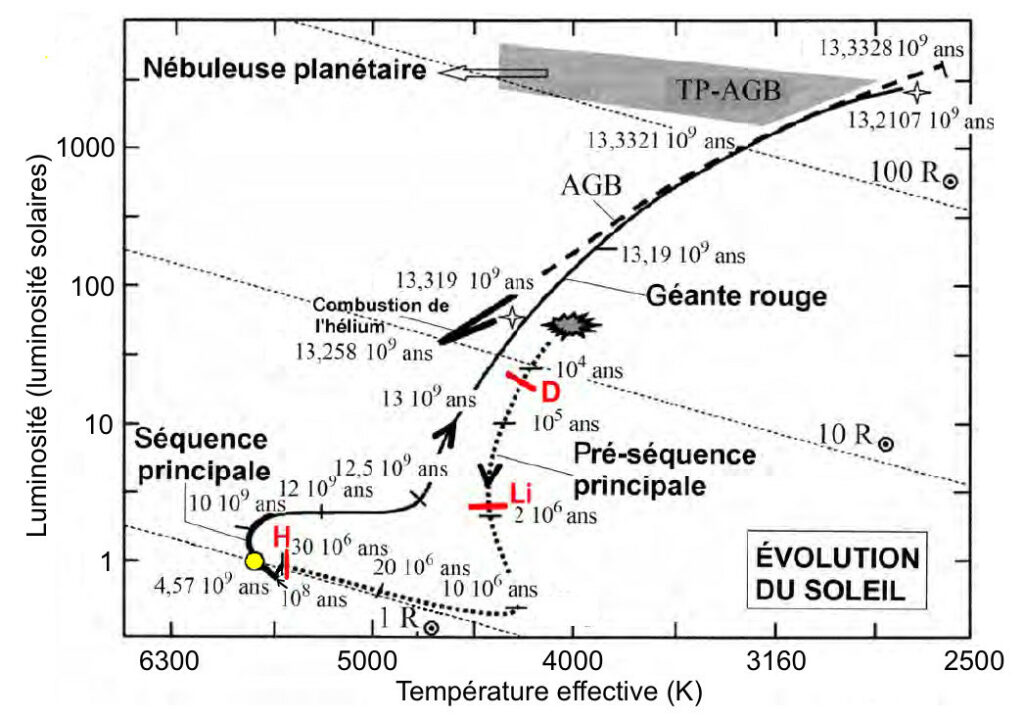
Les différentes étapes de la formation des étoiles
Les étapes de l’évolution de la protoétoile vers l’étoile finale sont aujourd’hui bien connues, au moins pour les étoiles de masse faible ou moyenne, sous la forme de quatre classes illustrées par la figure 8.
La classe 0 correspond au stade où la protoétoile est généralement inobservable dans le visible et même dans l’infrarouge proche et moyen, car elle est cachée par la matière qui s’effondre, qui est très opaque : on ne détecte en général que le rayonnement de la poussière de cette matière, qui émet en ondes submillimétriques et millimétriques. C’est à ce stade que la proto-étoile acquiert l’essentiel de sa masse, et qu’un jet bipolaire se forme. La capture de matière par la protoétoile paraît très fluctuante au cours du temps ; les épisodes où elle est très intense correspondent à des objets qui peuvent être temporairement très lumineux, même dans le visible. On les nomme FU Orionis, du nom de leur prototype dont la magnitude a augmenté de 16,5 à 9,6 en 1937 ; elle s’affaiblit lentement depuis.
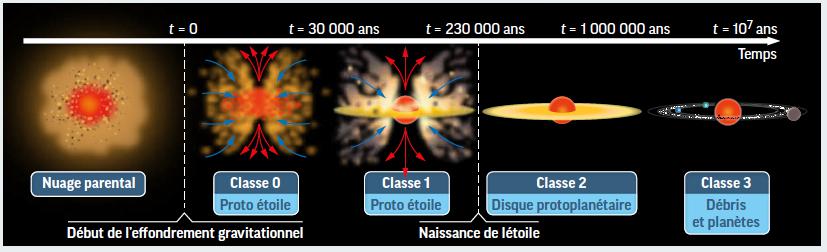
8. L’évolution d’une protoétoile depuis l’effondrement initial jusqu’à l’étoile complètement constituée est décrite sous la forme de quatre classes. L’échelle de temps correspond à une étoile de masse approximativement solaire. (D’après Philippe André)
La classe 1 correspond à des objets beaucoup plus lumineux en moyenne que ceux de la classe 0. Ils émettent dans tout l’infrarouge. Le nuage primordial est en voie de disparition, révélant la protoétoile et son disque circumstellaire. La chute de matière a beaucoup diminué, ainsi que le jet bipolaire.
Dans la classe 2, l’étoile est complètement formée, avec un rayon initial 10 fois plus grand que celui de l’étoile finale et en conséquence une luminosité plus élevée. Elle se contracte progressivement ; la température centrale augmente et les réactions nucléaires s’y amorcent par la fusion du deutérium à 1 million de degrés, puis du lithium à une température un peu plus élevée. La température de surface varie peu, et la luminosité diminue. Le disque circumstellaire est encore important, mais le jet a disparu. Ce stade correspond aux étoiles dites T Tauri, du nom de leur prototype. Elles sont très variables, et leur spectre montre de fortes raies d’émission, produites par le gaz du disque excité par le rayonnement de l’étoile.
La classe 3 correspond à une étoile qui a presque atteint son rayon final. Sa température de surface croît, et son cœur atteint trois millions de degrés, ce qui va permettre la fusion de l’hydrogène. Elle parvient alors sur la séquence principale, où elle passera l’essentiel de sa vie. Son rayonnement a chassé le gaz des parties centrales du disque, où ne subsistent que des débris solides et où se formeront les planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars, tandis que les planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se formeront plus loin, là où il reste du gaz… Mais cela est une autre histoire que nous ne détaillerons pas ici (voir l’Astronomie, juillet-août 2018, p. 28-35).
par James Lequeux, Observatoire de Paris-PSL

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°181
Pour en savoir plus
Lequeux J. Naissance, évolution et mort des étoiles, EDP Sciences, Les Ulis, 2011.

par Sylvain Bouley | Juil 26, 2024 | Zoom Sur
La vie de l’astronome chinois Cheng Maolan (1905-1978) est étroitement liée à la naissance de l’astrophysique observationnelle française et chinoise. Il passa trente ans de sa vie en France avant de retourner dans sa patrie, traversant ainsi des événements majeurs de l’histoire du xxe siècle. Mais il faudra patienter quarante ans après sa mort pour qu’il devienne un « héros de la nouvelle Chine ».
Nous sommes en 1905, à Shawo, petit village niché dans la campagne chinoise à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Pékin (aujourd’hui Beijing). C’est là que naît un garçon, le 18 septembre, au sein de la famille Tcheng. Son père, à la fois petit propriétaire terrien et charpentier, le nomme pour lui porter bonheur « Mao Lin » : Mao signifie « prospère, prospérité », Lin veut dire « fleur évoquant l’orchidée », image évoquant « l’abondance» . Hélas, comme nous le verrons, Tcheng Mao Lin (程 = Tcheng, 茂 = Mao, 蘭 = Lin en écriture traditionnelle), devenu Cheng Maolan en transcription moderne, ne connaîtra ni l’une ni l’autre.

Famille chinoise à la campagne dans les années 1900. (Cliché T. Montmerle)
Dans la Cité interdite, l’impératrice douairière Tseu-Hi (Cixi) règne d’une main de fer, mais l’Empire vacille. Sous les coups de boutoir des puissances occidentales (dix pays y compris la Russie tsariste), et du Japon, les ressources de la Chine sont littéralement pillées. En 1901, un traité humiliant la punit d’une indemnité énorme (équivalente à dix milliards de dollars aujourd’hui), en réparation des dommages causés aux légations étrangères à Pékin par la « révolte des Boxers ». Inondé d’opium indien par les Anglais depuis des décennies, le pays est au bord du gouffre.
Le réveil chinois et le Mouvement Travail-Études
Mais une relève semble s’organiser autour de l’idée d’abattre le régime impérial et d’instaurer une république, en s’inspirant d’idées venues de l’étranger. D’une part, la « modernisation » (à l’occidentale) du Japon de l’ère Meiji, entamée en 1868, attire de nombreux étudiants chinois, et d’autre part, des idées nouvelles sont importées d’Europe, notamment issues des mouvements anarchistes de pays comme la France ou la Russie. C’est dans cette mouvance que s’inscrit un personnage central pour le destin de Cheng Maolan, Li Shizeng (Li Yuying).

Li Shizeng (1881-1973), fondateur du Mouvement Travail-Études. (Bibliothèque municipale de Lyon, fonds de l’Institut franco-chinois de Lyon. Didier Nicole BML)
Celui-ci, élevé dans une famille cultivée proche de la Cour, part à Paris en 1902 en compagnie d’amis chinois fermement opposés au régime impérial et attirés par les idées anarchistes. L’un d’eux avait rencontré Sun Yat-sen, alors en exil (premier, quoique éphémère, président de la république de Chine dix ans plus tard). Il convainquit Li Shizeng de rejoindre son mouvement, appelé la Ligue jurée en France. Ce fut le début d’une longue et passionnante histoire de contacts entre la France et la Chine, évidemment trop longue pour être racontée ici, mais dont un épisode décida du destin de Cheng Maolan : Li Shizeng créa en 1908 le Mouvement Travail-Études, dont le but était de faire venir en France des centaines d’ouvriers chinois, à la fois en leur trouvant un emploi et en les instruisant, pour les familiariser avec un environnement « progressiste » (par rapport à la Chine) qu’ils développeraient à leur retour. Mais dans le contexte économique difficile suivant la Grande Guerre, et notamment un chômage important, Li Shizeng avait de plus en plus de mal à trouver du travail pour les ouvriers chinois qu’il recrutait, et le Mouvement Travail-Études dut cesser ses activités en 1920.
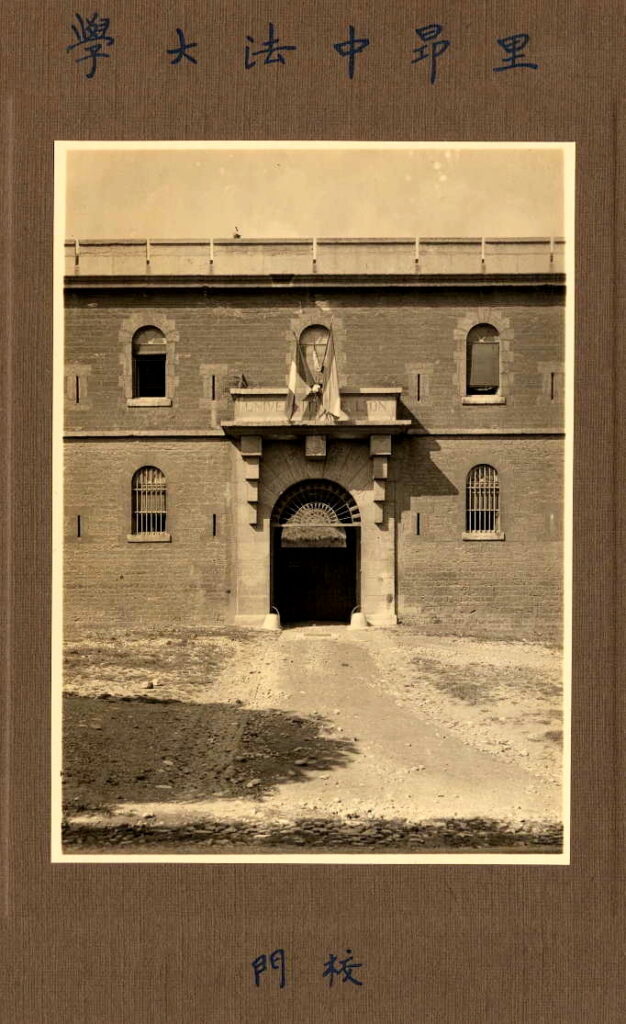
Cette porte austère existe encore aujourd’hui, avec la même inscription gravée en majuscules : « Université de Lyon » (ici derrière les drapeaux) et « Institut franco-chinois » (au-dessus de la porte). (Crédit : IFCL)
Néanmoins, grâce à ses relations tant en France qu’en Chine, Li Shizeng proposa une nouvelle formule, sans doute aussi plus adaptée aux besoins de la jeune république de Chine qui avait vu le jour le 1er janvier 1912, à savoir la création d’un établissement franco-chinois d’enseignement supérieur, ouvert sur concours aux étudiants chinois (et aux étudiantes, une première à l’époque) de niveau universitaire. Un tel établissement serait financé par les gouvernements des deux pays, de grandes universités en Chine (Shanghaï, Pékin, etc.), et pour la France, en puisant en partie dans… sa part de l’indemnité des Boxers ! Après moult négociations, la ville de Lyon, qui avait une longue tradition de liens avec la Chine autour du commerce de la soie, fut choisie pour abriter cet établissement. Sa finalité était de contribuer à la création d’une élite scientifique et économique chinoise, qui entretiendrait des relations privilégiées avec la France. Afin de loger les étudiants et les étudiantes, le ministère de la Guerre fournit un ensemble de bâtiments désaffectés, le fort Saint-Irénée. Situé sur les hauteurs de la ville, à l’ouest de la Saône, ce fort se trouvait aussi par coïncidence à quelques kilomètres seulement au nord de Saint-Genis-Laval, site de l’observatoire de Lyon, fondé en 1878.
L’Institut franco-chinois de Lyon
C’est ainsi que naquit, en 1921, l’Institut franco-chinois de Lyon (IFCL). C’était à l’époque le seul établissement ayant rang d’université en dehors de la Chine, dont Cheng Maolan fut, et comme nous le verrons dans des conditions difficiles, pensionnaire pendant près d’une vingtaine d’années !
Mais n’anticipons pas. Comment se fait-il que Cheng Maolan, issu d’un milieu rural, ait pu avoir connaissance d’un programme faisant venir en France de jeunes Chinois, alors que (s’ils en avaient les moyens) le choix d’une formation à l’étranger à cette époque se portait plutôt vers le Japon ou les États-Unis ? Sans qu’on le sache avec certitude, il est vraisemblable que Cheng Maolan ait fait ses études secondaires à Baoding, la « grande ville » voisine de sa commune. Or, c’était aussi à proximité de cette ville, à Gaoyang, qu’était né Li Shizeng, qui y avait même fondé, dès avant la Première Guerre mondiale, une école préparatoire pour les ouvriers volontaires désireux de partir en France dans le cadre du Mouvement Travail-Études. Avec la création de l’IFCL, l’école préparatoire, de niveau « post-bac » et délivrant un cursus de six mois, déménagea dans les environs de Pékin, mais Cheng Maolan devait forcément connaître son existence. Le hic, c’est que la nouvelle école était payante… Or, sa réputation (et celle du jeune IFCL) devait être grande, car Cheng Maolan put convaincre son père de vendre une parcelle de terrain pour financer ses études, et probablement son voyage, assorti d’un peu d’argent de poche. Nous sommes alors en 1925, il passe son examen de sortie avec succès. Il a 20 ans, et il ne sait pas qu’il ne reverra la Chine que trente-deux ans plus tard.
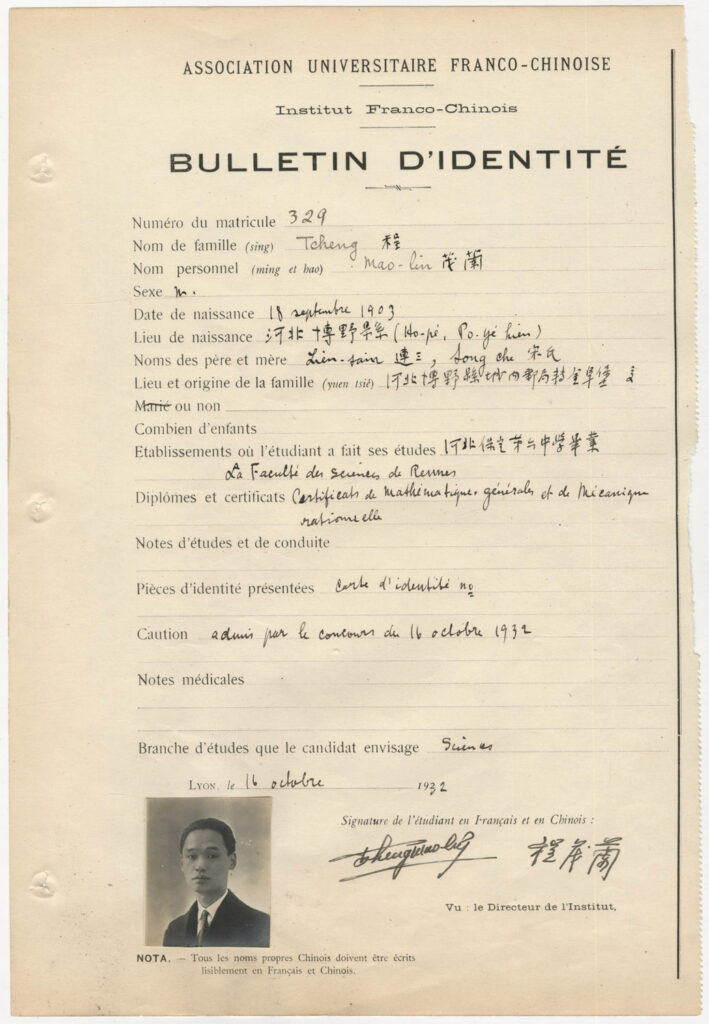
Bulletin d’inscription de Cheng Maolan à l’Institut franco-chinois de Lyon. (Fonds IFCL)
Ayant pris son bateau à Shanghaï, Cheng Maolan arrive à Marseille courant janvier 1926, après plus d’un mois de traversée via le canal de Suez. Normalement, sa voie était toute tracée : il devait ensuite prendre le train pour Lyon, afin de rejoindre les treize autres étudiants admis à l’IFCL cette année-là. Parmi eux, Tchao Tsin Yi (Zhao Jinyi), qui était entré à l’IFCL dès sa création en 1921, et finissait un doctorat en mathématiques tout en travaillant à l’observatoire de Lyon un peu plus tard (1927-1928), pour revenir en Chine aussitôt après. Ou encore Zhang Yun (Chang Yuin), entré en même temps que Zhao Jinyi, qui travailla à l’observatoire de Lyon dès 1924 et retourna en Chine en 1926 après avoir soutenu une thèse en astronomie. On aurait donc pu imaginer un destin similaire pour Cheng Maolan, mais si celui-ci s’était réalisé, nous ne parlerions sans doute pas de lui aujourd’hui ! Or, contre toute attente, Cheng Maolan disparaît. Aucune trace de lui pendant six ans ! En effet, ce n’est qu’à la rentrée de 1932, le 16 octobre, qu’il s’inscrit à l’IFCL.
Pourtant, il avait dû repasser le concours d’admission, celui qu’il avait réussi à Baoding étant devenu caduc, et de plus il devait être en possession d’au moins deux certificats de licence. Or, il apporte à l’appui de son dossier d’inscription un certificat de mathématiques générales, et un autre de mécanique rationnelle, en bonne et due forme, délivrés respectivement en mai et en octobre 1931 par… l’université de Rennes ! Il faut donc croire que, par un obscur concours de circonstances, Cheng Maolan avait traversé la France et s’était installé en Bretagne tout en préparant avec succès ses certificats réglementaires, avant de revenir à sa destination prévue initialement.
Une difficile vie lyonnaise
Quoi qu’il en soit, voici donc Cheng Maolan enfin arrivé à Lyon, avec un statut de « pensionnaire boursier » à l’IFCL : nourri, logé, blanchi. En réalité, il va mener une vie de galère, dont les archives de l’IFCL témoignent : écrites en lettres élégamment tracées, on y trouve des demandes renouvelées d’assistance financière (finalement accordées par la direction de l’Institut), mentionnant l’impuissance de sa famille à l’aider, car sans doute trop modeste. Il recourt probablement à des petits boulots, expliquant la lenteur de sa scolarité : il n’obtient sa licence complète, nécessitant deux autres certificats, qu’en 1935. Mais pas n’importe lesquels : « Calcul différentiel et intégral », en conformité avec son cursus en mathématiques, et surtout « Astronomie approfondie », cours donné par Jean Dufay, arrivé à l’observatoire de Lyon en 1929 et nommé son directeur en 1933. Cette orientation avait sans doute été inspirée par la présence de trois autres doctorants chinois dont Dufay était le directeur de thèse : Liau Ssu-Pin (Liu Sibin) et Wang Shi-Ky (Wang Shikui), tous deux arrivés à l’IFCL en 1932, qui obtinrent respectivement leur doctorat en 1935 et 1936, ainsi que Tien Kiu (Tian Qu), qui était arrivé avant (en 1930), mais soutint sa thèse plus tard (en 1938).

Cheng Maolan en 1932 (Observatoire de Lyon et IFCL)
Nonobstant la situation précaire de Cheng Maolan, mais convaincu des qualités intellectuelles de son étudiant, Jean Dufay le prit sous son aile. Cette décision était vitale pour lui : la direction de l’IFCL était certes assez souple, l’interrogeant régulièrement sur l’état d’avancement de sa thèse et ne lui coupant pas les vivres tant qu’il ne l’avait pas soutenue, mais cette situation ne pouvait pas durer. Pire : à la suite de l’invasion de la Chine par le Japon impérial en 1937, le Hebei, province natale de Cheng Maolan, se trouvait entièrement occupé, anéantissant tout espoir d’une aide familiale exceptionnelle, voire d’un éventuel retour au pays. L’avenir s’annonçait plutôt sombre…

Jean Dufay en 1933 (Observatoire de Lyon et IFCL)
De fait, même avec une licence en poche, la route vers l’obtention d’un doctorat devait s’annoncer particulièrement difficile. Jean Dufay voulait moderniser le programme des activités observationnelles de l’observatoire de Lyon en y introduisant plus de physique, notamment en développant la spectroscopie, jusqu’alors peu pratiquée en France. Or, si Cheng Maolan était un « fort en maths », son bagage de licence, constitué d’un seul certificat en astronomie, était trop mince pour démarrer une thèse. Dufay l’engagea donc dans la voie de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, comportant une part d’activité de recherche sur le tas, autrement dit une « pré-thèse ».
De fait, Cheng Maolan n’obtint son diplôme qu’au bout de quatre ans, en juillet 1939. Mais son travail eut entre-temps les honneurs de la presse : en 1937, il publia (comme seul auteur : « Tcheng, M.-L. ») une note dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences intitulée « étude photométrique des minima d’Algol » (en français bien sûr, comme il était d’usage à l’époque). Algol (bêta Persei) étant une étoile binaire à éclipses, de période 2,87 jours, il s’agissait d’enregistrer à plusieurs reprises à cinq longueurs d’onde (visibles), aussi précisément que possible, l’instant de passage du minimum de luminosité du système pour mesurer d’éventuelles différences de propagation. Cheng Maolan, n’en trouva aucune (« à 1 ou 2 minutes près », selon les plaques photographiques utilisées). Il se rangeait ainsi aux côtés des Américains Harlow Shapley et John Scoville Hall qui, contrairement à beaucoup d’autres auteurs, avaient obtenu des résultats similaires à la même époque, confirmant ainsi un aspect important du postulat einsteinien sur l’invariabilité de la vitesse de la lumière. Validé par Charles Fabry, de l’Académie des sciences, ce résultat fit l’objet de deux (courts) articles parus dans les quotidiens Le Progrès et Le Matin, en date du 22 décembre 1937.
Puis Cheng et Dufay s’intéressèrent au spectre, très riche en raies d’émission et très mystérieux, d’une autre étoile binaire (spectroscopique), Gamma Cassiopeiae (première du genre à avoir été étudiée par Charles Wolff et Georges Rayet à l’Observatoire de Paris en 1867), et en publièrent les résultats dans une autre (courte) note, intitulée « Nouvelles raies d’émission dans le spectre de Gamma Cassiopeiae », et présentée à l’Académie des sciences le 7 août 1939.
Trois semaines plus tard, hélas, le ciel se couvrait de nuages noirs : Hitler envahissait la Pologne.
L’Occupation et la naissance de l’observatoire de Haute-Provence
Comme on le sait, cette invasion se traduisit en France par une mobilisation, certes générale, mais dans un climat de « drôle de guerre » ; les hostilités ne commencèrent pour de bon que le 10 mai 1940, et le pays s’effondra en un mois. Le maréchal Pétain, porté au pouvoir par l’Assemblée nationale le 17 juin, transféra son gouvernement à Bordeaux et signa un armistice avec l’Allemagne le 22, aux termes duquel la France était coupée en deux par une « ligne de démarcation » : « zone occupée » au nord et à l’ouest, et « zone libre » au sud. Le personnel de l’observatoire de Lyon, qui n’avait pas été mobilisé, déménagea lui aussi à Bordeaux après avoir mis ses installations en sûreté. Lyon fut brièvement occupée par les troupes allemandes, qui évacuèrent la ville le 7 juillet, car les accords d’armistice la situaient en zone libre. Malgré ces tragiques événements, l’observatoire put donc reprendre ses activités, aussi normalement que possible compte tenu des circonstances. La catastrophe était évitée. Mieux (si l’on peut dire), Cheng s’attela à rédiger sa thèse (Le Spectre de Gamma Cassiopeiae), accompagnée d’une « seconde thèse », en réalité un mémoire sur la relativité restreinte et l’espace-temps d’Einstein-Minkowksi. Il en soumit le manuscrit à l’imprimeur en février 1940. Néanmoins, la soutenance ne put intervenir qu’en 1941, sans doute à cause de la situation générale. Cette année-là, il devint enfin docteur… en mathématiques !

L’observatoire de Haute-Provence en 1943 : livraison du miroir du télescope de 120 cm avec l’unique véhicule de l’observatoire, roulant au gazogène. (Archives de l’OHP)
Paradoxalement, c’est à cette époque difficile que l’horizon de Cheng Maolan commença à s’éclaircir pour de bon. En effet, cinq ans plus tôt, et après plus d’une décennie de réflexion et de projets préliminaires menés sous la conduite d’André Danjon (alors directeur de l’observatoire de Strasbourg), la décision avait été prise de construire un grand observatoire de classe internationale, le premier en dehors de Paris, en Haute-Provence. Jean Dufay fut chargé de trouver le meilleur site possible. Après une longue prospection, il choisit un vaste terrain en pente couvert de buissons et de chênes verts, de moyenne altitude (600-700 m), mais avec un ciel nocturne exceptionnel, non loin de Saint-Michel, petit village de mille âmes situé à une trentaine de kilomètres de Forcalquier. En 1939, Jean Dufay avait été logiquement nommé directeur d’un observatoire « virtuel » (même si l’expression n’existait pas encore), en plus de l’observatoire de Lyon. La construction avait débuté juste avant la guerre sur le site qui était situé en zone libre, comme Lyon.
Le projet d’observatoire incluait à l’origine un équipement ambitieux : il était prévu que deux télescopes, l’un de 80 cm déjà disponible et installé provisoirement près de Forcalquier, et un autre, de 120 cm, en construction depuis 1936, seraient opérationnels dès 1938, ce dernier précédant la construction ou l’acquisition d’un télescope beaucoup plus grand (2 m de diamètre environ). Mais en raison des circonstances, Jean Dufay et Cheng Maolan durent se contenter de modestes spectrographes, dont deux furent installés en 1941, ce qui permit tout de même à Cheng d’entamer une vraie carrière d’astronome. En effet, Dufay, en tant que son directeur de thèse et nouveau directeur de ce qu’on appellerait bientôt « l’observatoire de Saint-Michel » (futur observatoire de Haute-Provence, nous dirons simplement OHP ici), avait sans doute bien joué, car il obtint pour lui de la part du CNRS (fondé en octobre 1939, pendant la « drôle de guerre ») un poste, en principe temporaire, de boursier, et il put ainsi aider au démarrage scientifique du nouvel observatoire. Changement radical pour Cheng, qui, après presque dix ans de précarité à Lyon (et sans doute dès son arrivée en France, six ans plus tôt), n’avait plus à s’inquiéter pour ses fins de mois.
Les premiers bâtiments (maison du directeur, cantine, début d’ateliers, etc.) avaient été construits dès 1939, et les observateurs comme Cheng pouvaient séjourner sur place pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce que lui-même put faire en 1941 (de juillet à novembre), 1942 (août et septembre), et 1943 (avril à juin) grâce à son statut de boursier en mission. En l’absence de télescopes en fonctionnement, ses observations à l’OHP furent essentiellement consacrées à l’étude spectroscopique du ciel nocturne, y compris les aurores boréales comme celle qui apparut au-dessus de Lyon le 1er mars 1941.

L’atelier d’optique de l’OHP dans les années cinquante. Charles Fehrenbach, son directeur, montre une pièce à ses collègues de l’observatoire de Lyon : Marie Bloch et Cheng Maolan (au milieu, arborant élégant costume trois-pièces, montre à gousset et béret basque à la mode). Le quatrième personnage n’est pas identifié. (Archives de l’OHP)
Pendant ce temps, l’Histoire accélérait le pas. En novembre 1942, les troupes allemandes franchissaient la ligne de démarcation, en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord : la zone libre n’existait plus. Lyon fut à nouveau occupée par la Wehrmacht, mais pas la région plus au sud, à l’est du Rhône, qui comprenait notamment Grenoble et l’OHP : en vertu des accords passés entre Hitler et Mussolini, cette partie fut occupée par l’armée italienne. Mais après la destitution du Duce fin juillet 1943, les Allemands remplacèrent les Italiens, pour être eux-mêmes délogés par les Alliés à la suite du débarquement en Provence (15 août 1944). Dans cet environnement mouvant, l’observatoire fut épargné grâce à son isolement (au prix de conditions de vie difficiles et d’un approvisionnement parfois précaire) ; jusqu’à la Libération, seuls les parachutages destinés à la Résistance dans les environs pouvaient faire craindre une intervention de l’occupant.
Paradoxalement, c’est dans cette ambiance relativement paisible mais spartiate que l’OHP prit véritablement son essor, avec l’arrivée en mai 1943 d’un jeune astronome de 27 ans, Charles Fehrenbach. D’origine alsacienne, formé à l’astronomie par André Danjon à Strasbourg, agrégé de physique en 1937 puis nommé au lycée Saint-Charles de Marseille, le jeune professeur est mobilisé en 1939 comme sous-officier, puis essuie le feu allemand en 1940. Échappant de justesse à la captivité, il est démobilisé puis détaché, grâce à Danjon, à l’observatoire de Marseille début 1942, et de là, appelé comme directeur adjoint de l’OHP par Jean Dufay. En effet, celui-ci étant déjà directeur de l’observatoire de Lyon, ne suivait plus que de loin la construction de l’OHP, où il venait rarement. En conséquence, Fehrenbach assura en pratique et au quotidien les fonctions de directeur, notamment en résidant sur place, d’autres bâtiments ayant été construits entre-temps pour le personnel et les astronomes de passage.
La région de Saint-Michel fut libérée le 19 août 1944. Curieusement, malgré la mise en route du télescope de 120 cm un an plus tôt, Cheng ne se précipita pas à l’OHP, peut-être faute d’un instrument focal de spectroscopie : on ne trouve aucune trace de séjour entre juin 1943 et janvier 1945, mais il publia plusieurs articles. Alors que Lyon était libérée à son tour le 3 septembre 1944, Cheng continuait d’élire domicile à l’IFCL, qui comptait alors une soixantaine d’étudiants chinois, bloqués en France par l’entrée en guerre de leur pays aux côtés des États-Unis après l’attaque de Pearl Harbor.
Le tournant décisif : « l’appel de la patrie »
La paix revenue en Europe (8 mai 1945), l’administration française se remettait sur pied dans une certaine continuité : Cheng fut promu chargé de recherches transformant sa situation de boursier en un poste permanent. Mieux : ses travaux furent récompensés par un prix de l’Académie des sciences en décembre 1945. L’humble fils de paysans chinois était devenu, grâce à une initiative franco-chinoise (ou plus justement, comme disaient les Chinois, sino-française), un astronome respecté et apprécié. Il allait régulièrement en mission à l’OHP. En août 1948, il sortit de France pour la première fois depuis son arrivée pour aller assister, quoiqu’en tant que « représentant invité » pour la Chine, à la première assemblée générale de l’UAI (Union astronomique internationale) d’après guerre, à Zurich, en Suisse. Il prit part en 1953 à un colloque international sur la classification stellaire, organisé à l’Institut d’astrophysique de Paris par Evry Schatzman et Jean-Claude Pecker, réunissant une trentaine de participants. Il se vit même attribuer en 1956 les Palmes académiques par le ministère de l’Éducation nationale. Autant d’indices d’une carrière prometteuse au CNRS, dans laquelle, apparemment, la Chine n’aurait jamais sa place.
Mais désormais, la patrie de Cheng Maolan n’avait plus rien de commun avec celle qu’il avait quittée en 1925. Mao Tse-tung (Mao Zedong) avait proclamé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, avec pour capitale Pékin (Beijing). La plupart des astronomes chinois, réfugiés à Shanghaï, avaient refusé de suivre Chiang Kaï-shek replié à Taïwan, et accueillirent l’Armée populaire de libération maoïste qui s’était emparée de la ville sans combat. Ils se regroupèrent ensuite à Nankin (Nanjing), l’ancienne capitale de la république de Chine, où se trouvait son principal établissement astronomique, l’observatoire de la Montagne Pourpre.
L’un d’entre eux, Li Hen (Li Heng), un ancien étudiant de l’IFCL (de 1929 à 1933), avait passé ses deux dernières années en France à l’Observatoire de Paris et soutenu une thèse sur les céphéides. Après la guerre, il séjourna deux ans à l’université de Princeton, en 1948 et 1949, pour travailler avec Lyman Spitzer. Puis il fit le choix de retourner dans la « nouvelle Chine ». Or, contrairement à Li Heng, Cheng Maolan n’était jamais retourné dans sa patrie et, se trouvant complètement coupé de sa famille, l’idée de rentrer au pays ne devait alors probablement pas l’effleurer.

Li Heng (1898-1989), ancien étudiant de l’IFCL et un des principaux acteurs de l’astronomie dans la « nouvelle Chine » (Celebrity Encyclopedia).
Cependant, les nouveaux dirigeants de Pékin, notamment Chou En-lai (Zhou Enlai), le Premier ministre de Mao, étaient parfaitement conscients de la présence à l’étranger de milliers de Chinois possédant des compétences essentielles au renouveau de la Chine. Zhou Enlai lui-même avait sé-journé au Japon et en Europe (en particulier en France, où il vint plusieurs fois de 1920 à 1924 dans la mouvance du Mouvement Travail-Études), pratiquant couramment l’anglais. Il lança donc très tôt une campagne de « chasseurs de têtes » visant à attirer les Chinois de l’étranger pour leur proposer des postes importants : ainsi, Li Heng lui-même fut-il nommé dès 1950 directeur de l’observatoire de Sheshan, situé à côté de Shanghaï. Plus tard, en 1956, une délégation, composée de scientifiques et d’artistes déjà en place, fit une tournée de « recrutement » et de bons offices en Europe et eut même l’occasion de rencontrer Pablo Picasso à Cannes !

Réunion entre astronomes chinois et soviétiques pour mettre au point leur collaboration dans le cadre du Plan de douze ans (1956). Zhang Yuzhe est le troisième à partir de la gauche, Aleksandr Mikhailov est à côté de lui en costume clair.
Dans ce contexte, il paraît très vraisemblable que Li Heng (qui, bien sûr, connaissant très bien le français et les publications scientifiques françaises, pouvait les traduire pour ses collègues), appuyé par Zhou Enlai en personne, ait fait pression sur Cheng Maolan au nom de leur passé commun en France, et l’ait convaincu de quitter sa situation confortable pour revenir se mettre au service de la mère patrie…
Finalement, en juillet 1957, accompagné à Marseille par Charles Fehrenbach, devenu un grand ami, Cheng Maolan prit le bateau du retour. Il quittait la France pour entamer une « seconde vie », refaisant en sens inverse le voyage qui l’y avait amené trente ans plus tôt, quoique vraisemblablement dans de meilleures conditions de confort ! Fehrenbach dira de lui : « Il devint pour ses amis le plus fran-çais des Chinois, et pour ses compatriotes le plus chinois des Français. »
Les dés étaient jetés, pour le meilleur et pour le pire. En 1956, alors que les relations entre l’URSS et la Chine étaient au beau fixe, un « Plan de douze ans pour le développement de la science et de la technologie » fut promulgué par le Conseil des affaires d’État chinois (autrement dit le gouvernement central, présidé par le Premier ministre). Plusieurs des principaux astronomes chinois, dont Yu-che Chang (Zhang Yuzhe), président de la Société chinoise d’astronomie, et Li Heng, participèrent à son élaboration, ainsi que quatre des meilleurs astronomes soviétiques, dont Aleksandr Mikhailov, qui avait dirigé la reconstruction de l’observatoire de Pulkovo, entièrement détruit pendant le siège de Leningrad. Ce plan recommandait la construction d’un observatoire astronomique moderne, dans un site à trouver, autour d’un télescope de la classe des 2 m de diamètre, a priori importé. L’histoire ressemblait étrangement à celle de l’OHP, d’autant que ce dernier était précisément en train d’accueillir un télescope de 1,93 m de diamètre (le fameux « 193 » où fut découverte la première exoplanète de type solaire en 1995), commandé à l’entreprise britannique Grubb & Parsons.
Dans ce contexte d’un avenir radieux, Cheng Maolan cochait toutes les cases : il avait suivi (quoique de loin) toutes les étapes de la création de l’OHP et vu à l’œuvre Jean Dufay pour la recherche du site, puis Charles Fehrenbach pour la mise en route du télescope de 120 cm, ainsi que la construction du 193 cm ; il avait résidé en France pendant longtemps et avait développé des contacts avec l’étranger, il avait même été décoré par le gouvernement français, etc. Les choses ne traînèrent pas : le 22 février 1958, le Conseil des affaires d’État approuva la fondation de l’observatoire de Pékin (nom de référence pour le projet), sous la supervision de l’observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin, et nomma Cheng directeur de son bureau préparatoire. Lourde responsabilité !

Faute de routes praticables, Cheng Maolan effectue sa recherche de site à dos d’âne.
Et ce n’était pas fini : l’été suivant (12-20 août 1958), l’UAI tint à Moscou sa Xe assemblée générale. Cheng fit partie de la délégation chinoise, qui se composait de huit membres, dont quatre étaient membres de l’UAI : Zhang Yuzhe, qui la dirigeait, deux anciens étudiants de l’IFCL (Li Heng et Cheng), et un autre astronome senior de Nankin, Tai Wen-sai (Dai Wensai). Comme un poste de vice-président du comité exécutif de l’UAI allait être vacant (ces postes se renouvelant par roulement à chaque assemblée générale, tous les trois ans), la délégation chinoise proposa au comité exécutif le nom de Cheng Maolan !
Il n’est pas certain que cette candidature audacieuse ait pu aboutir, mais en tout cas un incident sérieux conduisit la délégation à la retirer immédiatement : Taïwan, autrement dit officiellement la république de Chine, non reconnue comme telle par la « nouvelle Chine », soumit son adhésion à l’UAI ! Dans des conditions complexes qui ne peuvent être expliquées ici faute de place, l’adhésion de Taïwan fut acceptée l’année suivante par le nouveau comité exécutif (alors présidé par le célèbre astronome néerlandais Jan Oort). Cette décision fut lourde de conséquences car la République populaire de Chine, considérant Taïwan comme partie intégrante de son territoire (ce qui résonne terriblement avec la situation actuelle), décida de son propre chef de se retirer de l’UAI, une décision sans précédent dans l’histoire de l’Union. (Les deux territoires finirent par cohabiter vingt ans plus tard en son sein, avec la mort de Mao et la fin de la Révolution culturelle, et l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, lui aussi, comme Zhou Enlai, un vétéran du Mouvement Travail-Études en France dans les années 1920 ! Mais cela est une autre histoire…)
Un OHP « autosuffisant » dans le chaos maoïste
En réalité, cette décision venait de très haut : cette même année 1958, Mao instaura le dramatique Grand Bond en avant, avec ses « communes populaires », qui pour lui incarnaient un communisme « à la chinoise », le seul vrai communisme à ses yeux après la mort de Staline, son modèle, en 1953. Or, Khrouchtchev, qui lui avait succédé, décréta la « déstalinisation » en 1956, péché mortel qui conduisit Mao à critiquer l’URSS de plus en plus violemment. La rupture fut consommée en 1960 avec le départ des derniers conseillers soviétiques de Chine.
« L’autosuffisance » devint alors le mantra du parti communiste, et la Chine dut, de force, suivre seule sa route. Pour les astronomes chinois, les rêves de modernisation s’effondraient. Non seulement il était devenu exclu d’importer quoi que ce soit de l’étranger, mais il était également impossible de s’appuyer sur des experts extérieurs comme ceux ayant contribué au fameux Plan de douze ans de 1956, lequel n’avait évidemment plus aucun sens.

La coupole du télescope de 60 cm en construction, telle que la vit le jeune astronome néerlandais George Miley en 1973. (Crédit : G. Miley)
Contre toute attente, le projet d’un grand observatoire chinois ne fut pas abandonné, car il garda le soutien de l’Académie des sciences, mais il se révéla beaucoup plus complexe que les astronomes chinois, disposant par la force des choses de peu d’expérience, avaient pu imaginer. Certes, Cheng Maolan en avait acquis en France, mais surtout (mis à part ses propres recherches) comme témoin plutôt que comme acteur. Et là, le défi se révélait complexe : il s’agissait de mener en parallèle deux tâches distinctes : (i) trouver une implantation pour l’observatoire sur un site adapté aux performances attendues d’un télescope de la classe des 2 m, a priori comparable à celui de l’OHP ; (ii) construire ce télescope, avec les moyens du bord, sans aide extérieure. Le projet s’annonçait donc particulièrement difficile, et il fallait incontestablement beaucoup de courage et de persévérance pour espérer le mener à bien dans le climat politique de l’époque. Car comme disait Confucius : « Une petite impatience peut ruiner un grand projet. »
Commençons donc par la recherche d’un bon site. Nous sommes à la fin des années cinquante. La Chine est un pays très pauvre, et en dehors des grandes villes, les infrastructures (routes, électricité, etc.) sont très peu développées. On ne peut donc envisager un site très isolé. De plus, pour bénéficier d’un bon ciel nocturne, il faut le préférer montagneux. Certes, Pékin est bordée à l’ouest, à une trentaine de kilomètres, par une longue chaîne montagneuse atteignant plus de 800 m d’altitude, mais déjà à cette époque des industries existaient dans la région, source de pollution lumineuse, à la différence de Saint-Michel. Il fallait donc aller explorer plus loin : Cheng Maolan dessina sur une carte des cercles concentriques d’un rayon de 50, 70 et 100 km, et il chercha des montagnes atteignant 1 000 m d’altitude. Une première sélection étant ainsi faite, il fallait se rendre sur place, à dos d’âne au besoin, compte tenu de l’état des chemins, faire des mesures de la transparence et de la turbulence atmosphériques, etc.

La statue blanche se dressant devant le musée consacré à Cheng Maolan dans sa région natale. (Crédit : Y. Zhou)
Après avoir parcouru en tous sens des milliers de kilomètres, traversé les drames du Grand Bond en avant (grandes famines, 1960-1962), et déniché plusieurs sommets remplissant presque toutes les conditions (mais pas toutes), ce n’est qu’au bout de sept ans, en 1964, que Cheng et ses nombreux aides finirent par découvrir le Graal dans le canton de Hsin-lun (ou Hsing Lung ; Xinglong aujourd’hui). Localisé à l’opposé des précédentes tentatives, à 850 m d’altitude et à 120 km au nord-est de Pékin, dans la préfecture de Chengde, ce site avait effectivement un certain nombre de points communs avec celui de l’OHP… lui permettant d’être retenu.
Quant au fameux projet de télescope de 2 m, que s’était-il passé entre-temps ? Revenons de nouveau à 1958. Devant renoncer à importer un télescope « sur étagère », d’un diamètre comparable à celui de l’OHP, il fallait se plier à la nouvelle politique d’autosuffisance du Grand Bond en avant. Mais cela imposait de créer d’abord ex nihilo un atelier de construction d’instruments astronomiques à l’observatoire de la Montagne Pourpre. Le premier objectif fut de s’y faire la main en construisant un télescope de 60 cm (un télescope de cette taille, fabriqué par Zeiss, y avait déjà été installé dans les années 1930). Ensuite, il fallait réussir à trouver rapidement auprès des Soviétiques et à se faire livrer (juste avant la rupture définitive !) une ébauche de miroir. Par une chance incroyable, l’une d’elles était disponible, d’un diamètre de 2,20 m mais non polie. Cette circonstance fortuite permit à l’Académie des sciences d’approuver, dans le courant de l’été 1959, la construction d’un télescope plus grand que celui prévu initialement : officiellement 2,16 m de diamètre. Ce fut le Projet 216, auquel devaient participer des instituts de recherche en optique ainsi que des étudiants comptant parmi les meilleurs des universités chinoises.
Mais en raison d’une situation politique chaotique, le site de Xinglong ne fut finalement inauguré qu’en 1968, soit dix ans après le retour de Cheng Maolan en Chine. Il put enfin accueillir le télescope de 60 cm made in China, livré l’année suivante. Le nouvel observatoire allait également bénéficier de la disponibilité de deux télescopes fournis, du temps de l’assistance soviétique, par Zeiss, dont l’usine (à Iéna) se trouvait alors en République démocratique allemande (Allemagne de l’Est communiste) : un télescope de Schmidt de 60/90 cm (selon la configuration), qui fut installé en 1967 ou 1968, et un double astrographe de 40 cm, installé beaucoup plus tard, en 1974. Le polissage de l’ébauche de miroir soviétique, quant à lui, ne démarra pas avant octobre 1977.
De façon quelque peu inattendue, ces étapes purent être franchies malgré la Révolution culturelle, quoique plutôt au début et vers la fin, avec tout de même une interruption de six ou sept ans. Lancé par Mao en mai 1966, ce sinistre épisode prit fin définitivement, au prix d’un lent mais violent déclin, après sa mort, dix ans plus tard. Durant cette période tragique, la biographie officielle chi-noise de Cheng Maolan nous apprend (sans donner de date) que lui et ses collègues de l’observatoire de Pékin furent démis de leurs fonctions et responsabilités, et traités « d’autorités académiques réactionnaires ». Cheng fut de plus accusé (en raison de son passé en France) d’être « traître à son pays, pour avoir entretenu des relations avec une puissance étrangère ». Heureusement pour lui, il semble qu’il n’ait pas été inquiété physiquement, contrairement à son collaborateur immédiat, Xiao Guangjia, qui, étant le représentant du Parti communiste à l’observatoire, avait été accusé d’être un « compagnon de route du capitalisme », puis condamné à être envoyé dans un camp de rééducation et enfermé dans une cage en bambou.

L’observatoire de Xinglong aujourd’hui. Le télescope de 2,16 m est au premier plan, devant le télescope de Schmidt LAMOST, entré en service en 2010. (Crédit : National Astronomical Observatories of China, Pékin)
Un « héros de la nouvelle Chine »
La fin de la Révolution culturelle offrit enfin à la Chine l’occasion de s’ouvrir au monde extérieur, avec l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en décembre 1978. Malheureusement, Cheng Maolan n’en profita pas : sa santé déclina à ce moment-là, et il décéda le 31 décembre de cette même année, à l’âge de 73 ans. Malgré les dramatiques soubresauts de la situation politique chinoise qu’il avait vécus dès son arrivée, comme un écho à ceux qu’il avait connus en France, il eut l’occasion, par deux fois, de revoir son ami Charles Fehrenbach. La première occasion se présenta au printemps 1966, juste avant le déclenchement de la Révolution culturelle : Cheng faisait partie d’une délégation d’astronomes invités en France, et il se rendit bien sûr à l’observatoire de Haute-Provence. Neuf ans après avoir quitté la France, il retrouva son directeur Jean Dufay et Fehren-bach (qui devait lui succéder peu de temps après), ainsi que de nombreux collègues, anciens et nouveaux. La seconde occasion fut un « renvoi d’ascenseur », quand il invita Fehrenbach à venir le voir à Pékin en juillet 1977 et lui fit visiter l’observatoire de Xinglong.
Lors de ce séjour, Fehrenbach était impatient de voir l’état d’avancement du télescope de 2,16 m, dont il avait bien sûr entendu parler. Mais il en fut pour ses frais : le polissage du miroir n’avait pas encore commencé, et apparemment il ne le vit même pas, non plus que l’emplacement exact où le télescope devait se trouver, ce qui le plongea dans des abîmes de perplexité. En réalité, il fallut encore dix ans pour que le télescope soit effectivement construit à Nankin, puis transporté à Xinglong, où il vit enfin sa « première lumière », en novembre 1989, soit plus de trente ans après le retour en Chine de Cheng Maolan et le démarrage du projet auquel il avait consacré toute sa seconde vie.
Le 27 août 2018, à Boye, « xian » (sous-préfecture) située à 30 km au sud de Baoding, où avait vécu Cheng Maolan dans son enfance, les officiels se pressent sur une estrade, la foule se rassemble pour écouter les discours. Le « musée Cheng-Maolan de l’astronomie et de la technologie » va bientôt être inauguré, cinquante ans après la création du site de Xinglong et quarante ans après le décès de Cheng, qui précéda donc lui-même de dix ans l’achèvement du télescope de 2,16 m. Pour couronner le tout, c’est une grande statue blanche, de style plutôt académique, qui accueille aujourd’hui les visiteurs devant l’entrée du musée.
Hommage vibrant, quoique tardif, à un homme discret né à la campagne et finalement hissé au rang de « héros de la nouvelle Chine », et qui vécut deux vies, dans deux modes entièrement différents, avec un courage et une résilience remarquables au travers d’événements majeurs du xxe siècle. Nul doute qu’il contribua en son temps, notamment avec ses collègues astronomes anciens étudiants de l’Institut franco-chinois de Lyon, à la naissance puis au développement de collaborations astronomiques fructueuses entre la France et la Chine.
Par Thierry Montmerle (IAP), Yves Gomas (Université Lyon-1, S2HEP) et Yi Zhou (RFI)

Publié dans le numéro de l’Astronomie n°178
Cet article est basé sur le livre The Two Lives of Cheng Maolan. From the « French Silk Road to Astronomy » to the Meanders of Mao’s China, par Thierry Montmerle, Yi Zhou et Yves Gomas, Springer 2022. Traduction française à paraître aux Éditions Pacifica, Paris.
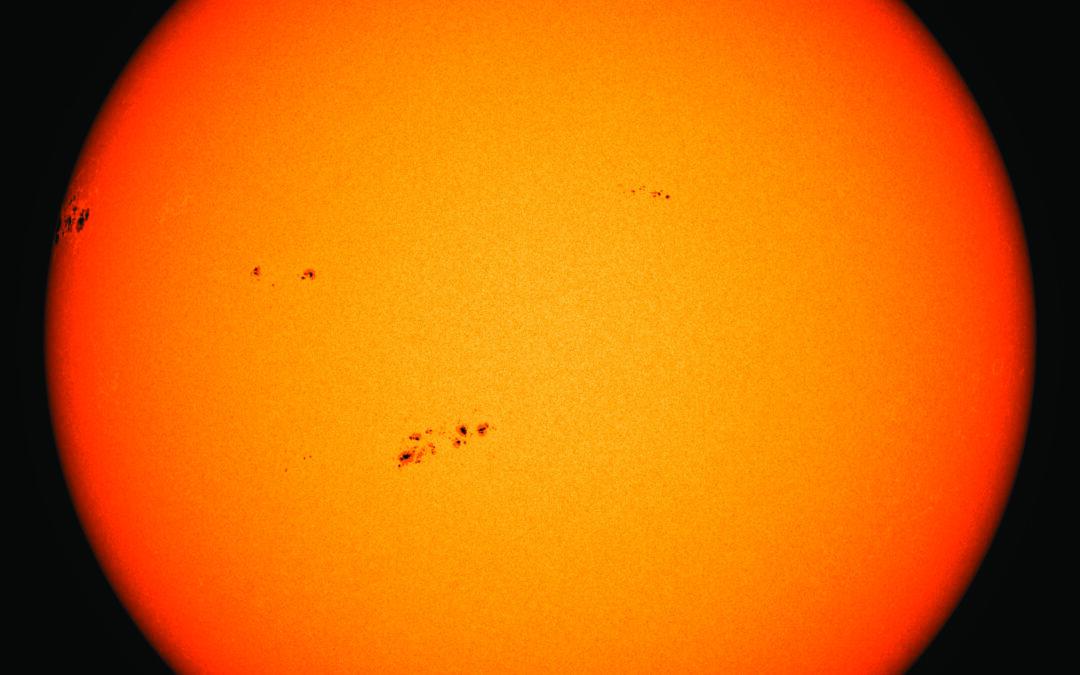
par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Zoom Sur
L’activité solaire passe d’une phase calme à une phase active, et ainsi de suite, et ce cycle dure environ onze ans. Les événements les plus spectaculaires ont généralement lieu autour du maximum d’activité solaire. L’observation du Soleil lors de sa période calme – comme actuellement – apporte cependant des informations cruciales sur les propriétés de notre étoile.
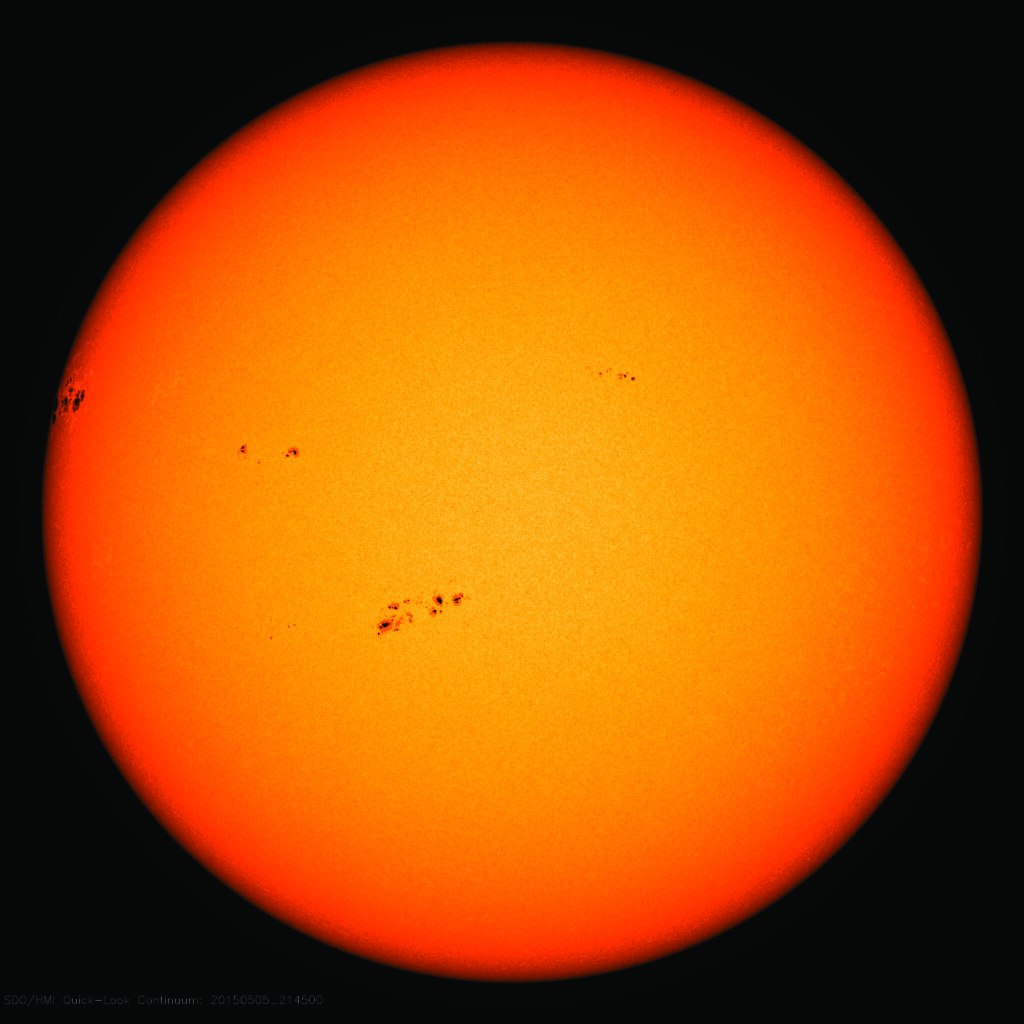
Par sa proximité, le Soleil nous permet d’étudier en détail les processus magnétiques et dynamiques sur des échelles spatiales et temporelles impossibles à reproduire en laboratoire. Le Soleil possède un cycle d’activité de 11 ans (voir l’Astronomie no 143, novembre 2020, p. 18), caractérisé par une alternance de périodes calmes (sans structure remarquable) et de périodes actives avec le développement de régions magnétiques telles que les taches*, les facules* et les filaments* (fig. 1). Les minima solaires sont plus ou moins marqués et plus ou moins longs (quelques années). La descente vers le minimum est douce (7 ans), tandis que la remontée est plus rapide (4 ans). Le dernier minimum date de fin 2019-début 2020 ; le prochain maximum est attendu autour de 2024-2025. Les minima favorisent l’observation du Soleil calme, c’est-à-dire des zones non perturbées par la présence de régions actives et de filaments ; le champ magnétique général du Soleil ressemble alors à celui d’un aimant. Ces périodes sont propices à l’observation des phénomènes qui couvrent globalement la surface, comme la granulation*, le réseau magnétique* associé à la supergranulation*, ou encore les micro-boucles et micro-éruptions identifiées récemment par la sonde Solar Orbiter (voir l’Astronomie no 142, octobre 2020, p. 18). Nous allons ici présenter un « focus » sur les différentes échelles du Soleil calme et sur le réseau magnétique.
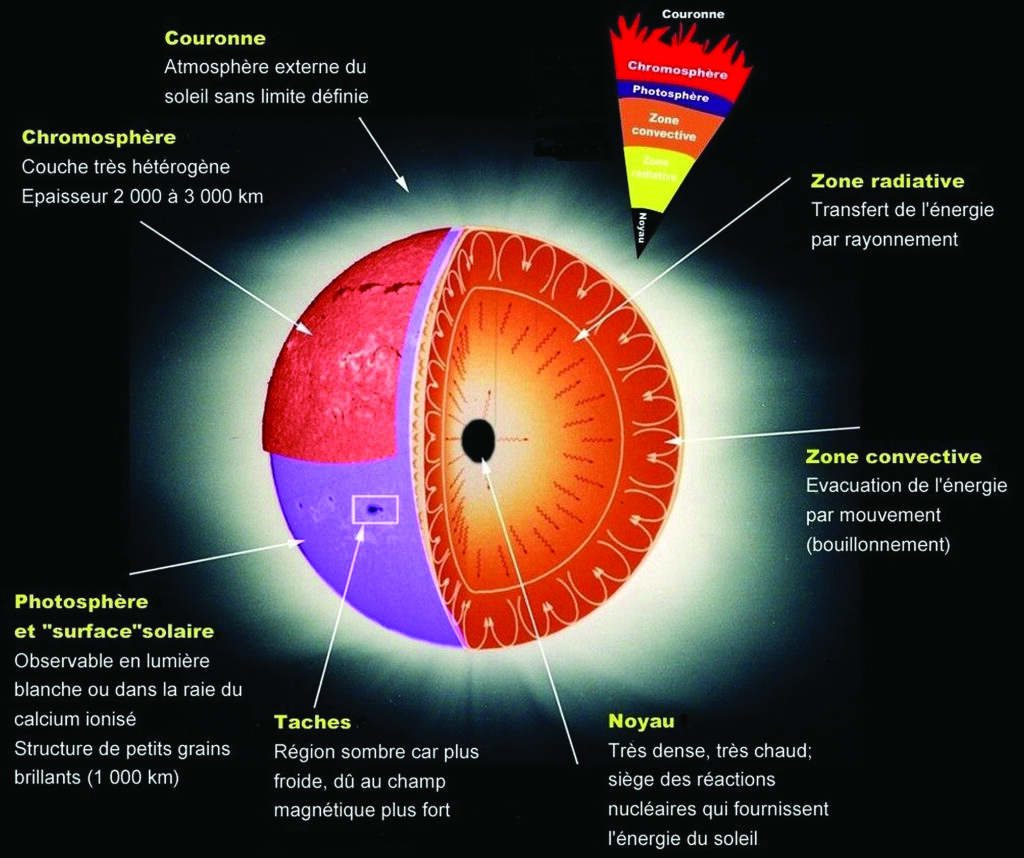
1. structure du soleil (échelle non respectée). on observe la photosphère du soleil et les couches plus externes, mais l’intérieur de l’étoile ne peut être observé directement (© OP)
La granulation
La granulation (initialement appelée « grains de riz » par les premiers observateurs, fig. 2) est une structure qui constitue la signature de la zone convective sous-jacente du Soleil, inaccessible à l’observation (fig. 1). La granulation est uniformément répartie sur la photosphère, la surface visible (une fine couche de 500 km d’épaisseur en regard des 696 000 km du rayon de l’étoile). Il s’agit de petites cellules convectives, d’une taille moyenne de 1 000 km (la France), à l’intérieur desquelles la matière monte à la vitesse de 0,5 km/s à 1 km/s, modulée par des oscillations de cinq minutes. Les bords des cellules sont plus sombres, car plus froids (température de 5 500 K au lieu de 5 800 K), la matière y descend ; on appelle ces espaces « intergranules ». Il y a environ 10 millions de granules sur la surface du Soleil. Elle est donc en perpétuel renouvellement, puisque la durée de vie de chaque granule est seulement de 10 minutes. Cette évolution se révèle au télescope (si son pouvoir séparateur est meilleur que 1 seconde d’arc ou 730 km) sous la forme d’un « bouillonnement » lent et permanent. Un granule qui disparaît est remplacé par un autre ; certains explosent et se fragmentent en plusieurs granules.
La granulation apparaît dans le rayonnement continu visible, de manière plus contrastée vers le bleu du spectre. Elle s’évanouit dans les cœurs de raies, qui sont formés au-dessus, dans la haute photosphère ou la chromosphère.
La granulation semble évoluer légèrement avec le cycle solaire. En effet, les granules, dont la surface varie de 2 %, montrent une variation inverse de leur nombre. Cette double variation engendre peut-être une fluctuation de luminosité résiduelle, mais elle est indécelable car négligeable devant la variation d’irradiance* produite au cours du cycle par le jeu des taches et des facules.
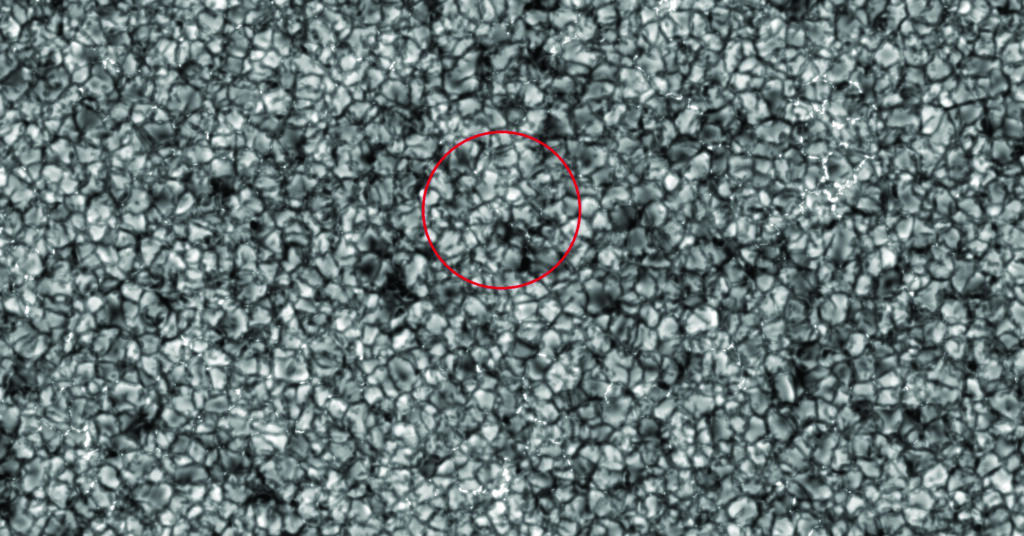
2. Granulation vue par le télescope spatial Hinode (instrument sot/BFi) dans la bande de la molécule Cn (388 nm). La taille du champ est de 84 000 km× 44 000 km (le cercle rouge a la taille de la terre). Des points brillants apparaissent dans les espaces sombres intergranulaires : ce sont des tubes magnétiques* intenses, mais non résolus. (Hinode/JAXA/NASA/ESA)
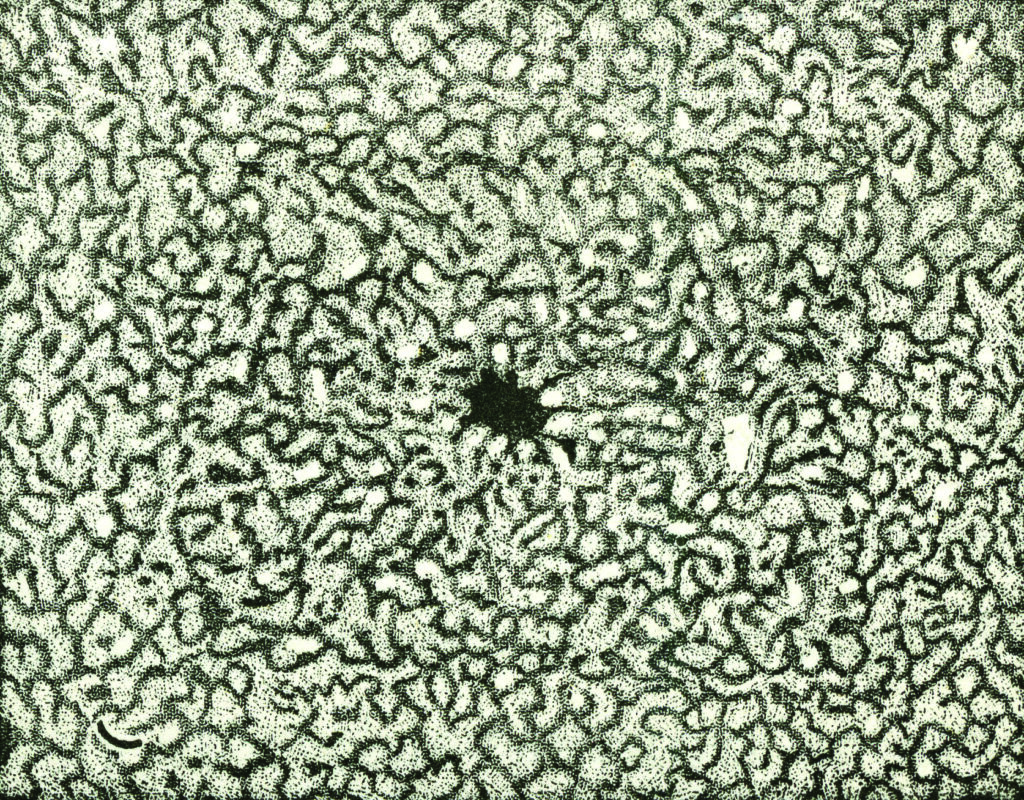
3. Granulation et pore* dessinés par le père Angelo secchi, 1875.

4. L’une des premières observations photographiques de la granulation (1885) par Janssen à meudon. (OP)
Premières observations de la granulation
Le père Angelo Secchi (1818-1878), dans son ouvrage Le Soleil, paru en 1875, publie un dessin de la granulation (fig. 3) faisant référence aux observations antérieures de James Nasmyth (1861). Cependant, la granulation aurait été remarquée à la même époque par d’autres astronomes et même aperçue dès 1769 lors d’un transit de Vénus observé par des Mexicains. L’une des premières collections photographiques de la granulation (fig. 4) remonte à la fondation de l’observatoire de Meudon (1876), lorsque Jules Janssen (1824-1907) organise le service d’imagerie de la surface solaire, avant de se lancer plus tard dans la spectroscopie avec Henri Deslandres (voir l’Astronomie no 143, novembre 2020, p. 38). Au XXe siècle, la création de la lunette tourelle du Pic du Midi (1959) par Jean Rösch (1915-1999) a permis aux chercheurs français d’être en avance pendant trente ans.

5. themis à l’observatoire du teide, 2370 m d’altitude. (© J.-M. Malherbe, OP)
Comment observe-t-on la granulation au XXIe siècle ?
Dès 2006, le télescope spatial Hinode (Jaxa/Nasa) a révolutionné l’observation de la granulation grâce à son pouvoir séparateur inédit et constant de 150 km dans le violet, fournissant de très longues séquences homogènes (de 24 à 48 heures) impossibles à obtenir au sol. Auparavant, cette résolution n’avait pu être atteinte que rarement, sur de courtes durées, à la lunette tourelle du Pic du Midi, à la tour solaire de Sacramento Peak (É.-U.), au télescope suédois de 1 m à La Palma (Canaries). Le télescope de 1,60 m de l’observatoire solaire de Big Bear (É.-U.) descend à 80 km grâce à l’optique adaptative*. D’autres instruments au sol sont devenus capables d’égaler Hinode grâce à des techniques logicielles novatrices. Par exemple, le télescope Themis du CNRS à Tenerife (Canaries, fig. 5) fournit depuis 2019 de bonnes images en utilisant des algorithmes de restauration ; ceux-ci sont appliqués à des rafales acquises à 30 images/s (fig. 6) grâce à la nouvelle génération de caméras SCMOS et aux temps de pose brefs (moins de 1 milliseconde) qui figent la turbulence.
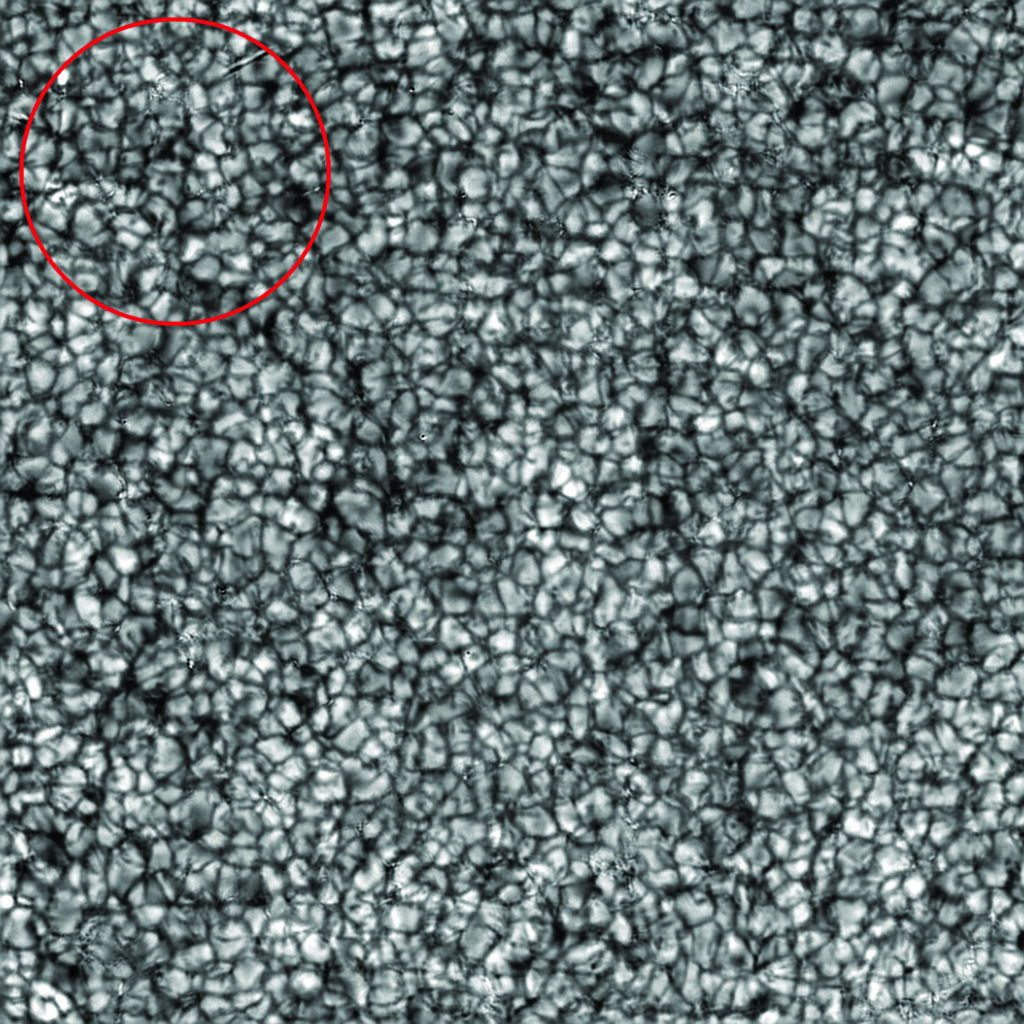
6. Granulation observée par themis en 2019 à 650 nm de longueur d’onde après restauration numérique d’une rafale de 100 images. Champ de 43000 km × 43000 km. Le cercle rouge a la taille de la terre. (Themis/Insu-CNRS)
Les simulations numériques 3D sur supercalculateurs viennent en complément ; elles sont précieuses pour comprendre les mécanismes physiques, car elles permettent de confronter les observations à la théorie. La figure 7 présente un résultat basé sur la résolution numérique des équations de la magnétohydrodynamique (MHD) qui combine l’hydrodynamique (évolution des densités de matière et des mouvements), l’électromagnétisme (champs magnétiques) et le transfert du rayonnement dans un espace à trois dimensions. On arrive aujourd’hui à reproduire correctement beaucoup d’observations, mais aussi à effectuer des prédictions que l’on teste par de nouvelles observations, qui à leur tour enrichissent les modèles. Les progrès dépendent du maillage de calcul, donc de la puissance des ordinateurs.
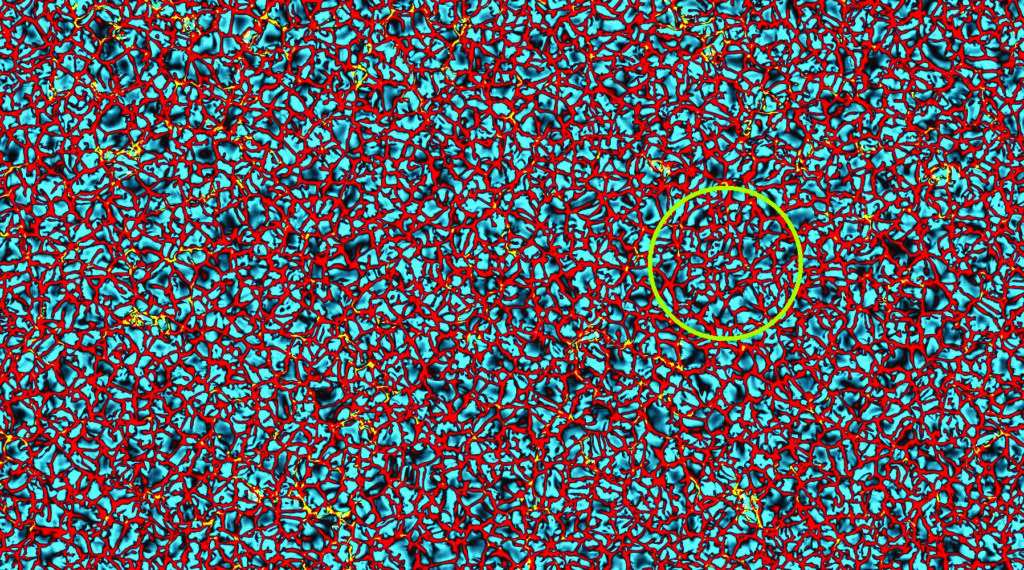
7. résultat de simulation numérique des mouvements et champs magnétiques du soleil calme. La matière montante (granules) est en bleu, celle qui descend (intergranules), en rouge. La simulation confirme que les champs magnétiques (en jaune) apparaissent dans les intergranules. Champ 86 000 km × 48 000 km. résolution 48 km. Le cercle vert a la taille de la terre. (R. Stein, MSU)
La supergranulation
La résolution du satellite Solar Dynamics Observatory (SDO), mis en service en 2010, est modeste (1 seconde, soit 730 km), mais ce satellite a l’avantage d’observer le disque solaire en totalité avec un pas temporel de 45 s. L’imageur magnétique héliosismique (HMI) enregistre la raie du fer neutre Fe I à 617,3 nm avec six points spectraux dans plusieurs états de polarisation, ce qui lui permet de dévoiler le réseau magnétique de la photosphère (fig. 8). Ce réseau est formé de cellules plus ou moins fermées aux frontières desquelles se concentre le champ magnétique. La taille de ces cellules est 30 fois plus grande que la granulation (30 000 km). Elles se nomment « supergranules » et sont visibles depuis longtemps sur les images du Soleil dans la raie K du calcium ionisé Ca II (spectrohéliogrammes de Meudon à 393,4 nm de longueur d’onde, voir http://bass2000.obspm.fr). Cependant, leur nature est mal comprise. La supergranulation est évolutive, sa durée de vie est d’un à deux jours ; elle change donc cent fois plus lentement que la granulation.
L’instrument HMI permet d’évaluer les mouvements horizontaux de surface. La figure 9 dévoile l’amplitude moyenne de ces mouvements intégrés pendant 6 heures. On y distingue des cellules en anneau, d’une taille de 25 000 km ; ce sont des mouvements d’expansion qui forment les supergranules associés au réseau magnétique. Ces mouvements ont pu être analysés avec plus de détails grâce aux données fournies par Hinode.
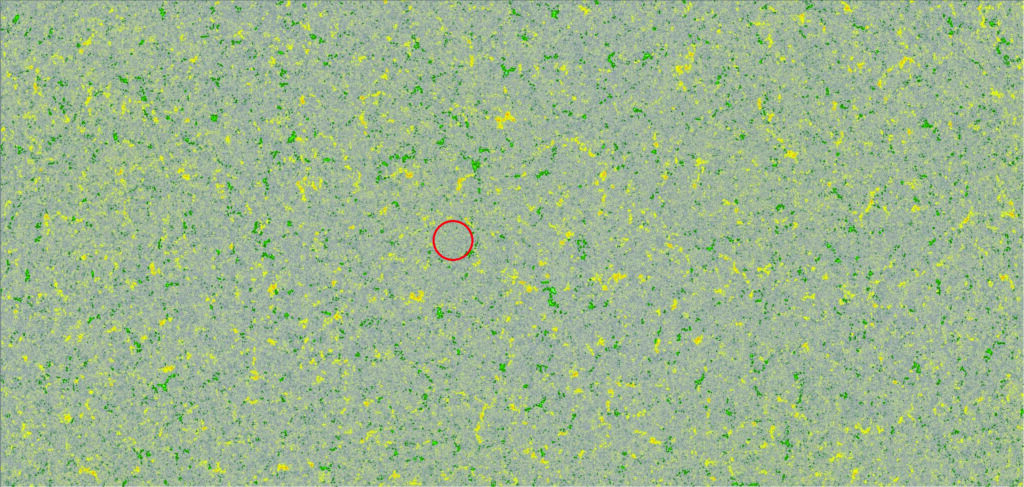
8.réseau magnétique photosphérique vu par Hmi (raie Fe i à 617,3 nm) grand champ de 900 000 km × 440 000 km (polarités magnétiques nord et sud en jaune et vert). Le cercle rouge au centre fait 30 000 km de diamètre, taille typique des cellules du réseau. (SDO/Nasa)
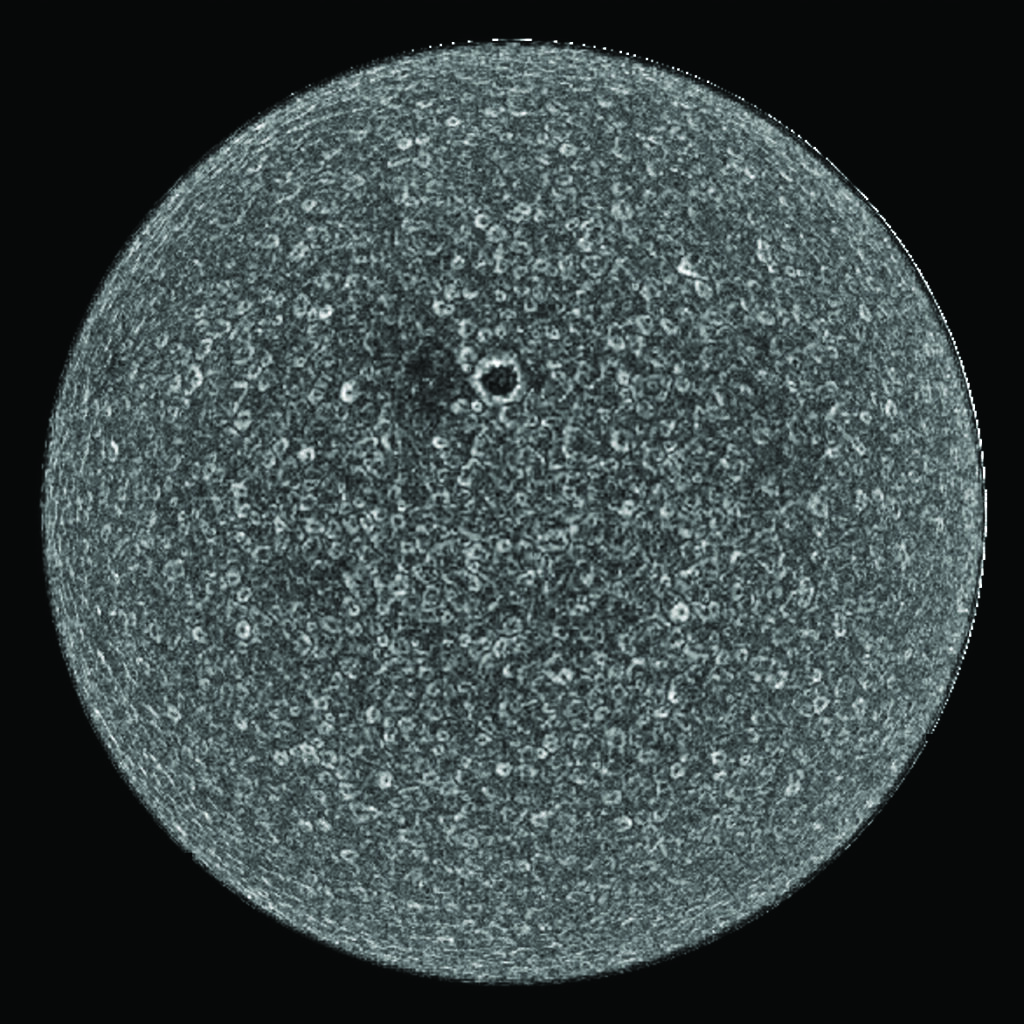
9. ensemble de supergranules (petites structures annulaires) détectés sur la surface solaire par analyse des flots horizontaux. Le grand anneau central est lié à la présence d’une tache qui entrave les mouvements. (SDO/Nasa et OMP)
Granules explosifs, familles et formation du réseau magnétique
On a compris à l’aide des observations Hinode et des simulations numériques que les granules n’évoluent pas indépendamment de leurs proches voisins, mais se groupent en ensembles appelés « familles » de granules (fig. 10) formant une échelle intermédiaire appelée « mésogranulation », d’environ 5 000 km. Chaque famille a pour origine un granule explosif, qui éclate et se segmente en chaîne en formant d’autres granules explosifs (fig. 11). Les familles croissent en taille pour réunir au plus une centaine de granules, puis disparaissent au bout de quelques heures, laissant la place à d’autres familles. On soupçonnait l’existence de ces cellules intercalées entre granulation et supergranulation (mais non directement visibles) sans comprendre leur nature. La découverte des familles apporte une explication : la mésogranulation serait composée de granules de même origine.
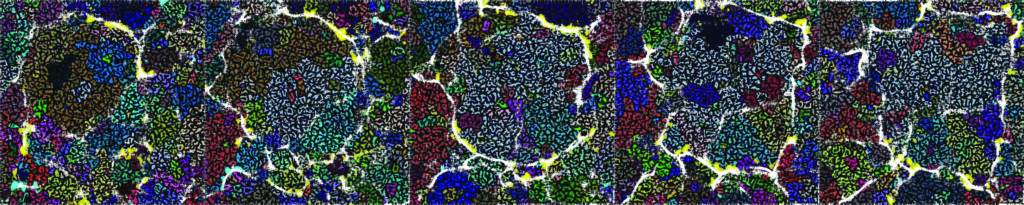
10. Les granules forment des familles évolutives issues de granules qui explosent en chaîne. ici, les granules de la même famille ont la même couleur, le pas entre deux images consécutives est de 5 heures. on voit un supergranule (taille 30 000 km) évoluer en regroupant plusieurs familles. ses frontières (en blanc) sont superposées au champ magnétique (en jaune). Champ de 45 000 km de côté. (Hinode/OMP/OP)

11. Un exemple typique de granule explosif (en vert, au centre) qui naît puis donne naissance à une famille (pas entre deux images = 1 minute), détail de 10 000 km de côté. (OMP/OP)
On a constaté que les familles ont des mouvements d’expansion horizontale (fig. 12) ; ceux-ci contribuent à transporter les champs magnétiques pour former le réseau qui se concentre aux frontières des supergranules. Comme chaque supergranule est en interaction avec ses voisins, les mouvements d’expansion deviennent convergents aux frontières. On tient là un mécanisme plausible expliquant la formation du réseau magnétique, qui intriguait depuis longtemps.
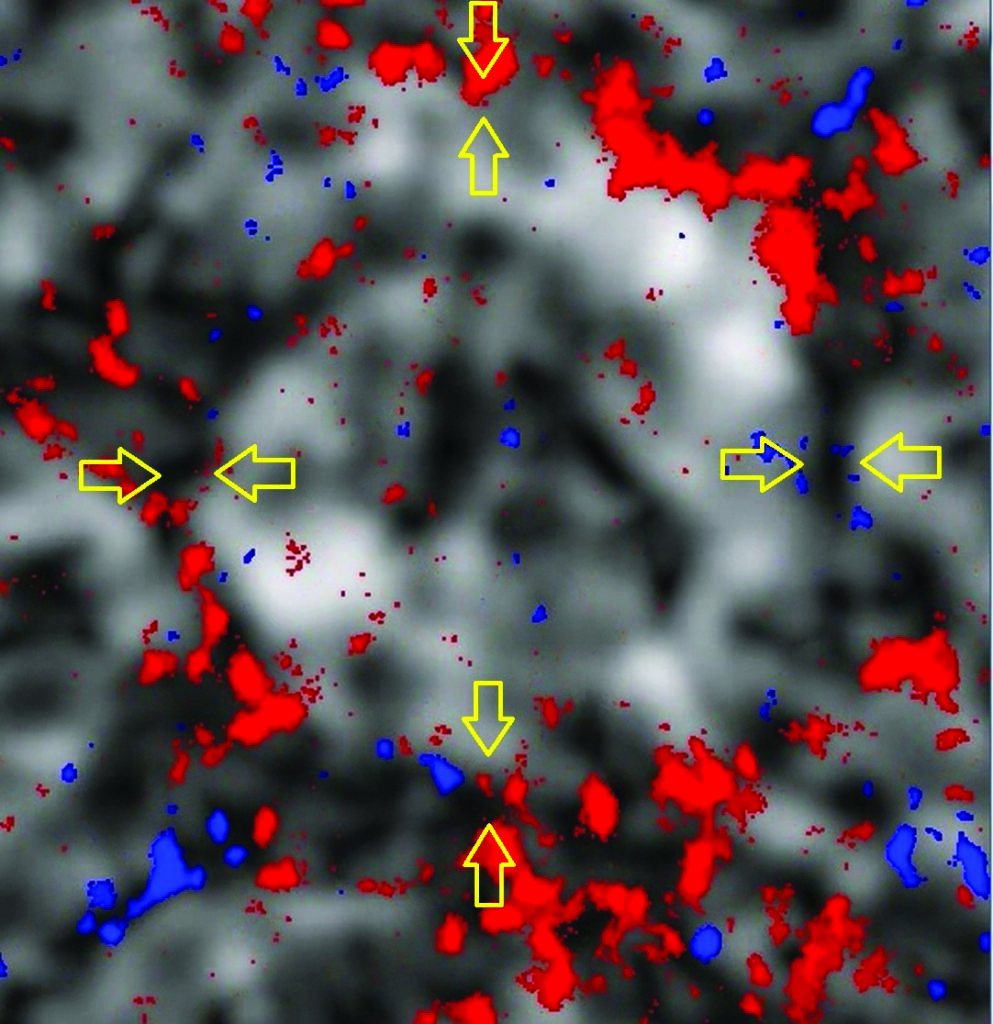
12. Un supergranule typique (taille 30000km) délimité par le réseau magnétique (rouge ou bleu pour polarité sud ou nord). Les mouvements sont convergents aux frontières (flèches). Une forte vitesse d’expansion (gris clair) contribue à transporter les tubes magnétiques de l’intérieur des cellules vers les bords, formant le réseau par concentration. (Hinode/Jaxa/OMP/OP)
Les instruments de la décennie 2020-2030
L’étude de la granulation solaire, et en particulier des tubes magnétiques concentrés dans les intergranules (non résolus actuellement), est d’importance majeure pour comprendre le chauffage et la remontée en température de la couronne à deux millions de degrés. Cela nécessite des observations à très haute résolution spatiale. Jusqu’ici, les tubes magnétiques n’ont jamais été résolus spatialement tellement ils sont minces. La limite d’Hinode est de 150 km. Les meilleures images au sol ont été obtenues par le nouvel instrument de Big Bear avec 80 km de pouvoir séparateur.

13. DKist, un télescope de 4,20 m dédié à l’observation en haute résolution spatiale de la surface solaire entre 400 nm et 5 microns de longueur d’onde. il devrait aussi s’attaquer à la mesure des champs magnétiques coronaux dans l’infrarouge, impossible jusqu’alors. (NSO/Aura/NSF)
Implanté sur l’île de Maui (Hawaï, É.-U.), le DKIST – pour Daniel K. Inouye Solar Telescope –, nous fait entrer dans une nouvelle ère, celle de la très haute résolution (fig. 13). Son miroir de 4,20 m, lors de sa première lumière fin 2019, a fourni des détails jamais vus de 30 km dans le proche infrarouge (fig. 14), voire de 20 km dans le bleu. Cet énorme bond en avant, autorisé par une optique adaptative performante, est susceptible de révolutionner notre compréhension du chauffage coronal au cours de la décennie présente.
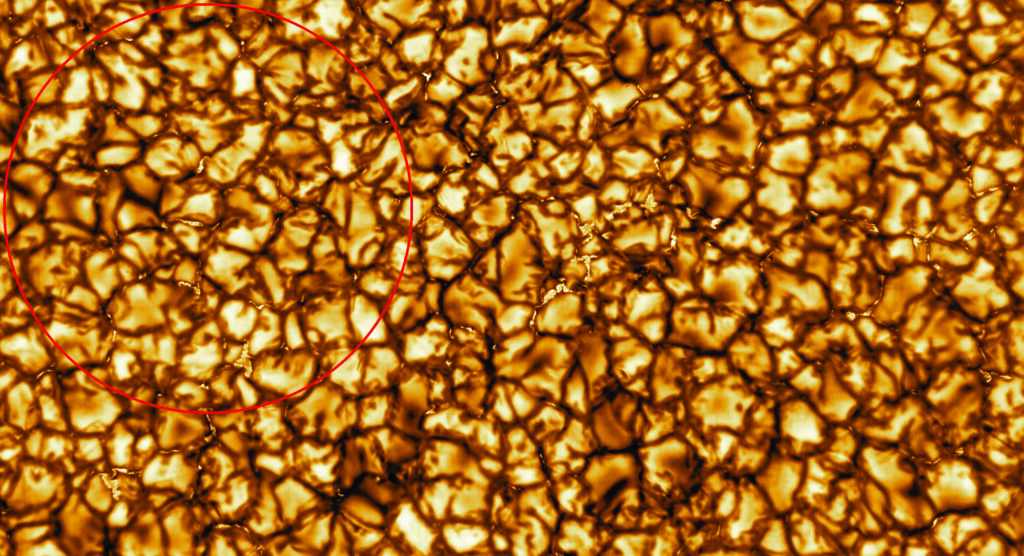
14. Granulation observée à 789 nm de longueur d’onde par le nouveau télescope américain DKist (Hawaï) en optique adaptative (première lumière). Chaque granule mesure 1 000 km. Champ 32 000 km × 17 000 km. résolution 30 km. Le cercle rouge a la taille de la terre. Les rubans et points brillants entre les granules sont des tubes de champ magnétique qui sont, pour la première fois, détaillés. (NSO/Aura/NSF)
Le projet de Télescope solaire européen (EST, http://www.est-east.eu/) est le concurrent (fig. 15) du DKIST. Bien que très avancé en ce qui concerne les études coordonnées par l’Institut d’astrophysique des Canaries, il est encore en recherche de montage financier, de sorte qu’il ne sera pas actif avant 2026 ou 2028, sur l’île de La Palma. L’enjeu de l’EST est d’extrême importance, car ce serait le premier télescope solaire construit à l’échelle européenne. Ce grand équipement est essentiel pour rester à la pointe des recherches scientifiques et technologiques en physique solaire.
Il n’existe aucun projet spatial permettant de concurrencer DKIST et EST sur le terrain de la haute résolution angulaire ; en effet, les progrès sont liés à l’augmentation de la taille des miroirs, rendant leur installation en orbite impossible, car trop coûteuse.

15. L’est (vue d’artiste) est un télescope de 4,20 m en projet dédié à l’observation en haute résolution spatiale de la surface solaire du proche ultraviolet au proche infrarouge. il devrait aussi s’attaquer à la mesure des champs magnétiques des tubes concentrés intergranulaires. (EST consortium)
Conclusion : les granules explosifs, clef du Soleil calme ?
Les interactions entre les champs magnétiques et la matière, sur des échelles de temps et d’espace non testables en laboratoire, sont à l’œuvre sur le Soleil. Les taches constituent la manifestation la plus évidente du magnétisme. L’autre composante, moins connue mais dont l’importance physique est prépondérante (10 000 fois plus de flux magnétique !), est le réseau magnétique réparti sur l’ensemble du Soleil. Cependant, nous ne savons pas bien comment il se forme. La dynamique des familles de granules, découvertes récemment, est une piste séduisante. Elle pourrait expliquer le transport des champs magnétiques et leur concentration, constituant des structures plus grandes, les supergranules (dont l’origine est débattue depuis cinquante ans). Leur dimension moyenne (30 000 km) est encore une véritable énigme ! Ainsi, la formation des supergranules (et du réseau magnétique associé) pourrait être un phénomène dynamique « piloté » par les granules explosifs, sur lesquels les recherches sont en cours.
par Thierry ROUDIER | Irap, observatoire Midi-Pyrénées et Jean-Marie MALHERBE | Lesia, Observatoire de Paris

Publié dans le numéro Janvier 2021
Glossaire
Facule : région brillante autour d’une tache solaire, plus chaude que son environnement.
Filament : structure magnétique en forme de « hamac » s’élevant dans la couronne solaire, composée d’un plasma plus dense et froid que le milieu ambiant. La température de la matière du filament avoisine celle de la chromosphère (8 000 K), tandis que la température de la couronne solaire atteint les deux millions de degrés.
Granulation – granule – intergranule : structure convective élémentaire (1 000 km) recouvrant uniformément la photosphère solaire et de courte durée de vie (10 minutes).
Irradiance : puissance moyenne reçue du Soleil au niveau de l’orbite terrestre par unité de surface.
Mésogranulation – mésogranule : groupes de granules de dimension intermédiaire entre granulation et supergranulation.
Optique adaptative : dans un télescope, système basé sur un miroir déformable ayant pour but de compenser la turbulence atmosphérique, qui brouille les images.
Pore : petite tache correspondant à l’émergence de champs magnétiques, pouvant précéder l’apparition d’un centre actif complexe.
Réseau photosphérique : ensemble de champs magnétiques faibles associés à la supergranulation.
Supergranulation – supergranule : cellules de 30 000 km recouvrant la chromosphère solaire et dont l’origine est débattue (durée de vie 48 heures).
Tache solaire : région sombre de la photosphère marquée par une température inférieure à celle de son environnement. Une tache solaire est associée à un champ magnétique particulièrement intense.
Tube magnétique : mince « tuyau » rempli de matière isolée par un champ magnétique intense, fréquemment rencontré dans les espaces intergranulaires (à la limite du pouvoir de résolution des grands télescopes).
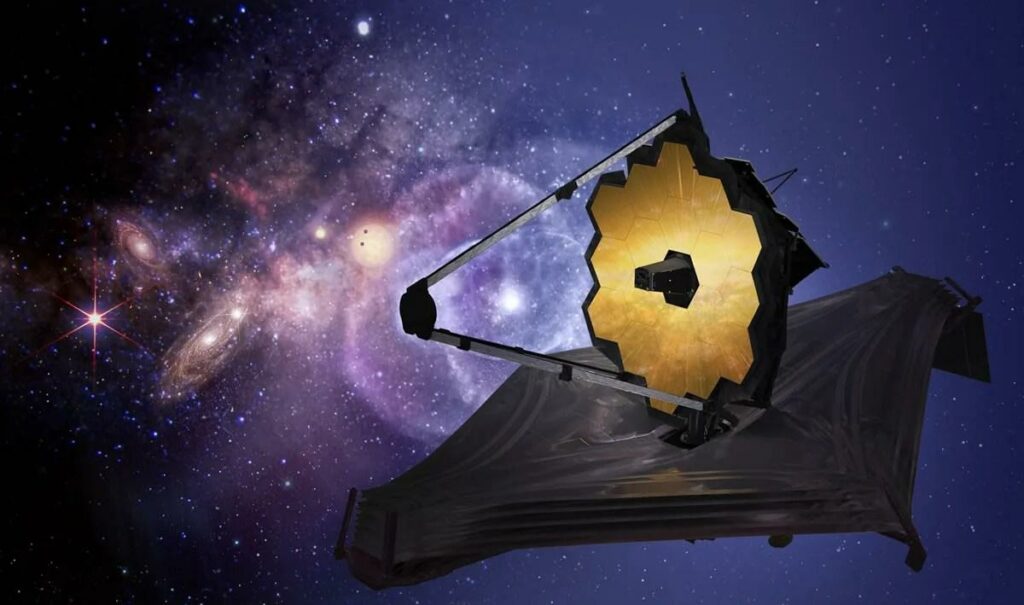
par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Zoom Sur
Il y a quinze ans, la découverte d’une relation étroite entre l’activité de formation stellaire et la masse stellaire des galaxies actives a ouvert une nouvelle fenêtre dans notre compréhension de l’évolution des galaxies.
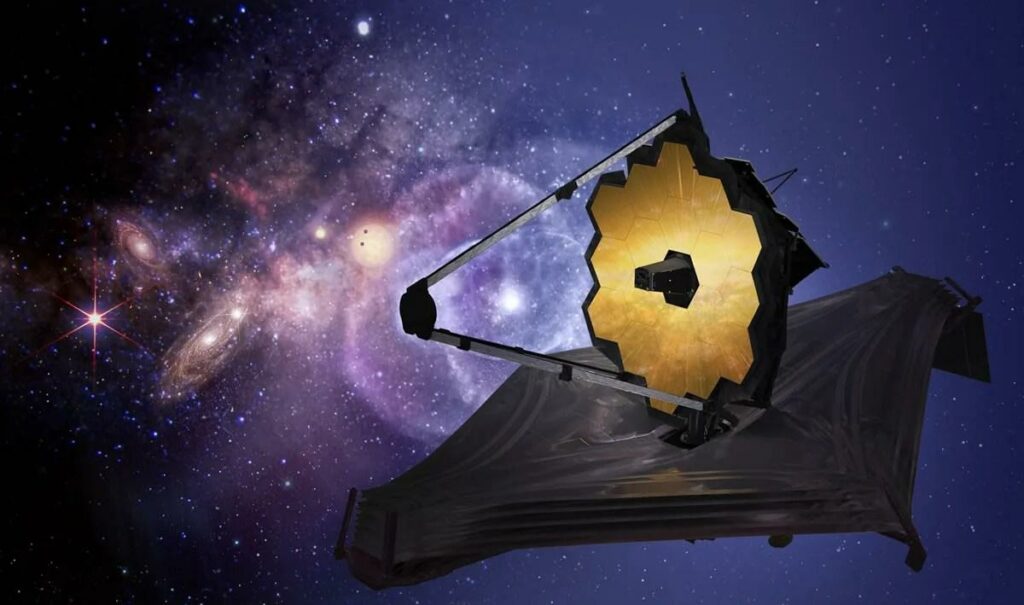
La relation entre le taux de formation stellaire et la masse stellaire est communément appelée « séquence principale des galaxies ». Elle est maintenant bien observée et contrainte sur 90 % de l’âge de l’Univers, c’est-à-dire depuis que celui-ci a 1 milliard d’années. À une masse donnée, 64 % des galaxies suivent cette relation étroite entre la masse stellaire et le taux de formation d’étoiles. Au-dessus de cette séquence, on trouve les galaxies dites à flambée d’étoiles. Ces dernières ont une activité de formation plus intense que les galaxies de même masse se trouvant sur la séquence principale. Cela peut être le résultat d’une fusion de galaxies riches en gaz, par exemple, qui va engendrer un épisode de formation stellaire intense entraînant une consommation d’une grande partie du réservoir en gaz. Au-dessous de la séquence principale se trouvent des galaxies rouges et passives dont l’activité de formation stellaire est très faible, voire nulle. Entre les deux, on trouve des galaxies en transition dans la « vallée verte » subissant un processus qui impacte, diminue, voire arrête leur activité de formation stellaire.
L’histoire de la formation des étoiles d’une galaxie
L’existence même de la séquence principale des galaxies implique que les galaxies forment majoritairement leurs étoiles de manière séculaire plutôt que lors d’épisodes violents. En conséquence, il est possible de reconstituer l’histoire de formation stellaire globale d’une galaxie en faisant l’hypothèse que celle-ci suit cette séquence principale toute sa vie. Cette approche a permis de montrer que l’histoire de formation stellaire des galaxies dépend en premier lieu de leur masse stellaire, qui peut être interprétée comme un traceur de la masse de leur halo de matière noire, lui-même lié à son environnement (isolé ou dans un amas de galaxies, par exemple). Ces histoires reconstruites montrent un pic de formation stellaire, à une époque qui dépend de la masse stellaire initiale, après lequel le taux de formation d’étoiles décline lentement, entraînant une baisse de la croissance en masse stellaire. Les masses atteintes au moment du pic de l’histoire de formation des étoiles (SFH pour Star Formation History) correspondent à un état chaud et massif du halo de matière noire qui empêche le gaz disponible de « tomber » et d’alimenter la formation stellaire de la galaxie. Ce mécanisme pourrait expliquer le lent déclin de l’activité de formation stellaire suivant le pic de l’histoire de formation stellaire.
La normalisation de la séquence principale évolue avec le temps cosmique : toujours pour une masse donnée, les galaxies formaient plus d’étoiles par le passé qu’aujourd’hui. Cependant, le plus surprenant est que la dispersion de cette relation semble être constante quel que soit l’intervalle de masse et de temps cosmique étudié. Cela implique que dès lors que l’on connaît la masse d’une galaxie, on peut en déduire son taux de formation d’étoiles à un facteur 2 près. Plusieurs études ont montré une variation cohérente de propriétés physiques des galaxies au sein de la séquence principale telles que la fraction de gaz contenu par les galaxies, leur morphologie et leur taille, ou encore leurs couleurs optiques. Cela suggère que la dispersion de la séquence principale serait d’origine physique et non due à des incertitudes sur les mesures.
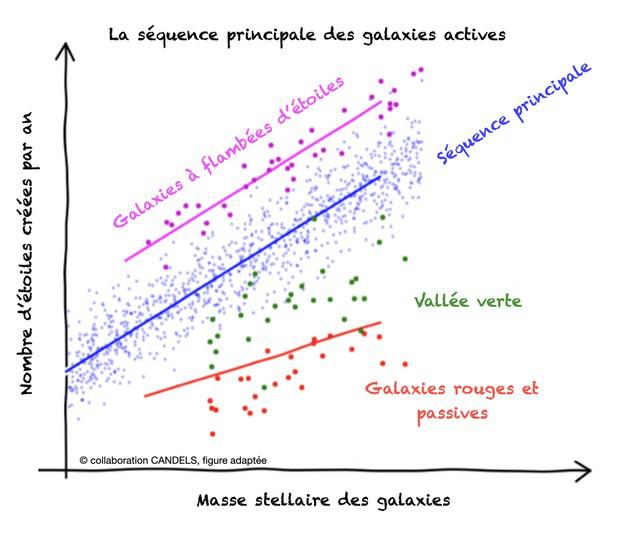
1. Taux de formation stellaire en fonction de la masse stellaire des galaxies. La plupart des galaxies se situent sur la séquence principale (en bleu). Les galaxies subissant un violent épisode de formation stellaire (en magenta) se situent au-dessus de cette séquence alors que les galaxies passives, ne formant plus d’étoiles se trouvent au-dessous (rouge). Des galaxies en transition (en vert) « tombent » rapidement de la séquence principale pour rejoindre les galaxies rouges et passives [1] . (Adapté de la collaboration CANDELS)
Le cheminement dans et hors de la séquence principale
Cependant, bien que les galaxies suivent une histoire de formation stellaire majoritairement commune, la dispersion de la séquence principale pointe également vers des variations dans ces histoires d’une galaxie à l’autre. En effet, comment les galaxies se déplacent-elles le long de la séquence principale ? Croissent-elles en masse jusqu’à atteindre une valeur critique entraînant la cessation de toute activité de formation stellaire ? Est-ce qu’elles oscillent dans la dispersion de la séquence principale pour finir par s’éteindre ? Passent-elles systématiquement par des phases d’intense activité de formation stellaire les faisant sortir de la séquence principale ? Les chemins qu’empruntent les galaxies le long de cette relation sont encore méconnus. Seule une contrainte forte sur leur histoire de formation stellaire permet de remonter dans le temps et de retracer leur mouvement le long de la séquence principale.
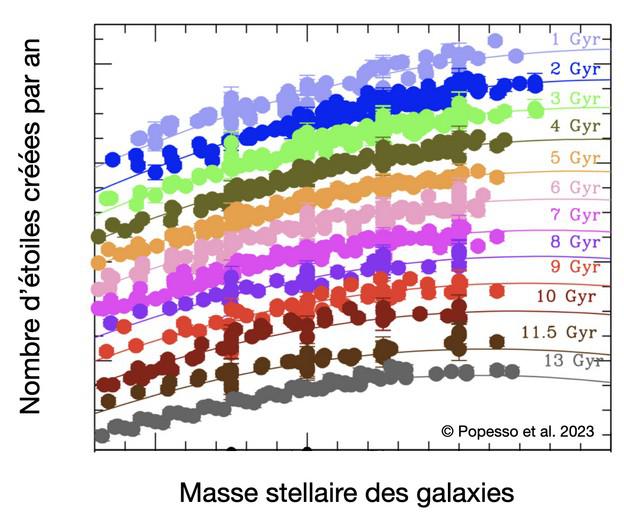
2. Taux de formation stellaire en fonction de la masse stellaire des galaxies. La normalisation de la séquence principale, représentée par différentes couleurs en fonction de l’âge de l’Univers (de 1 à 13 milliards d’années), augmentent lorsque l’on remonte le temps cosmique. (© figure adaptée de Popesso et al., 2023)
Découverte de galaxies atypiques dans la séquence principale
Récemment, les observations dans le domaine submillimétrique du plus grand relevé extragalactique fait par Alma [2] ont permis de découvrir une population particulière de galaxies cachée dans la séquence principale. En effet, ces galaxies ont des caractéristiques liées à leur contenu en gaz typiques des galaxies à flambée d’étoiles – ou starbursts – se trouvant au-dessus de la séquence principale (voir figure 1). D’une part, elles ont un contenu en gaz très faible comparé à des galaxies ayant la même activité de formation stellaire, comme s’il avait été consommé rapidement lors d’un épisode de flambée. D’autre part, la taille de ces galaxies vue en interférométrie par Alma aux longueurs d’onde radio submillimétriques est très réduite et compacte par rapport aux autres objets de même masse et même distance. Pourtant, ces galaxies se trouvent bel et bien dans la séquence principale. On les nomme « starbursts dans la séquence principale » pour cette raison. Il y a trois scénarios d’évolution possibles pour expliquer leur existence.
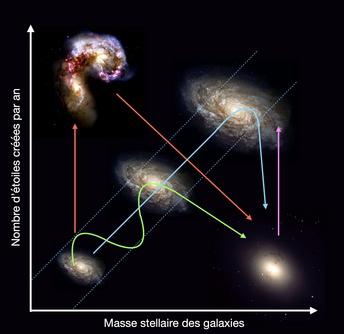
3. Schéma montrant les différents chemins d’évolution que peuvent prendre les galaxies sur le diagramme taux de formation stellaire – masse stellaire. Les lignes en pointillées indiquent la position de la séquence principale.
– Premier scénario avec des gaz migrateurs
Le premier, prédit par des modèles de formation des galaxies, propose que des galaxies étendues de la séquence principale peuvent évoluer de manière séculaire en galaxies compactes en acheminant du gaz vers leurs régions centrales. Un afflux de gaz déclenche un événement de compaction, provenant de flux contre-rotatifs ou de fusions mineures de galaxies, communément associés à des instabilités violentes du disque. Comme le taux d’apport de gaz est plus efficace que le taux de formation stellaire, le gaz est acheminé vers le centre de la galaxie : un noyau massif compact de gaz, formant activement des étoiles, se développe. Cette phase est caractérisée par une fraction de gaz très élevée et par un taux de consommation de celui-ci très rapide. En conséquence, la galaxie se déplace vers la partie haute de la séquence principale, puis redescend une fois l’épisode de formation stellaire passé. Tant que la masse de la galaxie est faible, le halo de matière noire n’empêche pas un nouvel apport en gaz et donc un nouvel événement. Une fois que la galaxie atteint une masse importante et critique, le halo de matière noire est chaud et empêche le gaz de réalimenter la galaxie, entraînant une extinction complète de la formation stellaire (scénario 1 de la figure 4).
– Un second scénario : des galaxies chutant
Une autre possibilité impliquerait les épisodes intenses de flambée d’étoiles qui placent les galaxies au-dessus de la séquence principale. L’épisode violent de formation d’étoiles, typique des fusions de galaxies riches en gaz, serait également capable de canaliser le gaz vers le cœur de la collision et de construire ainsi rapidement un noyau stellaire compact. En conséquence, la galaxie se déplace bien au-dessus de la séquence principale. Par la suite, elle retombe vers la séquence principale lorsque le taux de formation stellaire diminue à mesure que le réservoir de gaz est consommé. Enfin, la galaxie traverse la séquence principale en direction de la région des galaxies passives. Les « starbursts dans la séquence principale » seraient donc des galaxies en route vers la fin de leur vie, observées au moment de leur passage au travers de la séquence principale (scénario 2 de la figure 4).
– Un troisième scénario avec des galaxies en mode de survie
Finalement, un troisième scénario pourrait être aussi envisagé, avec des éléments des scénarios 1 et 2 : la galaxie pourrait subir une perte de moment angulaire, soit de manière externe via des fusions mineures avec de petites galaxies du voisinage, soit via des processus internes de migration de régions gazeuses. Dans les deux cas, le gaz est canalisé par le centre de la galaxie et la formation stellaire y est donc renforcée. Cependant, l’activité de formation stellaire n’est pas nécessairement forte au point de faire de la galaxie un vrai starburst au-dessus de la séquence principale, et elle peut juste rester dans sa partie haute. En tout cas, à mesure que le réservoir de gaz est consommé, la région de formation d’étoiles devient plus compacte, soutenant le taux de formation stellaire (consommation de gaz de l’extérieur vers l’intérieur). Le phénomène durerait jusqu’à ce que tout le gaz soit consommé. On peut voir ce scénario comme un mécanisme de survie de la galaxie. Elle fait tout pour maintenir une activité de formation stellaire qui lui permette de rester sur la séquence principale malgré son déficit en gaz. De cette façon, la galaxie passerait en moyenne plus de temps au sein de la séquence principale par rapport à celle du deuxième scénario.
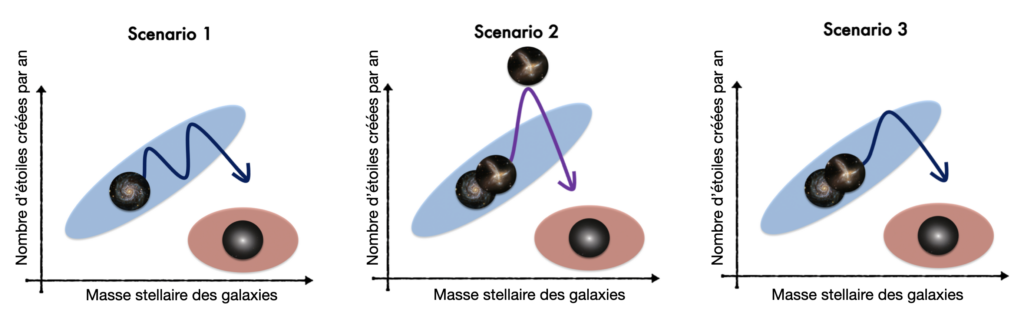
4. Scénarios évoqués par expliquer l’évolution des galaxies atypiques appelées « starbursts dans la séquence principale ». La région bleue représente la séquence principale et la région rouge montre la zone des galaxies passives, ne formant plus d’étoiles. Les flèches indiquent le mouvement des galaxies atypiques dans ce plan selon le scénario d’évolution envisagé.
1. Et les toutes premières galaxies ?
Une compilation récente des études de la séquence principale disponibles dans la littérature a montré que la normalisation de la séquence principale augmente lorsque l’on remonte le temps cosmique jusqu’à une époque où l’Univers avait 1 milliard d’années. Comme expliqué précédemment, l’implication majeure de la présence de la séquence principale est que les galaxies forment leurs étoiles via des processus séculaires. Cela était-il également le cas lorsque les galaxies étaient beaucoup plus jeunes ? En théorie, la formation hiérarchique des structures suggère que les galaxies croissent (en absorbant d’autres galaxies tout au long de leur existence) à la fois en masse de matière noire et en masse de gaz au fil du temps. Les simulations hydrodynamiques prédisent que la formation d’étoiles dans les premières galaxies augmente avec le temps durant le premier milliard d’années, passant par une phase très perturbée où leur histoire de formation stellaire est ponctuée d’épisodes de flambée d’étoiles. À mesure que leurs potentiels gravitationnels deviennent suffisamment profonds pour résister aux rétroactions des supernovae et des processus radiatifs (lesquels défavorisent de nouvelles créations d’étoiles), la formation stellaire devient continue. Pour confirmer ces prédictions, il faut remonter plus loin dans le temps pour déterminer l’histoire de formation stellaire des premières galaxies et vérifier l’existence ou non d’une séquence principale. Cela est compliqué, car la mesure de la masse stellaire des galaxies nécessite des observations de l’émission proche infrarouge qu’elles émettent. À cause du décalage vers le rouge des distributions spectrales d’énergie des galaxies (lire l’encadré 2), ce domaine de longueur d’onde provenant des galaxies les plus lointaines était inaccessible aux télescopes, jusqu’au lancement du James Webb Space Telescope (JWST) en décembre 2021. Depuis 2022, le JWST révolutionne peu à peu notre vision des galaxies lointaines et ce sont à présent quelques milliers de galaxies qui ont été observées lorsque l’Univers avait moins de 1 milliard d’années. Les premières études pointeraient vers un ralentissement de l’augmentation de la normalisation de la séquence principale, voire une diminution, lorsque l’Univers avait entre 500 et 800 millions d’années, contrairement aux prédictions des grandes simulations hydrodynamiques. Confirmer ce résultat observationnel et le comprendre du point de vue théorique reste une question ouverte pour les mois à venir. ■
Lequel des trois scénarios doit-il être retenu ?
Le scénario 1 (acheminement de grande quantité de gaz vers les régions centrales) implique que l’on devrait voir dans la séquence principale des galaxies ayant une région de formation stellaire compacte, associée à un réservoir de gaz important. Or, ce que l’on observe, ce sont des galaxies avec une région de formation stellaire compacte mais contenant peu de gaz. Le scénario 1 peut donc être éliminé.
Nous voici donc avec le scénario 2 : les « starbursts dans la séquence principale » seraient des galaxies de passage entre les zones au-dessus et au-dessous de la séquence principale ; et avec le scénario 3 : la galaxie perd du moment angulaire, le gaz afflue vers son centre, mais la formation stellaire qui en résulte n’est pas assez intense pour faire de la galaxie un vrai starburst au-dessus de la séquence principale. Pour départager ces deux scénarios, il est nécessaire de reconstruire l’histoire de formation stellaire des galaxies. Cela passe par la modélisation de la distribution spectrale d’énergie des galaxies (lire l’encadré 2, p. 24), le même procédé qui permet de déterminer, entre autres, la masse stellaire et le taux de formation d’étoiles des galaxies. Ces deux paramètres sont d’ailleurs directement liés à l’histoire de formation stellaire : le taux de formation stellaire est le dernier pas de l’histoire et la masse stellaire est proportionnelle à la masse totale d’étoiles formée par la galaxie tout au long de sa vie (lire encadré 1).

5. Schéma illustrant la compression du cœur de la galaxie au fur et à mesure que son contenu en gaz diminue, étant consommé par la formation stellaire. (C. Gomez- Guijarro)
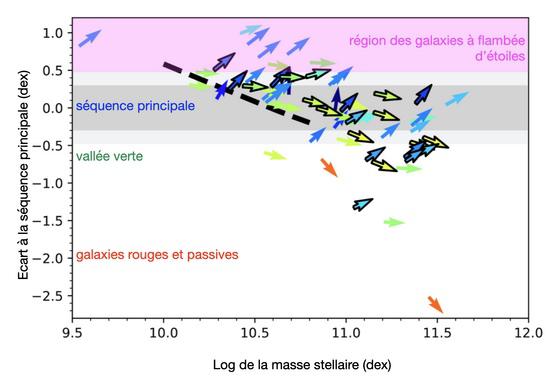
6. Écart à la séquence principale (en log) en fonction de la masse stellaire des galaxies. Les flèches représentent les galaxies de l’échantillon ALMA étudié, les flèches entourées de noir sont les
« starbursts dans la séquence principale ». Les différentes régions du plan taux de formation stellaire vs masse stellaire sont reprises ici. L’absence de flèches descendantes et rouges dans la région de la séquence principale élimine le scénario d’évolution 2.
Une approche dynamique de la séquence principale
Trancher entre les deux scénarios restants implique donc de pouvoir reconstruire l’histoire de formation stellaire de ces galaxies particulières et de retracer leur déplacement sur le plan du taux de formation d’étoiles vs masse stellaire. Pour cela, un indicateur de ce déplacement a été défini et calibré. Il indique, via un angle, le mouvement qu’une galaxie a suivi sur le plan durant un laps de temps défini. Il se calcule en mesurant la différence entre le taux de formation stellaire au début de ce laps de temps et maintenant, ainsi que la masse d’étoiles formée durant ce temps. Cet indicateur permet d’avoir une vue dynamique de la séquence principale des galaxies et de voir leur déplacement sur ce plan. Il a donc été utilisé pour poser de nouvelles contraintes sur l’évolution de ces galaxies aux propriétés particulières cachées dans la séquence principale.
Ce nouvel indicateur a permis de montrer que ces galaxies compactes et atypiques ne provenaient pas de la région constituée de galaxies subissant un épisode de formation stellaire intense (magenta sur la figure 6). À la place, les galaxies montrent sur les 100 derniers millions d’années un ensemble de mouvements très dispersés, mouvement propre à chaque galaxie et indépendant des autres, sur le plan taux de formation stellaire vs masse stellaire. Sur une plus longue période, un milliard d’années, toutes les galaxies étudiées dans ces travaux montrent un mouvement cohérent avec une augmentation de leur activité de formation stellaire sur ce laps de temps. Le second scénario proposé pour expliquer la présence de galaxies aux propriétés similaires à celles des galaxies à flambée d’étoiles ne semble donc pas valable.
En conclusion, la formation stellaire dans les galaxies massives « starbursts dans la séquence principale » semble se maintenir, leur permettant de rester sur la séquence principale. Néanmoins, leur fraction de gaz est faible et ces galaxies sont sur le chemin de la quiescence. Cela suggère donc un mécanisme d’autorégulation où la compression du gaz au centre de la galaxie permet de maintenir leur taux de formation stellaire.
2. « Mesurer les propriétés physiques des galaxies »
Contraindre individuellement l’histoire de formation stellaire d’une galaxie nécessite d’avoir une modélisation précise de l’émission de l’ensemble des populations stellaires qui la constitue. L’émission d’une galaxie en fonction de la longueur d’onde est appelée « distribution spectrale d’énergie ». Chaque processus physique en jeu dans les galaxies laisse son empreinte dans cette distribution. La modéliser permet alors de mesurer des propriétés clés des galaxies telles que leur masse stellaire, leur taux de formation d’étoiles, mais également leur quantité de poussière ou encore si elle abrite un trou noir supermassif. Pour reconstruire l’histoire de formation stellaire des galaxies, il est nécessaire d’obtenir des observations couvrant les domaines de longueurs d’onde allant de l’ultraviolet (UV, émis par les étoiles jeunes à la durée de vie très courte) au proche infrarouge (étoiles vieilles, un bon indicateur de la masse stellaire des galaxies). Cependant, la poussière présente dans les galaxies absorbe une partie de l’émission UV-optique des étoiles et la réémet en infrarouge lointain. Une bonne contrainte sur l’effet de la poussière via sa courbe d’atténuation est donc indispensable pour revenir à l’émission intrinsèque des étoiles et donc à leur histoire de formation stellaire. Pour prendre en compte ces processus et estimer les paramètres physiques des galaxies, il existe des codes de modélisation de la distribution spectrale d’énergie des galaxies. Ces codes sont basés sur des hypothèses de modèles d’émission de populations stellaires, de modèles d’histoire de formation stellaire, ou encore de loi d’atténuation par la poussière, etc. C’est une bonne douzaine de paramètres libres qu’il faut contraindre grâce aux observations. Une des hypothèses clés que ces codes utilisent est la modélisation de l’histoire de formation stellaire. Au premier ordre, ces codes utilisent une forme analytique, c’est-à-dire une fonction mathématique telle qu’une exponentielle décroissante, pour représenter l’histoire de la galaxie. Cependant, les études ont vite mis en avant des problèmes liés à ces représentations trop simples de l’histoire des galaxies. Elles engendrent des biais sur la mesure de la masse stellaire, du taux de formation d’étoiles, et même sur l’âge de la galaxie. Une autre approche a alors été explorée et la vie des galaxies est maintenant divisée en plusieurs intervalles de temps. Le taux de formation stellaire à chacun de ces intervalles est tiré au hasard dans une certaine loi statistique, et le résultat est comparé à la distribution spectrale d’énergie observée. Par essais successifs, on peut ainsi contraindre les paramètres permettant de reconstruire l’histoire d’une galaxie. Cette nouvelle approche permet maintenant de reconstruire de manière plus robuste l’histoire de formation stellaire des galaxies à partir de leur émission panchromatique (à toutes les longueurs d’onde), et donc de remonter dans le temps. ■
Conclusions
La « simple » relation entre le taux de formation d’étoiles et la masse stellaire des galaxies découverte il y a plus de quinze ans a ouvert tout un paradigme dans l’étude de l’évolution des galaxies. Les implications de son existence, sa normalisation, sa dispersion, ont permis aux astronomes de poser des contraintes fortes sur leur mode de croissance global. Cependant, de récentes découvertes ont montré une image plus complexe de la séquence principale avec des galaxies aux propriétés étonnantes enfouies parmi des galaxies tout à fait « normales ». Les questions liées à leur existence ont révélé la nécessité d’obtenir une approche plus dynamique de cette relation et de suivre le chemin qu’empruntent les galaxies sur ce fameux plan « taux de formation stellaire vs masse stellaire ». Cette vision dynamique n’est possible qu’à partir d’une bonne reconstruction de l’histoire de formation stellaire des galaxies. Aujourd’hui cette problématique est au cœur de la recherche autour de l’évolution des galaxies et de nouvelles techniques, issues d’études transdisciplinaires impliquant les mathématiques statistiques, permettent d’avancer grandement. De plus, l’arrivée des données spectaculaires provenant du JWST vont permettre d’étendre toutes ses études aux toutes premières galaxies et de sonder leur enfance.
par Laure CIESLA | Laboratoire d’astrophysique de Marseille | Prix jeune chercheure SF2A 2023

Publié dans le numéro Février 2024
Notes
- Pour toutes les figures, les unités employées dépendent de manière assez technique du décalage cosmologique vers le rouge (redshift) des galaxies. Ces unités ne sont pas explicitées. Les figures montrent qualitativement les comportements des galaxies décrits dans le texte.
- Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) est un observatoire situé dans le désert d’Atacama au Chili géré par l’Eso. Alma est composé de 66 antennes paraboliques qui fonctionnent ensemble pour former un interféromètre, permettant aux astronomes d’observer le ciel dans le domaine des ondes millimétriques et submillimétriques.
Références
■ Ciesla et al. (2017) A&A 608, A41. doi: 10.1051/0004-6361/201731036.
■ Ciesla et al. (2023) A&A 672, A191. doi: 10.1051/0004-6361/202245376.
■ Gómez-Guijarro et al. (2022) A&A, 659, A196. doi: 10.1051/0004-6361/202142352.
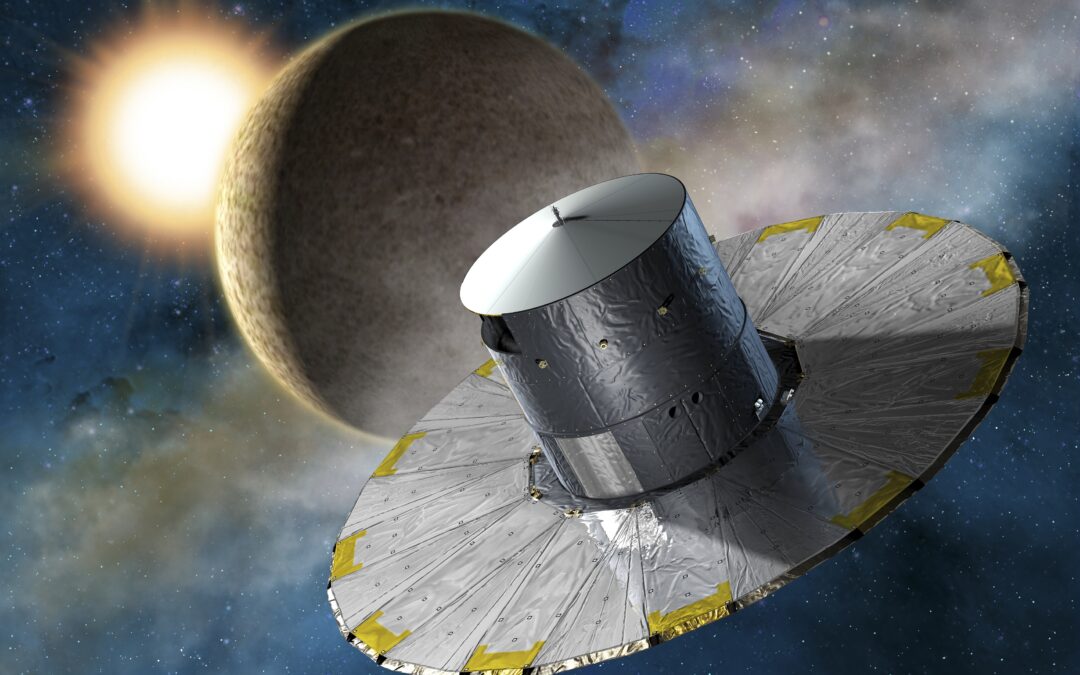
par Sylvain Bouley | Avr 11, 2024 | Zoom Sur
Le satellite astrométrique européen Gaia vient de livrer ses premières découvertes d’exoplanètes. Elles devraient se multiplier à mesure que les observations seront dépouillées sur une plus longue durée : Gaia sera dans quelques années le principal pourvoyeur d’exoplanètes nouvelles.
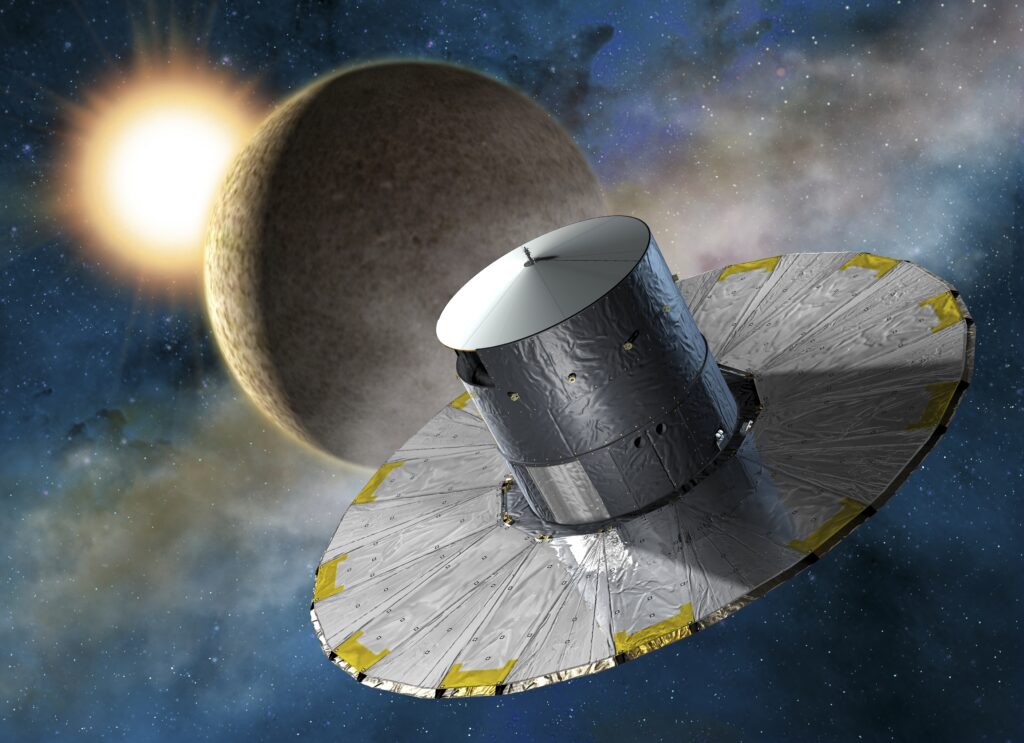
1. Le satellite Gaia, vue d’artiste. (ESA)
Depuis le 19ème siècle, on a tenté de découvrir des planètes autour d’étoiles proches en détectant par astrométrie le petit mouvement qu’elles produisent sur l’étoile autour de laquelle elles gravitent. On a même annoncé quelques détections qui n’ont jamais été confirmées. Avant Gaia, six exoplanètes seulement (si nous appelons planètes les objets de masse inférieure à 20 fois celle de Jupiter, les plus massifs étant des étoiles naines brunes) ont été trouvées par astrométrie : une avec l’interféromètre optique PHASES au Mont Palomar, HD 176051 b ; deux par interférométrie radio à très longue base (VLBI, l’étoile centrale étant dans ce cas un émetteur d’ondes radio), GJ 896A b et TVLM 513-46546 b ; une par astrométrie en lumière visible, GJ 2030 c et deux par astrométrie dans l’infrarouge, WISE J0458+6434 B et 2MASS J0249-0557 (AB) c. Les observations correspondantes sont longues et difficiles, si bien que l’on ne s’attend pas à ce qu’elles conduisent à de nombreuses découvertes.
Cependant, la précision astrométrique du satellite européen Gaia (fig. 1) est comparable à celle des observations interférométriques, et on peut espérer que ce satellite permettra de découvrir de très nombreuses exoplanètes, s’ajoutant aux quelques 5 200 connues au moment où nous écrivons. Quelles seront ces planètes ? Plus la planète est massive et plus elle est éloignée de l’étoile, plus le mouvement de l’étoile est important. En effet, plus la planète est éloignée, plus le centre de l’étoile est distant du centre de gravité du système. On découvre donc préférentiellement par astrométrie de grosses planètes gravitant loin de leur étoile. Par ailleurs, on trouve plus facilement ainsi les planètes qui tournent autour d’étoiles de faible masse puisque le rapport de la masse de la planète à celle de l’étoile est plus grand, comme les étoiles naines de type M ou éventuellement les naines blanches ou brunes. Notons également que puisqu’une orbite sous-tend un angle d’autant plus grand qu’elle est plus près de nous, on découvre surtout par astrométrie des planètes autour d’étoiles proches.
Mais il faut être patient, car on ne peut pas se contenter d’observer une portion limitée de l’orbite, le mouvement de l’étoile pouvant alors être confondu avec le déplacement de l’étoile liée à son mouvement propre au sein de la galaxie. C’est une des raisons pour lesquelles aucune découverte d’exoplanète par Gaia n’avait encore été annoncée en 2020 ; l’autre raison est le temps nécessaire pour analyser la masse énorme de données acquises par le satellite. Cependant, Gaia avait déjà permis de constater que de nombreuses étoiles « bougent » ; la statistique a montré que 30 à 40 % des étoiles proches ont un compagnon massif, grosse planète ou naine brune (voir le numéro de janvier 2021 de l’Astronomie, p. 26).
La situation a bien changé avec la troisième livraison des données de Gaia, qui contient toutes les observations depuis les premières en juillet 2014 jusqu’à celles de mai 2017, soit pendant 34 mois. Le délai qui s’étend entre mai 2017 et aujourd’hui a été nécessaire pour réduire ces observations, c’est pourquoi elles ne sont publiées que maintenant. Les 34 mois d’observations permettent enfin de tracer l’orbite de nombreuses étoiles munies d’une exoplanète, donc de détecter celle-ci, alors que ce n’était guère possible lors de la première et de la deuxième livraison, qui ne portaient respectivement que sur 14 et 22 mois de données. 6 306 étoiles sont dotées d’un ou plusieurs compagnons compacts invisibles d’après ces données. Beaucoup sont des exoplanètes. Gaia a aussi repéré 214 étoiles devant lesquelles une planète est passée et 363 évènements d’amplification de la lumière d’une étoile par l’effet de microlentille gravitationnelle dûe à une étoile interposée. Pour ces objets, une étude approfondie permettra peut-être de détecter dans quelques cas le passage d’un compagnon compact de l’étoile interposée.
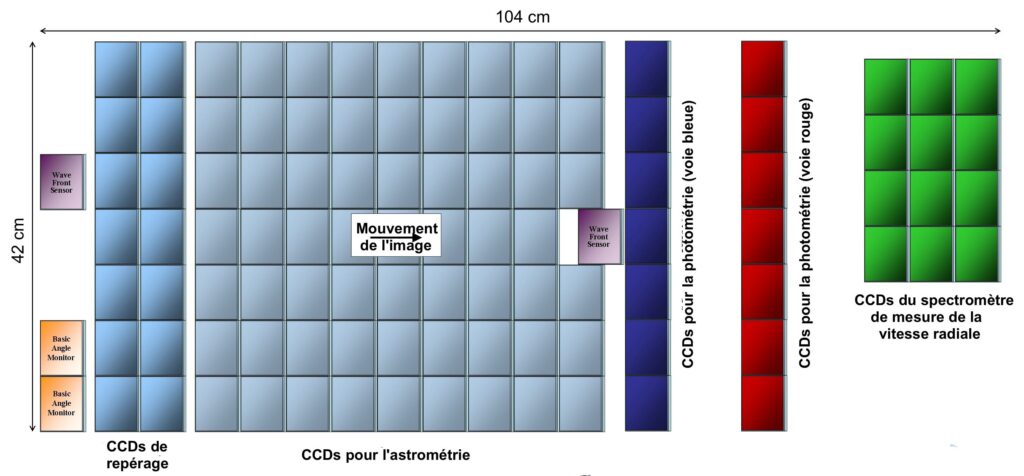
2. Les détecteurs du plan focal de Gaia. Ce sont 106 CCD avec un total de 938 millions de pixels. La rotation du satellite sur lui-même produit un balayage du ciel. Les objets sont d’abord repérés et triés dans les deux ensembles de 7 CCD, correspondant chacun à une des deux directions simultanées de visée du satellite, qui sont distantes de 106,5°. Puis les deux images superposées de ces deux directions de visée balayent les CCD astrométriques, donc chaque objet voit sa position mesurée 9 (ou 8) fois. La précision de mesure est meilleure dans la direction du balayage que dans la direction perpendiculaire. Les CCD pour la photométrie et pour la spectrométrie sont balayés ensuite. Deux CCD auxiliaires sont représentés en orange et deux en violet. (Adapté de l’ESA)
Comment Gaia trouve les exoplanètes
Voyons maintenant comment Gaia détecte les exoplanètes par astrométrie.
Chaque étoile a été observée de l’ordre de 400 fois pendant les 34 mois d’observations actuellement dépouillées ; lorsqu’elle est dans le champ de vision, l’étoile passe 8 ou 9 fois devant les détecteurs de position (fig. 2). La précision sur la position en est améliorée, mais le nombre d’observations indépendantes est réduit d’autant, à une cinquantaine. Pour chercher des exoplanètes, seuls sont utiles les groupes d’observations bien répartis dans le temps, qui sont finalement au nombre de 15 à 35 pour chaque étoile. Cela permet de chercher si elle possède une exoplanète, mais pour l’instant pas d’en trouver plusieurs autour de l’étoile.
Après les corrections habituelles sur la position de l’étoile (précession, nutation, aberration, déplacement relativiste par la masse du Soleil, parallaxe), on porte cette position en fonction du temps, obtenant ainsi le mouvement propre de l’étoile. En l’absence de perturbation, le déplacement de l’étoile est rectiligne, mais des déviations périodiques éventuelles révèlent la présence d’un compagnon (fig. 3). La distance de l’étoile étant connue par la mesure de sa parallaxe par Gaia, on peut déduire des observations le demi-grand axe a de la trajectoire de son centre autour du centre de gravité commun de l’ensemble étoile-planète. Puis, connaissant la période p de révolution et en estimant la masse M de l’étoile à partir de son type spectral, on peut obtenir le demi-grand axe A de l’orbite de la planète en utilisant la formule de Kepler/Newton : A³/p² = GM/4π²,
G étant la constante de la gravitation. On peut alors obtenir la masse m de la planète en remarquant que m/M = a/A.
On a le plus grand intérêt à vérifier les résultats de l’astrométrie en observant les variations de la vitesse radiale de l’étoile, ce qui permet d’améliorer et de compléter les paramètres du système. D’ailleurs, ces méthodes sont complémentaires : l’astrométrie est sensible aux mouvements dans le plan du ciel et la vitesse radiale aux mouvements perpendiculaires.
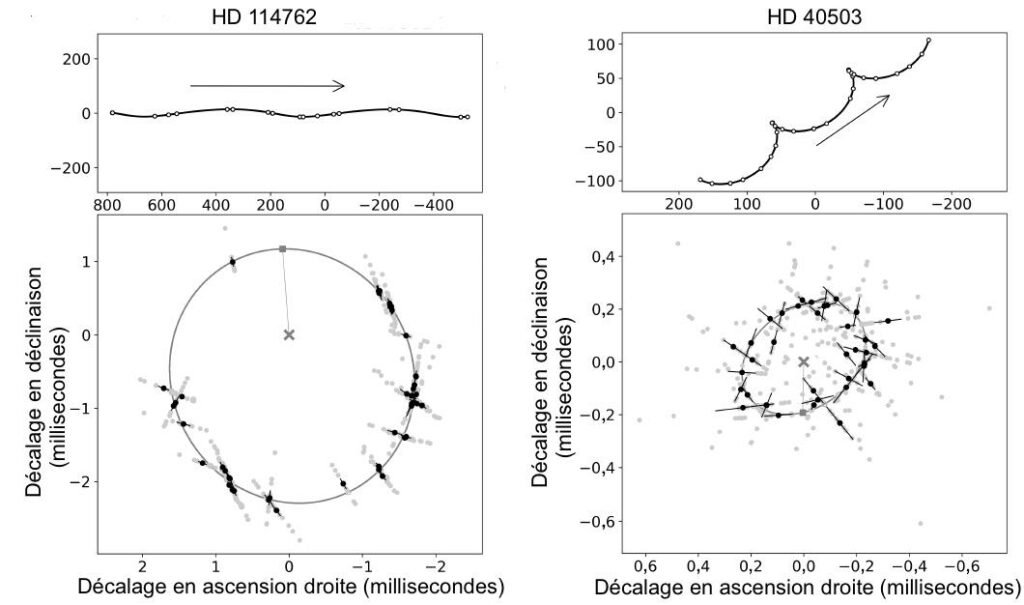
3. Mouvement de deux étoiles observé par Gaia. À gauche, HD 114762, un cas relativement facile (distance 129 années-lumière, période de révolution 83,7 jours, excentricité apparente 0,32). À droite, le cas plus difficile de HD 40503 (distance 128 années-lumière, période 2,3 ans, excentricité apparente 0,07). En haut, le mouvement de chaque étoile sur le ciel (échelles des ordonnées en millisecondes de degré). En bas, déplacement de l’étoile par rapport au centre de gravité étoile- planète. Les points d’observations individuelles sont en grisé, leurs moyennes sont les points noirs avec barre d’erreur dirigée selon la trajectoire de l’étoile sur les CCD (l’autre dimension n’est pas utilisée). (Adapté de Holl B., Sozzetti A., Sahlmann J. et al.)
Les résultats de l’astrométrie de Gaia
Des algorithmes différents ont été utilisés par plusieurs équipes pour chercher si les étoiles observées par Gaia avaient un compagnon compact. Une de ces équipes réunissant des chercheurs des observatoires de Genève et de Turin ainsi que de l’Agence spatiale européenne à Madrid a identifié 17 étoiles probablement munies d’une planète, dont 9 détections ont été validées par l’observation des variations de la vitesse radiale de l’étoile et correspondent donc à des exoplanètes déjà connues. Les autres restent à valider et seront donc des découvertes à mettre au compte de Gaia si leur validation est positive. La collaboration internationale DPAC trouve 70 étoiles éventuellement munies d’une exoplanète, dont 9 sont validées. Seules quelques-unes sont communes aux deux études, ce qui illustre les difficultés de détection des exoplanètes par astrométrie pendant un délai de seulement 34 mois. La situation devrait s’améliorer énormément par la validation des candidats déjà connus et surtout l’analyse des observations obtenues par Gaia pendant une période plus longue que les 34 mois actuellement analysés.
Les détections d’exoplanètes par transit
Les capacités photométriques de Gaia sont remarquables : le flux d’une étoile peut être mesuré avec une précision de l’ordre de 1/1 000. Cela a permis, comme on l’a dit plus haut, de détecter 214 étoiles devant lesquelles est probablement passée une planète. 173 de ces détections confirment des observations antérieures de transits à partir du sol ou de satellites, et 41 correspondent à des étoiles nouvelles. Pour être sûr que la diminution temporaire de l’éclat d’une étoile correspond bien au passage d’une exoplanète devant son disque et non à une variation intrinsèque, il faut observer plusieurs transits, et Gaia n’est pas particulièrement adaptée pour cela car chaque étoile n’est observée qu’une quinzaine de fois par an. Il faudra donc attendre d’avoir plus de données pour validation. Il est aussi très souhaitable d’observer les variations de la vitesse radiale de l’étoile pour confirmer la détection et en particulier pour préciser la période de révolution de l’exoplanète.
Ces conditions ont été réunies pour l’étoile de type solaire Gaia EDR3 3026325426682637824 (cf. Fig. 4). Ces 19 chiffres sont nécessaires pour identifier l’étoile parmi les quelque 2 milliards observées par Gaia. La figure 4 montre les mesures de l’éclat de l’étoile en fonction du temps pendant les 34 mois d’observation. La recherche d’une périodicité dans les diminutions d’éclat observées a conduit à une période de révolution de l’exoplanète de 3,0525 jours, valeur confirmée par des observations de la vitesse radiale de l’étoile. De l’ensemble de ces observations on déduit que la planète, nommée Gaia-1b, est un « Jupiter chaud » de masse voisine de celle de Jupiter, qui gravite très près de l’étoile, à seulement 6 millions de kilomètres, dix fois plus près de l’étoile que Mercure du Soleil. Gaia a aussi découvert par transit un autre Jupiter chaud, Gaia-2b et il reste donc 39 candidats à confirmer par des observations ultérieures.
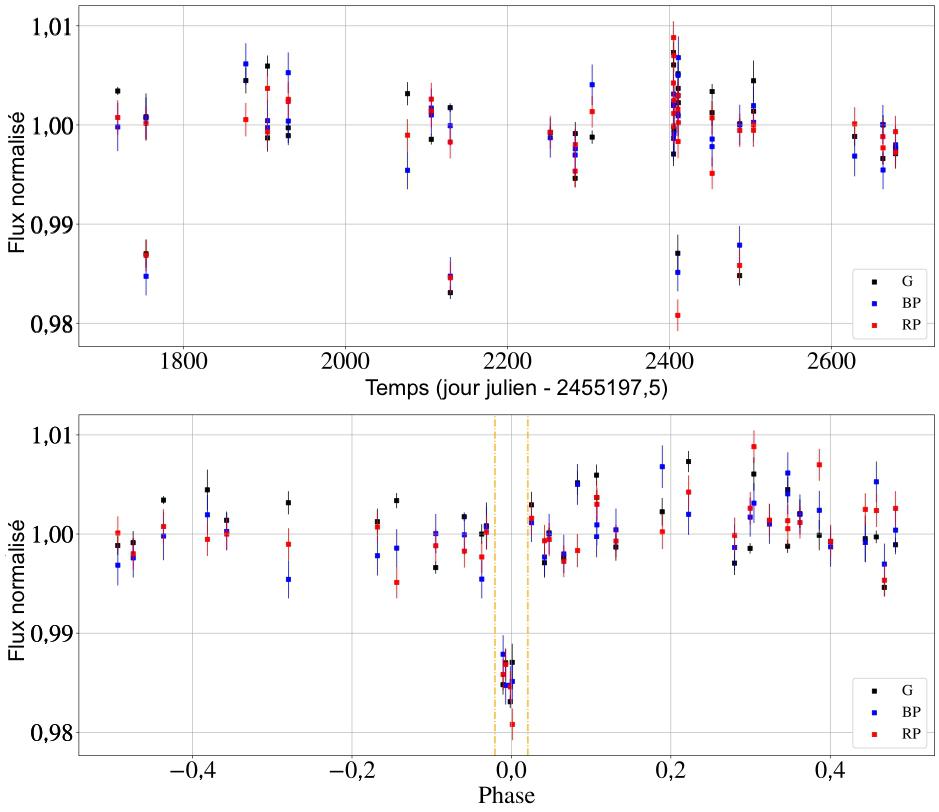
4. Photométrie par Gaia de l’étoile EDR3 3026325426682637824. En haut, le flux en fonction du temps, dans les trois bandes G (vert, observée par les CCD astrométriques), BP (bleu) et RP (rouge) observées par les CCD photométriques (voir la figure 2). Les évènements d’occultation sont bien visibles. En bas, les mêmes données mais regroupées en fonction de la révolution de la planète. (Patrick Boissé)
Les résultats des observations astrométriques et photométriques que nous venons de décrire sont encore peu nombreux : mais ce n’est qu’un petit avant-goût de ce qui nous attend dans quelques années, lorsque toutes les observations de Gaia seront dépouillées. Elles couvrent actuellement plus de 8 années. On estime que Gaia pourrait découvrir par astrométrie de l’ordre de 70 000 exoplanètes si la durée de la mission est étendue à dix ans, ce qui est fort probable ; il faut y ajouter plusieurs centaines d’exoplanètes qui seront découvertes par transit devant leur étoile.
Par James Lequeux

Publié dans le numéro Novembre 2022
Pour en savoir plus
Gaia Collaboration : Arenou F., Babusiaux C., Barstow M. A. et al., 2022, « Gaia Data Release 3: Stellar multiplicity, a teaser for the hidden treasure » [https://www.aanda.org/articles/aa/abs/forth/aa43283-22/aa43283-22.html].
Holl B., Sozzetti A., Sahlmann J. et al., 2022, « Gaia DR3 astrometric orbit determination… » [https://arxiv.org/pdf/2206.05439.pdf].
Panahi A., Zucker S., Clementini G. et al., 2022, « The detection of transiting exoplanets by Gaia » [https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/07/aa43497-22.pdf].